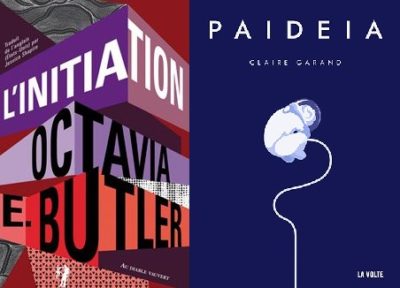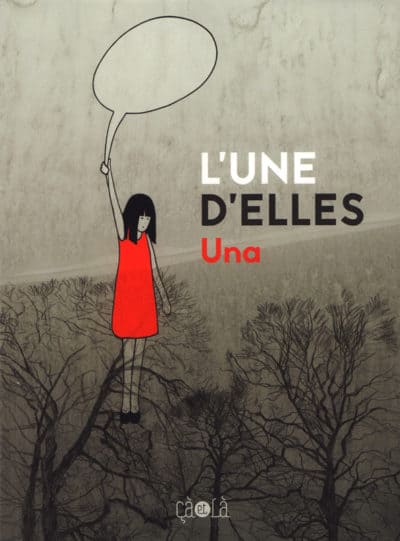Après avoir édité Pleines de grâce en 2020 et Les Aventures de China Iron en 2021, les éditions de l’Ogre continuent de diffuser en France l’œuvre de Gabriela Cabezón Cámara, une écrivaine, journaliste et militante féministe argentine, considérée, à raison, comme l’une des figures les plus importantes de la littérature latino-américaine (et dont, pour ma part, je n’avais jamais entendu parler avant le merveilleux travail des éditions de l’Ogre). Cette nouvelle parution réunit deux textes de l’autrice : un conte, Tu as vu le visage de Dieu, et une nouvelle Romance de la Noire Blonde, datant respectivement de 2011 et 2014 pour leur version originale.
A moins qu’il ne s’agisse de longs poèmes, car les deux textes ont été écrits en vers. Une métrique que ne pouvait malheureusement pas rendre la traduction en français. Une note de Guillaume Contré, le traducteur, s’en explique et s’en excuse dans la préface : plutôt que nuire au sens en cherchant à conserver le vers, il a préféré la prose libre. Toujours est-il que ces textes sont pure poésie, j’y reviendrai.

Une réécriture de La Belle au Bois dormant
Tu as vu le visage de Dieu est présenté dans la préface française de l’autrice comme une réécriture de La Belle au Bois dormant. Et franchement les héroïnes de Perrault, des frères Grimm ou de Disney ont plutôt beaucoup de bol par rapport à Beya, l’héroïne de Gabriela Cabezón Camara, qui n’est pas exactement en train de vivre sa meilleure vie, c’est le moins qu’on puisse dire.
En effet, l’histoire de Beya a été inspirée à l’autrice par un fait divers qui connut une forte couverture médiatique en Argentine : la disparition de Marita Verón le 3 avril 2002, une jeune fille de 23 ans, dans la province de Tucumán, très vraisemblablement enlevée et asservie par un réseau de traite de femmes. Le sort de Marita Verón, passé au filtre de l’un des contes les plus flippants de notre enfance et nous voici donc avec Beya, jeune femme kidnappée et prostituée de force dans un sordide bar à putes. Le titre du conte fait lui-même référence à l’expression argentine « voir le visage de Dieu » utilisée pour décrire le plaisir de la première expérience sexuelle des jeunes hommes, initiés par leurs aînés dans des bordels.
Amie lectrice, ami lecteur, si vous êtes mal à l’aise avec les scènes de viols ou les descriptions crues, quoique poétiques, de violences sexuelles, passez votre chemin. Ce texte risque fort de vous être insupportable (mais essayez quand même de faire l’effort, car la lecture en vaut vraiment la peine) :
« […] et si tu pries Dieu sans penser qu’Il doit bien savoir à quel point tu te fais éclater et qu’un Notre Père ne lui suffira pas pour t’envoyer un miracle, c’est parce que le maquereau en chef, alias le Charognard, le Tonnerre, le Rat, tu ne veux pas le prendre dans tes bras quand il te caresse après t’avoir frappée et s’être servi de toi comme d’un cendrier pour éteindre sa cigarette, ça non, ça n’arrivera pas, jamais tu ne l’aimeras ce proxénète assassin : tu te recommandes à Jéhovah et tu le hais ce fils de pute qui te matraque parce que tu joues l’idiote, mongole de Beya au bois dormant, dit-il et crie-t-il avant de te frapper un bon coup, et tu vas voir pute abrutie, ici c’est moi qui décide quand tu dors, il hurle et il cogne plus fort, avec une fureur de tyran car même quand tu es debout et qu’on te baise et que tu reçois une pluie de gnons tu restes endormie, parce que c’est ta façon d’être torturée qui fuit à tire-d’aile, et il dit qu’il va t’apprendre à être réveillée petite pute et il s’agite rageusement arrimé à ton fion en t’enculant avec sa pioche, il creuse à grands coups, il casse, déchire, mélange sang et merde et quand ses couilles virent au rouge marronâtre, il dit ça suffit et laisse place à Medina la vieille sorcière, qui t’injecte la came, Beya, […] ».
Comme le titre et l’extrait cité, tout le conte est écrit à la seconde personne du singulier. Le procédé peut évoquer la dissociation traumatique et les expériences de sortie de corps que vivent certaines victimes, notamment de viols. Il peut également se révéler impliquant pour la lectrice ou le lecteur, induisant un processus d’identification très fort à l’héroïne. Véritable courant de conscience, son soliloque donne à éprouver tous les sentiments qui traversent Beya : douleur, incompréhension, tristesse, indifférence, colère, rage, terreur mais aussi foi, apaisement et une forme de joie, lorsqu’avec elle on découvre le visage de Dieu, « blanc et radieux comme rien d’autre ne saurait l’être, comme la somme de toutes les bonnes choses de la vie », offrant au passage une ironique et sublime réappropriation féministe de l’expression populaire argentine.
Je ne crois pas vous spoiler en vous dévoilant qu’une fois réveillée, Beya ne pense pas vraiment à se parer d’une belle robe pour épouser un prince charmant. L’héroïne ayant enfilé un tout autre costume (que je vous laisse le plaisir de découvrir), la réécriture de La Belle au Bois Dormant se double d’une relecture de la légende et du martyre de Saint Georges. La pute devient sainte et sa vengeance est sacrée.
Tu as vu le visage de Dieu a eu un grand retentissement en Argentine. Le Sénat lui a décerné le prix Alfredo Palacios en reconnaissance de sa contribution à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains, tandis que le Parlement de Buenos Aires déclarait l’œuvre d’intérêt social. On comprend pourquoi. J’ai rarement vu réunies dans une même œuvre avec une telle force puissances poétique, politique et populaire.
De feu, d’art et d’amour
Après la lecture d’un tel chef d’œuvre, je craignais d’être déçue par la lecture de la seconde œuvre du volume. Eh bien, pas du tout. Si j’ai admiré Tu as vu le visage de Dieu, j’ai adoré Romance de la noire blonde, tout simplement la plus belle histoire d’amour que j’ai lue depuis longtemps.
Et si les immolations vous sont moins pénibles que les scènes de viols ou de tortures, ce texte ne devrait pas vous poser de problèmes particuliers, amies lectrices, amis lecteurs, âmes parfois trop sensibles.
Comme le conte précédent, la nouvelle est inspirée de faits réels selon l’expression consacrée, en l’occurrence la mort de Rubén Arias, un père de famille de cinq enfants qui a préféré s’immoler par le feu que d’être expulsé de son logement par la police. Hors l’immolation, Gabi, l’héroïne de la nouvelle n’a que peu à voir avec Rubén Arias. Comme l’explique l’autrice dans la préface de l’édition française :
« C’est une poète cocaïnomane qui, bien défoncée, s’immole quand la police s’apprête à évacuer un immeuble d’artistes squatteurs dans lequel elle se trouve par hasard. […] Sans s’en rendre compte, sans même savoir ce qui s’est passé – c’est la gueule de bois la plus sombre de sa vie –, elle va se réveiller en étant une autre : elle n’a plus de visage, le feu l’a dévoré, et elle est devenue la leader presque sainte des artistes qu’elle a sauvés de l’évacuation ».
La première partie du texte est jouissive de joie militante (si on en revient à la valeur guerrière du mot), cette joie du rapport de force qu’on parvient à inverser parfois grâce à l’action collective :
« A ce moment-là, on avait déjà un grand réseau Nextel, Twitter et WhatsApp, et en une journée on leur a foutu un bordel fédéral. Un délégué par logement, un bonze à chaque balcon avec une torche dans la main dès que le jour a baissé. Chaque tour semblait un arbre de Noël de mauvais augure ».
L’histoire est écrite cette fois-ci à la première personne, c’est Gabi elle-même qui la raconte, avec toujours une bonne dose de tranchant, de distanciation et d’ironie. Romance de la noire blonde pourrait presque servir de manuel aux apprentis activistes (mais sans jamais être dogmatique, ou pour le dire directement « chiant ») et on aurait presque envie de se faire cramer la gueule pour voir… d’autant que Gabi, partie en tournée internationale, rencontrera à Venise un amour flamboyant en la personne d’Elena, une riche collectionneuse helvétique :
« Je l’ai vue passer et il m’est arrivé ce qui arrive à tant de Noirs : elle m’a plu parce qu’elle était grande, blonde, musclée, qu’elle portait ses vêtements en lin avec la même élégance qu’Achille aurait porté le drapeau grec en chevauchant sur une jument noire couverte d’acier sur la rive de la mer bleu profond de Troie, je veux dire qu’elle m’a plu et que je l’ai vue enveloppée de coucher de soleil sur la mer avec poème rose et fond musical […] »
Et c’est dans ce genre de moments qu’on regrette de ne pas lire l’espagnol, parce que le texte en VO est composé en octosyllabes et hendécasyllabes (soit un vers de onze syllabes, peu usité dans la poésie française, mais mètre star de poésie latine érotique et de la poésie italienne tout court) et que ça doit quand même être encore plus éblouissant et émouvant que ça ne l’est déjà.
De la jouissance politique, le texte passe à la jouissance érotique (les scènes de cul sont d’une beauté anthologique, j’en aurais bien citées mais j’ai déjà été beaucoup trop longue) et la romance se poursuivra en œuvre d’art, à moins que ça ne soit l’inverse.
Il est aussi question de mort, de sens de l’existence, de martyrs et de sacrifices, autant de sujets totalement casse gueule, mais que Gabriela Cabezón Cámara et son héroïne abordent toujours avec justesse et émotion. Oui je sais ces mots sont tout clichés et creux, et j’aurais aimé trouver mieux à dire, mais c’est vrai et quand vous aurez souligné une phrase sur deux de ce texte et chialé sur toutes les pages du bouquin, vous comprendrez.
En attendant, je préfère laisser le mot de la fin à Paul B. Preciado (mots qui ouvrent la présente édition) :
« Seuls Castellanos Moya et Gabi Cabezón ont su écrire avec une telle précision la violence de la nécropolitique, mais aussi le pouvoir du corps à résister et à affirmer la volonté de vivre. Ce livre peut être lu comme un manifeste politique, mais aussi comme un long poème accompagnant les rescapés ».
Je sais déjà qu’il m’accompagnera longtemps.
PS : pour les plus feignasses d’entre vous, j’ai oublié de préciser que le livre est petit et fait à peine plus de 150 pages, donc vous n’avez vraiment aucune excuse pour ne pas le lire.

Louise Katz a eu une mère féministe. Privée de Barbie et inscrite de force à l’aïkijudo, elle met 20 ans à devenir la pouf à rouge à lèvres qu’elle a toujours rêvé d’être. Doctoresse ès littérature latine, elle aurait aimé prendre le pseudo de Doktor SS et mixer du disco-punk dans des usines abandonnées. Finalement, elle devient journaliste et entrepreneuse. Elle aime les femmes qui pensent et les femmes qui font, les sages et celles qui font des doigts. Et bien sûr celles qui lisent et celles qui écrivent.