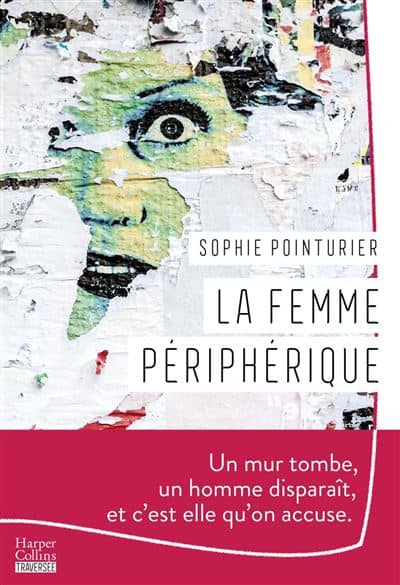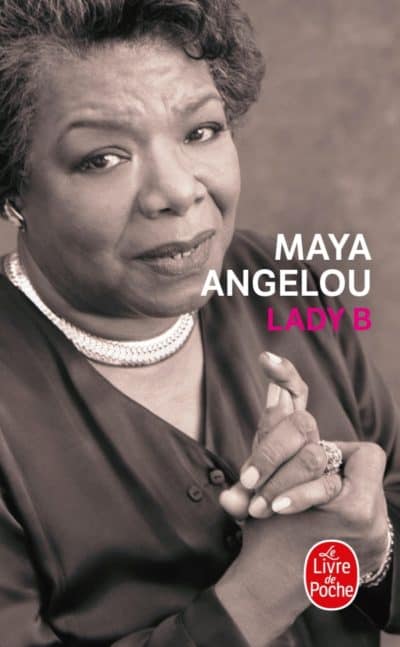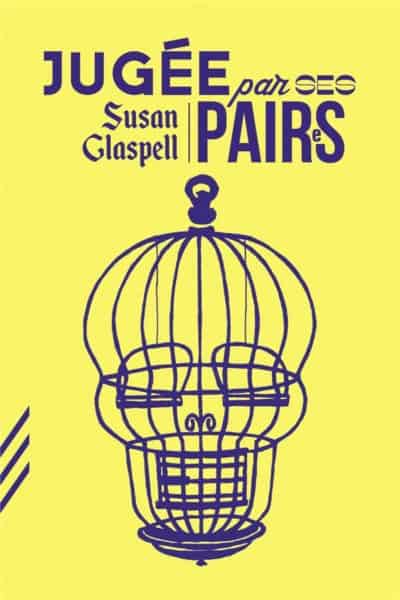Avec La Femme périphérique, Sophie Pointurier nous propose une plongée passionnante dans le monde de l’art contemporain. Petra et Peter Wolf forment un duo artistique célèbre dont les œuvres se monnaient à prix d’or sur le marché mondial. Lui, l’artiste échappé de Berlin Est avant la chute du mur, reste invisible sous prétexte de phobies sociales, elle, la fille de l’Ouest, professeure d’Arts plastiques dédiée au génie de son mari, assure la communication avec les galeristes, journalistes et marchands d’art. Jusqu’au jour où une petite maison d’édition française décide de publier une biographie du couple et insiste pour rencontrer Peter… qui reste mystérieusement introuvable. S’ensuit une enquête qui déborde largement le cadre du monde de l’art puisque la police s’en mêle et qu’une accusation de meurtre plane sur Petra, devenue en un claquement de doigt une figure diabolique, castratrice et bien évidemment dépourvue de talent.
Le roman prend ainsi la forme du polar et la structure narrative efficace nous tient en haleine jusqu’au dénouement. Une multitude de personnages intervient dans la narration, l’occasion pour Sophie Pointurier d’esquisser des portraits tout en finesse : les amies fidèles qui connaissent les dessous de l’histoire et tentent de protéger à tout prix Petra, les journalistes, agents, éditeurs qui gravitent dans le monde de l’art contemporain et ce qu’il charrie d’entre-soi, de petites lâchetés et de grandes compromissions. On navigue avec ces personnages entre l’Allemagne, New York et Paris, les époques se superposent au gré des souvenirs. Le spectre de l’inquiétante Stasi hante les esprits, la Factory de Warhol ressurgit du passé, et avec elle la mention discrète de Valérie Solanas[1] sonne comme un avertissement.
Les artistes oubliés d’ex-RDA
Peter n’est pas le seul disparu de ce roman, qui évoque aussi l’effacement des artistes d’ex-RDA, les officiels qui étaient soumis à une surveillance stricte et qui ne pouvaient créer que dans le cadre très contraint de la propagande du régime. Pourtant, nombreux sont ceux – et celles, probablement – qui ont réussi à produire des œuvres remarquables, accomplissant de l’intérieur la prouesse de subvertir les codes imposés. Mais à la chute du mur, ils disparaissent. Les héros sont de l’autre côté, ceux qui se sont évadés, créant au passage toute une mythologie romantique du passage à l’Ouest, et dont les productions artistiques ont été considérées comme la dénonciation des travers du régime qu’ils avaient si courageusement quitté. Drôle de storytelling d’ailleurs qui héroïse la fuite et juge avec sévérité ceux qui sont restés, comme si tous et toutes avaient adhéré sans retenue à l’idéologie du parti. Encore une fois, ce sont les vainqueurs qui font l’Histoire et a fortiori l’Histoire de l’Art. Le peintre et sculpteur Georg Baselitz avait sentencieusement enterré tous ces artistes en juin 1990 lorsqu’il déclara qu’il n’y avait pas eu d’artistes en RDA, parce qu’ils l’avaient tous quittée… Et voilà balayées au passage toutes les galeries d’art alternatives et semi clandestines qui existaient malgré tout, à l’instar de la Galerie 43 du roman. Le personnage de Rüdiger incarne cet injuste effacement, et la scène où il déambule dans les archives de Beeskow, à la recherche d’une toile et d’un monde perdus, est particulièrement émouvante.
L’effacement des créatrices
Le grand sujet du livre se dessine au gré des avancées de l’enquête : l’invisibilisation des femmes artistes. Petra est décrite dès le début en termes peu flatteurs par ceux qui cherchent à tout prix à approcher Peter, l’artiste génial qui suscite toutes les fascinations : « Diva, chieuse, vraie emmerdeuse… On la traitait aussi de frigide, de comptable, ça dépendait. ».
Le personnage de Sven Sön, directeur des collections du MET à New York et organisateur d’une grande rétrospective de l’œuvre du couple, nourrit à l’encontre de Petra une rage acharnée. Abasourdi à l’idée que cette dernière n’aurait pas joué le rôle secondaire qu’on lui a toujours attribué dans le binôme artistique, il s’étrangle dans sa bile sexiste :
« Comme si elle pouvait… Elle est… Cette femme, elle est…Elle n’a pas de vision, quoi ! Rien ! Qu’est-ce qu’elle sait de tout ça ? Moi je sais ce qu’elle fait… Le petit pot de fleurs par-ci, les barreaux noirs par-là, le… C’est une… une illustratrice ! s’écria Sven. »
Alors certes, il incarne une misogynie crasse qui relève de la névrose individuelle. Mais Sophie Pointurier n’a pas eu à remuer très profondément le marécage pour dénicher des avatars de Sven Sön bien ancrés dans le paysage artistique international. Lorsqu’elle imagine un entretien entre ses personnages experts en art contemporain, elle retranscrit presque mot pour mot une conversation qui s’est tenue en 2005 entre Christine Macel, alors conservatrice au Centre Georges Pompidou chargée de l’art contemporain et du secteur prospective (la meuf pèse, donc) et deux artistes de renommée internationale : Xavier Veilhan et Jean-Marc Bustamante. Tous les poncifs y passent : aux hommes la puissance, la force animale, les toiles grand format symboles de la volonté de conquête virile. Aux femmes la douceur, la modestie et les petits formats. Si seule Louise Bourgeois semble trouver grâce à leurs yeux c’est parce que c’est une femme … « phallique ». Rappelons que ce même Bustamante a été directeur des Beaux-Arts de Paris de 2015 à 2018, vénérable institution jamais dirigée par une femme depuis sa création avant… la semaine dernière ! (Alexia Fabre a en effet pris ses fonctions le 25 janvier 2022).
En insérant tous ces éléments à la trame de son roman, Sophie Pointurier démontre que le talent est une construction sociale dans laquelle le genre n’a rien d’innocent. Les institutions culturelles programment les artistes et assurent leur promotion, or tous les grands musées mettent en valeur une majorité d’artistes masculins. Les conséquences sont immenses : leur cote grimpe sur le marché, la valeur financière de l’œuvre valide le talent aux yeux du public et des collectionneurs.ses. Le tour est joué, si l’on ne fait pas partie du boys club, on est sous-représentée, sous-évaluée, sous-cotée, sous-payée… la moitié des artistes sont des femmes mais elles représentent aujourd’hui moins de 10% des 500 artistes les plus chers au monde[2]. Et voilà qu’on a vite fait de devenir périphérique :
« Elle avait participé à des expositions collectives (…). Elle avait même vendu en France. Ça avait duré plusieurs mois. Et puis il y avait eu un creux. Un vent contraire, quelque chose d’empêchant. Quelque chose qui la maintenait toujours un peu dans l’action, mais jamais vraiment dans l’événement. Elle était devenue périphérique, et ça s’était fait sans douleur. »
Même si l’histoire de Petra et Peter se révèlera au fil de la narration pleine de nuances, le spectre des couples d’artistes célèbres plane sur le roman. Camille Claudel spoliée par Rodin et finissant sa vie à l’asile, Margaret Keane pillée par son mari[3], et bien sûr, toutes les femmes de Picasso/le Minotaure, brillantes artistes pour la plupart, à l’instar de Dora Maar ou Françoise Gilot, condamnées à survivre dans l’ombre de l’ogre. Si vous avez le cœur bien accroché, écoutez l’éclairant épisode « Picasso, séparer l’homme de l’artiste », du podcast de Julie Beauzac Vénus s’épilait-elle la chatte ? qui permet de relire la figure de l’artiste hégémonique sous un jour nouveau.
L’histoire du roman : une mise en abîme terrifiante
La Femme périphérique est aussi un roman au destin singulier, qui donne tristement raison à l’adage selon lequel la réalité dépasse bien souvent la fiction. Sophie Pointurier a d’abord envoyé son roman à de nombreux éditeurs. Loin des réponses-type auxquelles se heurtent la plupart des aspirant.e.s à l’écriture, certains retours furent détaillés et terriblement violents : on lui conseille d’arrêter d’écrire tout simplement. Elle s’y résout dans un premier temps et met son manuscrit de côté jusqu’à ce que le confinement fasse ressurgir le désir de publication. En se souvenant d’une conférence de son amie Marie Docher, photographe ayant longtemps exercé sous un nom d’homme et militante au collectif La Barbe, l’autrice ose le canular et tente le tout pour le tout : elle se choisit un pseudonyme masculin, la vieille ruse des femmes artistes dont George Sand restera éternellement l’étendard. Une photo retouchée plus tard, l’illusion est parfaite : ainsi travestie en un Gari Kouderc de pacotille, Sophie Pointurier publie son roman sur la plateforme Librinova. Les retours sont tout autres que lors de sa première tentative…On félicite l’auteur qui fournit un travail historique conséquent, qui maîtrise les codes du polar et qui ajoute une touche de féminisme de bon aloi à l’ère post #MeToo. Des éditeurs contactent Gari/Sophie qui finira par publier sous son vrai nom ce formidable premier roman.
Voilà où on en est. Et George Sand qui doit se retourner dans sa tombe.
Alors, si nous étions des hommes, combien de portes fermées s’ouvriraient à nos sexes imaginaires ? N’attendons pas, allons-y au pied de biche et faisons la peau à ces verrous qui n’ont, hélas, rien d’imaginaire.
[1] Valérie Solanas est l’autrice du SCUM Manifesto, pamphlet féministe radical. Soupçonnant Andy Warhol de comploter contre elle pour s’approprier son travail, elle se rend armée à la Factory le 3 juin 1968 et lui tire dessus, le blessant grièvement. Elle est alors condamnée à trois ans de prison et de soins psychiatriques.
[2] Ces données sont tirées de l’interview d’Alain Quemin par Marie Docher, « Art contemporain et femmes. Ce que le sexe fait aux artistes. » qui a inspiré une séquence vidéo du roman.
[3] Le film de Tim Burton, Big Eyes, en 2014 retrace son histoire.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.