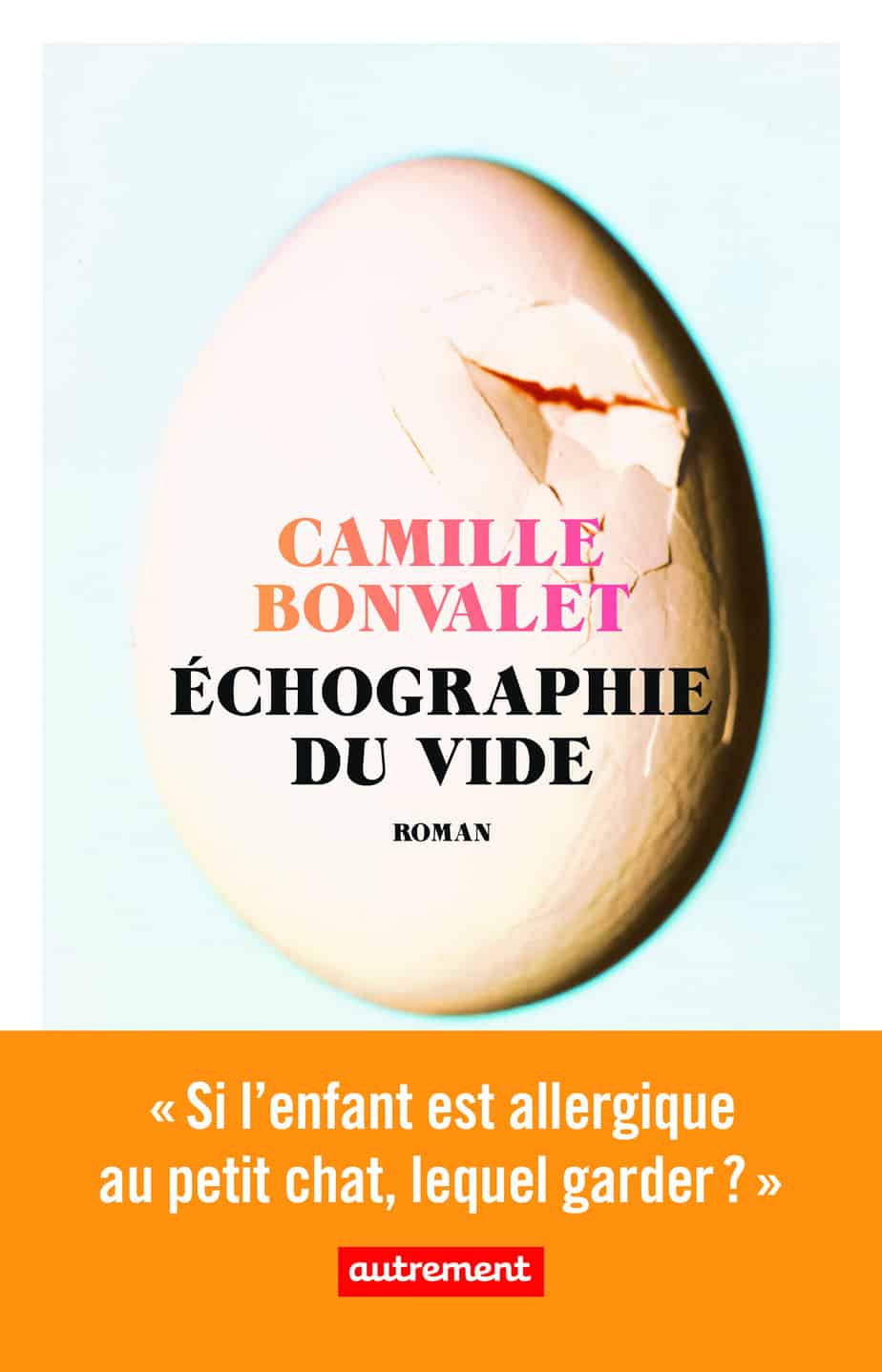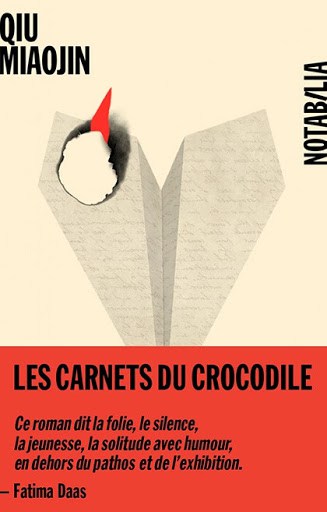Emmanuelle est une jeune femme moyenne, à l’intelligence moyenne, à la vie professionnelle moyenne, elle boit, elle sort, elle a un petit chat, elle fait des recherches Google – bref, elle est normale. Mais elle a pris une décision qui n’entre pas dans toute cette banalité : elle va se faire ligaturer les trompes. Ce roman s’ouvre sur un sexe ouvert pour mieux suivre les enjeux qui s’y cachent pendant les 4 mois de réflexion imposés par la loi. Camille Bonvalet, à travers une série de portraits (la meilleure amie bourgeoise et mère, la boss maternaliste, la vieille voisine saltimbanque, l’ancien copain de collège militant « pour la vie », les parents vieillissants), de situations d’injonctions et de scènes du quotidien, tresse habilement les fils sournois d’une société qui fait tout, ouvertement ou de manière totalement fourbe, pour décourager les femmes à renoncer à la maternité. C’est aussi le portrait sans complaisance d’une jeune femme tour à tour touchante et peu sympathique, lucide et paumée, bienveillante et cruelle, qui ne veut qu’une seule chose : qu’on respecte sa liberté. Parce qu’encore aujourd’hui comme hier, il est impossible pour les femmes de vivre leur sexualité comme les hommes, avec désinvolture, décontraction, insouciance – et cette phrase résume très bien le livre et la vie de beaucoup d’entre nous : « Comme si, en soi, le sexe, pour une femme, c’était gai. » Ce roman se lit vite, et même s’il m’a été compliqué de m’identifier à Emmanuelle, nos expériences, nos questionnements, nos frustrations, nos colères et nos aspirations se rejoignent : ça fait du bien de croiser dans la littérature des portraits justes de femmes.
Florence Porcel – Pourquoi avoir choisi la thématique du non-désir d’enfant pour votre premier roman ?
Camille Bonvalet – Je voulais depuis longtemps écrire un roman sur la norme, et particulièrement celle que l’on impose aux femmes, aux « jeunes femmes » particulièrement, dont je fais partie. Parmi toutes les injonctions, celles à la minceur, à la beauté, à la performance, à l’amour, à la reproduction, j’ai réfléchi à celle qui selon moi était au sommet de la pile : l’injonction à la reproduction. Combien de fois dans ma vie je me sens sentie envahie par des questions sur mon intention jamais remise en cause d’avoir des enfants. J’ai voulu questionner cette fameuse absurde théorie de l’instinct maternel en usant moi-même de l’absurde dans certaines situations de la vie d’Emmanuelle.
FP – Tous les personnages féminins autour d’Emmanuelle sont soit des mères, soit ont un comportement de mère avec elle (sa boss, en l’appelant « Choupette »). Est-ce un choix délibéré ?
CB – Étant donné qu’Emmanuelle évolue dans un milieu normatif, plutôt conservateur, il me semblait plus plausible que tous les personnages qui l’entourent se soumettent à l’ordre dominant. Or, l’ordre dominant, dans les milieux hétéro-bourgeois-catholiques, c’est : se mettre en couple, cohabiter, se marier, puis accéder à la propriété, et à la parentalité (dans cet ordre-ci). Bien sûr, j’aurais aimé écrire un roman plus mixte, plus inclusif, avec des personnages plus libres, mais ce n’est pas ce qui correspondait au milieu que je voulais décrire : un milieu plein de règles. Audrey, la boss qui l’appelle « choupette », est aussi très normée (c’est sans doute la plus normée de toutes). C’est la cheffe, la boss, donc elle considère qu’elle doit diriger comme une cheffe, une boss. Pour elle, diriger comme une boss, une cheffe, c’est être maternaliste. Tous mes personnages, sauf Emmanuelle, agissent plus ou moins selon ce qu’on attend d’eux, ils jouent leur jeu social sans jouir pour autant de leur conditionnement.
FP – En arrière-fond du roman, se trouve la peur de la vieillesse : les descriptions pleines d’inquiétude des parents et des beaux-parents d’Emmanuelle, d’autres implacables de certains corps vieux ou vieillissants, celle de ses amis devenus parents auxquels elle ne veut jamais ressembler, les personnes admirées qui ne vieilliront jamais (Lady Di, le frère)… Était-ce une thématique que vous vouliez consciemment traiter, ou vous est-elle apparue malgré vous par le biais de votre personnage ? Ou bien est-ce une analyse qui m’est propre et que vous découvrez ?
CB – Oui, c’est une très belle analyse que je n’avais pas conscientisée. Je crois que plus que la peur de la vieillesse, c’est de la trace que l’on laisse dont j’ai voulu parler. Dans le roman, Emmanuelle pense beaucoup à « comment devenir quelqu’un », et je crois qu’elle le fait parce que ne prévoyant pas de descendance, elle a peur de disparaître. Peu à peu, quand on est une femme, on est évincée de l’espace public, et moins regardée, et moins représentée dans les films, dans les publicités, dans les magazines. Et lorsque l’apparence a été importante, il faut trouver une manière de se réinventer. Tous mes personnages apprivoisent différemment leur vieillesse : Olga, pour laisser une trace, peint, même si elle n’est pas très douée pour ça. La mère peaufine sans arrêt son apparence pour se laisser encore un peu de temps pour exister aux yeux du monde. Victoire se jette à corps perdu dans son rôle de mère. Le père, lui, n’a eu le temps de rien puisqu’il a perdu la mémoire suite à une rupture d’anévrisme. Emmanuelle, elle, idéalise les personnes qui n’ont pas eu le temps de vieillir et donc pas eu besoin de se compromettre pour laisser des traces dans le monde.
FP – En plus des injonctions à la maternité (puisque c’est le sujet du roman), vous décrivez tout ce qui fait partie de la vie d’une femme : les réflexions déplacées de soignant·e·s et d’hommes plus hauts placés hiérarchiquement, le rapport à la sexualité, au travail, au numérique… Vouliez-vous tout autant faire le portrait d’une jeune femme de votre génération que d’une jeune femme qui ne désire pas d’enfant ?
CB – Oui, même si c’est au fil de l’écriture que les thèmes du rapport au corps, à l’esthétique, au travail, au numérique sont apparus. Je crois que c’est parce qu’au fond, les uns sont liés aux autres : il s’agit du processus de domestication du corps des femmes dont tous sont les leviers. Je n’ai pas commencé ce roman en ayant pour intention de portraiturer ma génération mais j’ai écrit sur des choses qui m’étaient proches, et c’est une partie de mon propre rapport au monde qui a émergé à travers Emmanuelle.
FP – Étant moi-même autrice, je sais qu’un texte publié n’est jamais le même que la première version proposée. Dans le processus de travail avant publication, avez-vous eu des deuils à faire ? Des éléments ajoutés, ou une direction prise que vous ne soupçonniez pas ?
CB – Cette version est en effet loin d’être la première. Dans le processus d’écriture, en général, je jette beaucoup et je recommence presque à zéro à chaque fois. Je crois que cette version est peut-être la vingtième entièrement réécrite de mon texte. Je suis passée par plusieurs étapes. Au début, mes ébauches étaient beaucoup plus vindicatives, plus empreintes de colère. Puis, j’ai appris à connaître mes personnages, et donc à les comprendre et à les aimer. J’ai affiné leurs traits et j’ai essayé de disparaître pour leur laisser davantage de place. Dans la plupart de mes versions précédentes, aussi, je prenais garde de façon presque névrotique à éviter tous les clichés qu’on associe généralement aux femmes qui ne veulent pas d’enfants. Par exemple, le petit chat voulait entrer dans mon texte, mais à chaque fois, je le repoussais, car je ne voulais pas prendre le risque qu’on réduise Emmanuelle à une fille-à-chats-incapable-de-s’attacher-au-genre-humain-et-donc-non-mère-car-elle-est-folle.
« Échographie du vide », de Camille Bonvalet, éditions Autrement, en librairie le 15 janvier 2020

Florence Porcel est autrice, actrice et animatrice. Elle travaille surtout dans le milieu de la vulgarisation scientifique et intègre toujours une réflexion féministe à ses activités. Après avoir été animatrice sur France 5 et France Inter, elle a publié trois livres et une bande dessinée.