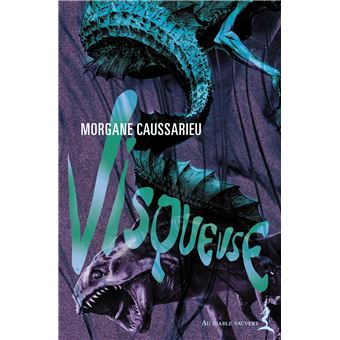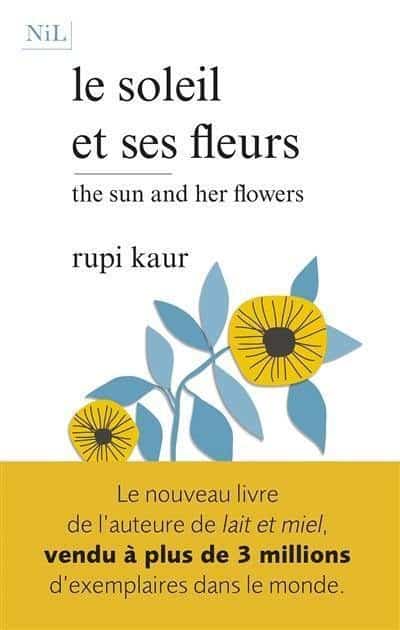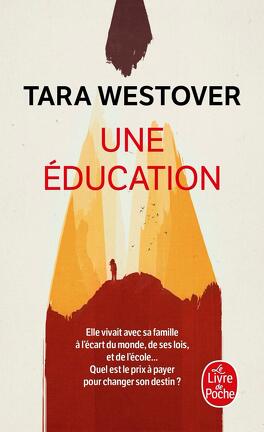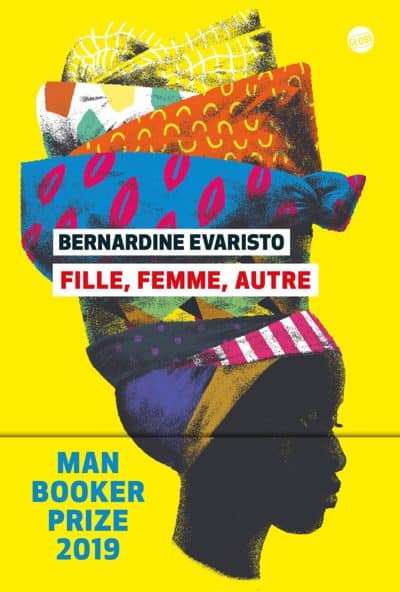Claude a la quarantaine, le SMIC, un fils et le spleen. Elle vivote en région parisienne à l’heure des bilans de milieu de vie qui pèsent sur la poitrine et semblent entraver les voies respiratoires. Jusqu’au jour où elle repère une annonce sur le Net, un hameau entier et à l’abandon à vendre dans le Tarn, il n’en fallait pas plus pour relancer la machine à rêves.
Comme dans son premier roman, La Femme périphérique, également publié aux éditions Harper Collins, Sophie Pointurier emprunte au genre du roman policier. La narration alterne deux temporalités : un aujourd’hui qui voit Claude blessée, soupçonnée et interrogée par la police, et un hier qui tente de reconstituer la genèse des événements qu’on comprend violents et irréversibles.

Amitiés et familles choisies
Comme son titre ne l’indique pas, Femme portant un fusil est d’abord un roman d’amitié, thème boudé par la littérature s’il en est. Pour réaliser son projet, Claude cherche à s’entourer de femmes avec qui se lancer dans l’aventure : une vie communautaire, un brin en retrait du monde, les mains dans la terre. C’est d’abord Élie qui la rejoint, rencontrée fortuitement autour d’une désespérée dans la queue de la boulangerie. Âgée, elle a vécu l’expérience des communautés lesbiennes aux États-Unis et ailleurs. Suivront Harriet l’écossaise au parler dégenré, présidente du Kate Bush Project, puis Anna, la plus jeune, militante féministe parfois jargonnante qui s’enlise dans sa thèse. Chaque personnage est l’occasion de beaux portraits en touches délicates, Sophie Pointurier dit les silences, ce qu’on devine, les interstices du langage, la tendresse, les gestes empêchés, les élans d’amour qui unissent ces amies débarrassées des hommes. On les devine toutes un peu cabossées par la vie et l’hétéropatriarcat n’est pas étranger à leurs blessures. Sans fracas, le roman dit aussi ce refus de se soumettre aux regards des hommes :
« Il n’y a rien de pire au monde que passer pour une femme qui déteste les hommes. On peut être raciste, antisémite, violeur ou bouffeur de bébés que les hommes nous le pardonneraient mieux qu’une suspicion de misandrie. (…) Pourtant, je ne les déteste pas, moi, les hommes. Je m’en passe, c’est tout. Depuis que j’ai décidé de vivre en dehors de leur société, de leurs regards, ma vie a changé, le quotidien s’est apaisé et mon corps tout entier a enfin commencé à respirer. »
Ce choix de l’amitié n’est pourtant pas exclusif et ne constitue pas un geste de rupture qui mettrait la famille à la poubelle. Même l’ex, qui pourrait donner lieu à la caricature facile, est nuancé. Sophie Pointurier écrit la réconciliation, qui n’a rien à voir avec le compromis, la résignation ou le sacrifice. Quant au fils de Claude, Lenny, il est partie prenante dans l’aventure, adolescent qui ne se retrouve pas complètement dans les injonctions faites à son genre. Dans l’économie du roman, il donne aussi l’occasion de réfléchir à ce que c’est qu’éduquer un garçon quand on est une femme qui s’est lassée des rapports de force et mécaniques de pouvoir binaires :
« Avoir un garçon est une expérience qui oblige à regarder de l’autre côté tout en ne perdant pas son angle. J’ai toujours envisagé Lenny comme un prolongement étrange de moi-même, un être qui allait, malgré tous mes efforts, appréhender le monde d’une façon que je ne connaîtrais jamais, simplement parce qu’on n’appartient pas au même groupe social. (…) Je sais l’enfance, mais je ne sais pas ce que c’est d’être un petit garçon de cinq ou dix ans. Je sais l’adolescence, mais pas les effets de la puberté dans un corps de garçon. Je ne connais pas non plus la pression sociale, la pression du groupe, l’injonction à être un mec, ni comment ils se traitent entre eux. Je devine ce qui se trame autour de la virilité, les efforts déployés à masquer la moindre émergence de vulnérabilité, et je lui en parle. Du moins, j’essaie.
Moi je sais les copines, l’angoisse du corps, les formes qu’on redoute autant qu’on déteste. Je sais les « Souris et tiens-toi bien », le plafond de verre ou les « Sale pute ». Nos communautés de destin diffèrent et se rejoignent par endroits, alors on discute pour bouger les lignes. C’est comme si j’observais sa vie sur le pas de la porte, et c’est curieusement dans cette distance qu’on trouve notre complicité, parce que Lenny et moi on s’entend et on avance tous les deux comme ça. On se traduit à vue. »
L’expérience de la communauté
Le projet de Claude aboutit et donne lieu à un joyeux mélange de générations, de partage d’expériences et de mises en commun des savoirs et des compétences. Sur le vaste terrain, les personnages se lancent dans le chantier de réfection des maisons plus ou moins vétustes tout en travaillant la terre alentour. On les voit mettre leurs corps en jeu, s’adonner aux tâches les plus physiques, questionner les charpentes, clouer, visser, scier, douter, se tromper, s’encourager, transmettre, apprendre ensemble et contempler heureuses le fruit du labeur collectif, assemblée hétéroclite de Wonder Women qui ont bâti leur Paradise Land de leurs mains. Les béguines sont évoquées, ces femmes qui ont expérimenté dès le Moyen Âge la vie communautaire libérées du joug masculin sans totalement se remettre entre les mains de l’Église. Certaines furent condamnées au bûcher, sorcières désignées menaçant l’ordre social par leur refus de s’y soumettre. Élie traverse les siècles en assénant : « quand tes béguines se sont arrêtées, les gouines ont pris le relais. », et nous voilà dans l’Oregon des années 70, où fut créé l’Oregon Women’s Land Trust, première fiducie foncière pour femmes (voir les références bibliographiques passionnantes qui permettent d’accéder aux témoignages de ces femmes qui se sont unies pour acheter des terres et créer des communautés indépendantes, dont certaines sont toujours en activité aujourd’hui). Inspirées de toutes ces expériences passées, Claude et ses comparses sont bientôt rejointes par de nouvelles recrues. Beatriz, ancienne membre de l’ETA ayant séjourné en prison, transporte avec elle toute une lignée de révolutionnaires méconnues ou oubliées, comme la Commandante Ramona, figure majeure du zapatisme au Chiapas, Petra Herrera, Blanca Canales, autres figures qui n’ont pas rechigné à prendre les armes lorsqu’elles l’ont jugé nécessaire pour protéger leurs corps, leurs familles, leurs terres. Élie insiste : « Il faut écrire les biographies, Claude, il faut écrire les histoires. ». C’est ce que fait Sophie Pointurier, convoquer les femmes qui ont lutté dans le passé et qu’on a bien souvent réduites à des folles ou à des amoureuses manipulées, sans reconnaître leur agentivité politique. Se souvenir qu’on n’hérite pas que d’un statut de victime mais de luttes victorieuses, parfois. L’autrice brasse ainsi divers courants des féminismes actuels et passés. Point de pureté militante ici, chacune trouve sa place avec ses références et ses angles morts : les anciennes sont gentiment moquées car elles ne maîtrisent pas le langage ni les concepts d’aujourd’hui, les jeunes militantes sont remises à leur place quand elles débarquent avec leur « féminisme de récitation ». Si Claude est sceptique concernant le « féminin sacré » et la touche ésotérique dont est nimbée Élie, elle accueille sans arrogance l’altérité. Réconciliation, toujours. Il y a de la place dans ce roman pour un spectre assez large de féminismes (pas tous quand même hein, Marlène Schiappa n’est pas invitée non plus).
L’usage de la violence
Tout ça pourrait continuer tranquillement en donnant simplement aux lecteurices une sacrée envie de demander l’adresse, de sauter dans un train et de les rejoindre pour se frotter à l’expérience du chantier participatif, Kate Bush en fond sonore – c’est l’obsession contagieuse de l’inénarrable Harriet – . C’est sans compter la violence qui les rattrape. Le voisin Michel, curieux, circonspect puis menaçant. Un podcast plus tard, destiné à expliquer leur projet, la machine médiatique s’emballe, les réactions des haters aussi, elles qui cherchaient à vivre peinardes retirées du monde se retrouvent scrutées, commentées, auscultées, nimbées d’une aura de scandale (vivre entre femmes, quelle idée ! Elle sont peut-être même lesbiennes, tiens donc). Peu à peu, le sujet du féminicide s’invite dans le roman. Discrètement d’abord, quand Claude enthousiaste montre à son fils le film Mauvais Sang et s’aperçoit que l’œuvre tant aimée contribue à la romantisation du meurtre de femmes. On pourrait lister les références à n’en plus finir : les femmes mortes font de bonnes histoires, et tant pis si ça nous fout la nausée. Et tant pis si ça pénètre nos inconscients si fort que grandi.e.s, hommes et femmes ont intégré dans le logiciel qu’infliger des souffrances par amour, c’était banal. Et même, sans doute une preuve d’amour. Le roman pose alors des questions essentielles : que faire face aux féminicides ? Quelle alternative à la justice d’État qui ne fait malheureusement pas assez, pas bien son travail ? Y a-t-il un usage légitime de la violence ? L’autrice ne se pose pas en spécialiste de la question, en théoricienne sûre de son fait, mais l’art du roman, la confrontation des points de vue des personnages, permettent d’envisager des pistes de réflexion diverses et fertiles.
Pour finir, et parce que la joie, la danse et la musique sont de puissants outils de résistance, en attendant l’organisation du Kate Bush Festival sorti des pages du livre pour nous réunir dans la vraie vie, je vous engage à bosser la chorégraphie de Wuthering Heights !

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.