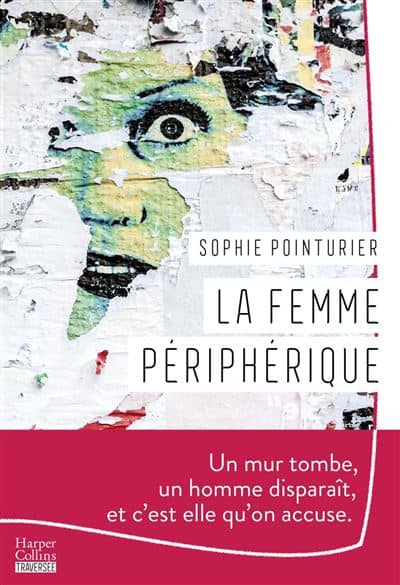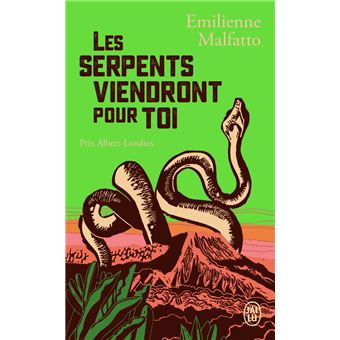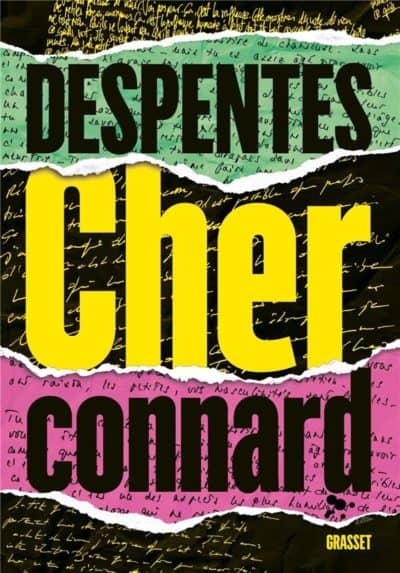Aussitôt sorti (la même année qu’American Psycho de Bret Easton Ellis), aussitôt frappé d’une demande d’interdiction au Parlement londonien, Dirty week-end a scandalisé quelques langues puritaines lors de sa publication en 1991. Ce qui a déplu ? la crudité des scènes de violence et l’impossibilité de s’imaginer une femme semant la mort sans état d’âme. Attention, conte apocalyptique pour public averti.

Bella, un corps qui appartient à tous
Bella est le type même de la femme éteinte, absente à sa vie, qu’on remarque à peine et qui pourrait étouffer et hurler en silence à nos côtés sans qu’on la remarque un seul instant. Malgré tous ses efforts pour prendre le moins de place possible au monde, pour se dissoudre dans les autres et se terrer au sous-sol d’un immeuble sordide dans son appartement de Brighton, elle continue d’être rappelée à une loi éternelle, une loi qui, un matin, lui devient insupportable : elle ne s’appartient pas. Son corps est la propriété des hommes, « une communauté originelle » ; ce sont eux qui décrivent, classent, mesurent, jouissent de son corps et le plient à leurs désirs. Son voisin peut la harceler, l’épier de sa fenêtre, l’appeler pour la faire trembler en lui détaillant les abominables sévices qu’il souhaiterait lui infliger ; Stan l’armurier peut lui faire subir son verbiage raciste empreint de jalousie virile ; Norman lui imposer un assaut sexuel honteux, et tant d’autres encore… La prise de conscience ce vendredi matin, veille de week-end, est brutale :
« Vous possédez uniquement ce que vous pouvez défendre et si vous ne pouvez pas le défendre, vous ne le possédez pas. »
L’arrêt est définitif, sans jugement. Dès lors, plutôt que d’opter pour une mort décente – un banal suicide aux barbituriques qui n’embêtera personne – Bella, la discrète, l’effacée va là où personne ne l’attend : elle se cuirasse, elle s’arme. Déesse de la vengeance, Sekhmet à tête de lionne, redoutée et adorée, elle va déchaîner une vague de violence sans précédent le temps d’un week-end dans la petite station balnéaire familiale, histoire de rétablir l’équilibre du monde. Il s’agit d’être efficace. Tempête après le calme, châtiment divin après l’impiété, apocalypse après le royaume terrestre et ses turpitudes, le roman d’Helen Zahavi fait le grand ménage au son d’un grand carnage.
On attendait les cavaliers de l’apocalypse mais c’est Bella qui se dresse au fond d’une ruelle dans les phares d’une voiture au moteur ronronnant, drapée des remugles des eaux croupissantes, prête à dézinguer en série avec son six-coups automatique. Et si dans Kill Bill, Uma Turman rayait les noms d’une liste sanglante mûrement réfléchie, et mettait au bout de son sabre traîtres et oppresseurs de son passé, Bella fait davantage dans la justice préventive : elle élimine sur un soupçon – souvent justement fondé – avant le passage à l’acte.
Un corps sans épaisseur
Helen Zahavi ne s’encombre pas d’un romanesque psychologisant de roman de gare, et préfère expédier en deux pages le curriculum vitae de Bella : issue d’une famille de classe moyenne aimante et modeste, elle n’a subi aucun traumatisme particulier. Aucune rugosité ne pourrait venir dramatiser la suite démesurée de l’histoire. L’émigré iranien Nimrod, qui fait office d’éclaireur de conscience, cherche en vain à en savoir plus sur ses racines et n’obtiendra que ce constat acide et laconique sur les parents de Bella :
– Ils mangent beaucoup de fruits, ils n’ont aucune imagination, mais bien évidemment, ils m’adorent. Je suis leur bébé. L’incarnation vivante de leur amour. La garantie de leur immortalité.
Elle s’interrompit et emplit sa bouche du liquide sucré et épais qui adhérait à ses dents.
– Ils habitent en banlieue, ils vont dans le Devon une fois par an, ils lisent le Daily Mail et ne disent jamais de gros mots.
Rien à voir, circulez ! ne pensez pas trouver dans le texte de longs développements sondant les tourments de l’âme. La banalité de la vie de Bella est un outil romanesque parfait : cette femme est un récipient vide qu’on remplit comme les hommes sous lesquels elle s’est prostituée l’ont remplie, comme les hommes qu’elle croise le temps d’un week-end la remplissent de leurs fantasmes et de leurs projections perverses. Alors, au pied du mur, Bella doit choisir entre la voie de la victime, celle qu’elle a déjà tant empruntée et la voie de la meurtrière, inédite celle-là. L’agneau qui excite l’appétit des bouchers n’en peut plus de faire saliver ces masses ondulantes et luisantes qui s’avancent vers elle avec leur virilité mal placée. Ce sera le temps du couteau après celui de la plaie.
De pauvre petite chose terrée, à la merci des traqueurs, elle s’enfle, se travaille et s’étend si bien qu’à la fin… non, elle n’éclate pas mais plane sur la ville dans sa démesure divine. Dans la culture juive, la figure légendaire du Golem, géant bâti de terre glaise, fut inventée pour défendre les Juifs assassinés lors des pogroms ; cette créature sans âme qu’on renvoie à la terre en effaçant la première lettre de son nom, inscrit sur son front, n’est pas sans rappeler le vœu de Bella à Nimrod : « Arrachez mon cœur et mettez une pierre à la place. J’ai un désir de vengeance ». Extraire l’humanité de son corps et se voiler dans l’indifférence face aux hommes ligotés, suppliciés à terre, qui rassemblent inutilement les bouts de membres qui s’envolent autour d’eux et les étreignent désespérément.
Un miroir de leur âme
Chaque homme que Bella croise semble condamné d’avance à son courroux et peu en réchappent. Que voulez-vous, ils parlent trop. Bouffis d’assurance, ils déblatèrent en toute inconscience et dégueulent leur haine du féminin sur la robe en lamé de Bella qui sourit poliment jusqu’à la fin de la tirade. Elle sourit et leur renvoie leurs mots dans des dialogues où la forme interrogative devient l’outil de la mise à jour de l’identité du dominant en puissance. Elle leur offre un boulevard de liberté d’expression et ils s’y engouffrent de façon jubilatoire. Bella tend aux hommes le miroir « sinistre »[1] de leur âme, cher à Baudelaire.
« Elle était en présence d’un intellectuel, et quand elle entend le mot intellectuel, elle sort son pistolet.
– Êtes-vous professeur, Norman ?
– Oui – il vida son verre d’un trait. Une sorte de professeur.
– Qu’est-ce qu’ « une sorte de professeur », Norman ?
– Quelqu’un qui aurait dû être professeur. Quelqu’un qui, sans les réductions budgétaires, aurait été professeur. Une « sorte de professeur », ma charmante petite indiscrète, c’est un professeur auquel il ne manque que le titre.
– Je vois. […] donc vous êtes professeur.
Il semblait agacé.
– Je ne suis pas vraiment professeur. Je suis presque professeur.
– Donc vous n’êtes pas professeur.
– Si vous tenez à être précise, si vous tenez à être exacte, si vous tenez à être pédante, non, je ne suis pas professeur. Je suis maître-assistant au sommet de l’échelle, et donc « virtuellement » professeur.
– Je l’ignorais, Norman.
– Maintenant vous le savez. »
On ne peut que jubiler devant tant d’entêtement à la fatuité, si commune au monde de la carrière des honneurs et si souvent réservée aux hommes. Bella, l’ingénue, s’amuse avec sa proie, puis l’accule dans les recoins du langage dont il ne ressortira pas, peu importe le nombre de guillemets ou d’italiques que le maître entend utiliser pour échapper à la honte du déclassement.
Mais, tandis que, chez Baudelaire, le dégoût naît de sa propre image au point qu’il s’inflige lui-même la correction qu’il mérite (il blesse la femme aimée), Bella endosse celle du bourreau et châtie longuement, avec application, en ménageant l’art de la variation.
Un conte tout simplement
Si Dirty week-end questionne la possible représentation de la violence des femmes en littérature, il serait réducteur d’en faire une lecture littérale. Ce n’est pas un guide d’auto-défense à l’usage des opprimées, ou une apologie de la violence gratuite dans un monde sans repères. A mon sens, le pouvoir de la fable vient de son droit à l’excès, à la démesure ; c’est ce qui lui octroie sa dimension mythique, universelle. Le roman, loin de se réclamer d’une veine réaliste, convoque plutôt l’esthétique de l’avertissement. Aristote écrivait que le théâtre doit faire pitié et peur tout à la fois, de même Dirty week-end doit faire trembler par la peinture terrifiante des violences déchaînées sous nos yeux. Personne n’espère incarner Bella, personne n’aspire à croiser son chemin fatal ; néanmoins, son ombre continuera de nous suivre après avoir refermé le livre. Certes Bella est un personnage de papier, une Erinye rejaillie des temps antiques, mais elle pourrait s’incarner pour donner son baiser mortel à ceux qui convoitent le corps des femmes. Rappelle-toi, Bella peut surgir, elle peut revenir…
[1] Je te frapperai sans colère / Et sans haine, comme un boucher, / Comme Moïse le rocher ! / Et je ferai de ta paupière, // Pour abreuver mon Saharah, / Jaillir les eaux de la souffrance. / Mon désir gonflé d’espérance / Sur tes pleurs salés nagera, poème de Baudelaire, L’héautontimorouménos.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.