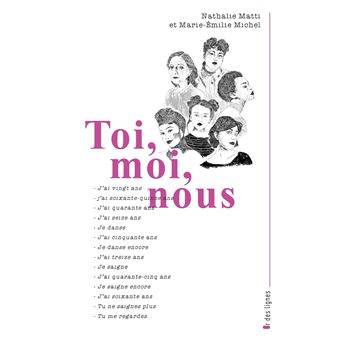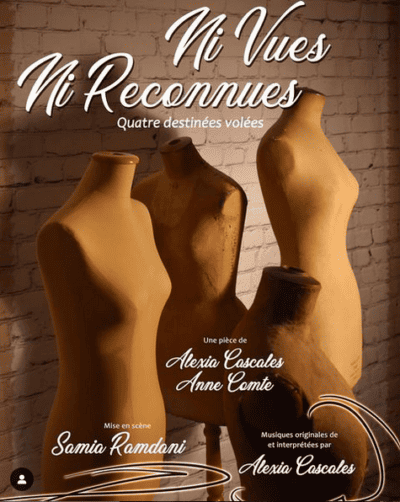Jeudi soir au Bal Blomet dans le 15e arrondissement de Paris, nous n’étions plus certaines que les ombres portées au-dessus de la scène, s’étirant sur les briques du mur de la salle de concert étaient bien celles des musiciens et de la chanteuse Marion Rampal, venu.es présenter leur album Song for Abbey, sortie jazz attendue, et leur concert femmage à cette grande figure du monde du jazz que fut Abbey Lincoln disparue en 2010. Deux heures durant, l’air vaporeux se chargea des âmes mystiques et les fit tournoyer sur nos têtes : Billie Holliday, Miles Davis, Maya Angelou, Archie Shepp, Max Roach, Bob Dylan, compagnons de route mélodique convoqués pour ressusciter celle qui fascina un temps Hollywood ; Abbey Lincoln, comédienne sublime, rivalisant de beauté avec Norma la blonde, surnommée la « Black Marylin », puis chanteuse talentueuse au répertoire grandiose, jusqu’à l’autrice de la maturité, révélée à soi-même par un long cheminement, toujours à l’écart des industries dévorantes de la musique et des producteurs engloutisseurs de jeunes corps. Toute une vie de création à revisiter et à faire connaître au grand public peu habitué de ce nom : Abbey Lincon. Marion Rampal a bien voulu nous éclairer sur ce défi qu’elle a relevé, profitant de sa résidence à Coutances, et de sa rencontre avec des collégiens qui ont nourri sa quête et lui ont permis d’affermir les axes de son travail d’artiste qui reprend, sans « singer », une voix incontournable qu’il serait temps d’intégrer aux Real Books, ces volumes qui accompagnent les musicien.nes de jazz et où ils et elles puisent des kilomètres de mesure pour savoir improviser en toutes circonstances.

Abbey Lincoln, la voie de l’émancipation
Marion Rampal a 19 ans quand sa mère lui offre le CD « Wholly Earth » d’Abbey Lincoln, immédiatement frappée par la puissance évocatrice de la voix, elle différera pourtant le moment de la vraie rencontre avec cette artiste et attendra plus de vingt ans pour avancer jusqu’à elle, un temps de maturation nécessaire pour qu’une femme en rejoigne une autre dans son intimité musicale. Au début de sa résidence en Normandie, Marion Rampal part à la recherche de documents biographiques mais cela tourne court : l’autobiographie d’Abbey Lincoln, confiée d’abord à son ami et producteur français Jean-Philippe Allard, a changé de main et dort probablement dans un tiroir du frère d’Abbey à qui elle échoit finalement. Une longue interview, en 2003, sorte de compilation de témoignages réalisée par Sally Plaxson, donne les clés de lecture à Marion Rampal, convaincue que la chanteuse, malgré une vie chaotique entre solitude et alcool, poursuivait un objectif immuable, sans compromis : une quête de liberté totale. Impressionnante dans sa détermination à chérir l’authentique, à combattre les clichés et les rôles sur mesure qu’on attend que les chanteuses américaines endossent entre paillette et hypersexualisation, Abbey Lincoln a déjoué les pièges, renoncé aux gloires faciles qu’elle aurait pu embrasser, préférant protéger son désir d’émancipation illimité. Les faux-semblants du cinéma, très peu pour elle ; elle brûlera d’ailleurs sur les conseils de son mari Max Roach la robe rouge qu’elle portait dans les cocktails de sa période star des red carpets, pressée d’en finir avec l’image lisse et fade de l’actrice noire américaine, jolie à regarder, vite passée de mode, vite remplacée. Marion Rampal, en rapportant cette anecdote, ne peut s’empêcher d’y voir le geste d’une volonté d’indépendance affirmée, comme si elle jetait dans l’incinérateur la robe et le symbole d’une industrie largement dominée par une culture bourgeoise blanche. Pour autant, Abbey Lincoln ne peut se laisser résumer à une combattante pour le mouvements des droits civiques qu’elle a pu incarner par moments. Femme aux amours libres, sans enfants, divorcée, elle ne cesse de surprendre par son audace, et une oeuvre prolifique.

Marion Rampal, pourquoi avoir choisi le Bal Blomet pour ce concert ?
Je voulais une salle où il était possible de programmer le concert plusieurs soirs de suite et malgré l’étiquette « bourgeoise » de ce club du 15e arrondissement, la proposition de Jazz Magazine qui voulait que cela ait lieu au Bal Blomet, dont l’héritage mémoriel certain est indiscutable, a emporté notre adhésion. Le côté club de jazz afro antillais des années folles semblait indiqué pour l’hommage qu’on voulait faire à Abbey Lincoln. C’est très important pour moi de rendre à un moment de ma carrière ce que je dois à la musique noire américaine qui a formé l’artiste que je suis aujourd’hui. Célébrer Abbey Lincoln et la faire connaître parce que personne ne la reprend vraiment, parce qu’on parle toujours de Nina Simone ou de Billie Holliday et qu’elle reste dans l’obscurité, c’est un double pari que j’ai fait. Au-delà de ce travail de mémoire, j’ai la sensation indéniable quand j’écoute les chansons d’Abbey, qu’elle nous parle, que ses chansons lui survivent et qu’on doit s’en faire les messagères. Carole Frideman a réalisé un documentaire « Music is the Magic » sur cette chanteuse en 2014 mais on attend toujours désespérément la suite.
Lors du concert, tu as chanté un morceau hybride mêlant passage parlé en français et chant anglais, c’est une composition d’Abbey Lincoln que tu as exhumée ?
Pas du tout. Il s’agit d’un collage, j’ai d’ailleurs beaucoup travaillé cette approche avec les collégiens de Coutances pour aborder l’univers d’Abbey Lincoln – les élèves ont réalisé des affiches fictives annonçant un concert d’Abbey Lincoln en 2025 à partir de cette technique -. C’est aussi une façon de créer une interprétation des chansons des autres sans les imiter : on entrecroise, on mélange et on trouve enfin la bonne tonalité, ici il fallait identifier l’accent féministe de l’oeuvre. Ce morceau part d’un poème qu’elle a écrit On being high qui parle de violence subie enfant et jeune femme dans les clubs, que j’ai traduit en français et mêlé à un autre texte, celui d’un compositeur des années 60 Tender as a rose, là-dessus a été posée une pièce de Max Roach, Driva’ man, qu’on a choisie de faire exister en tant qu’instrumental, parce que, contrairement à Abbey, je ne saurai pas endosser les paroles de Oscar Brown Jr. qui évoquent la souffrance et les peurs d’un esclave noir américain, sous le fouet d’un misérable patrouilleur blanc.
On retrouve sur « Song for Abbey » des musiciens familiers de tes albums précédents et de nouvelles têtes, comment ça se passe sur scène entre vous ?
C’est une chance inouïe pour moi de retrouver des musiciens avec lesquels j’ai bâti une entente intime, qu’on savoure avec une immense sensualité sur scène. On a pris un plaisir fou à laisser une grande place à l’improvisation dans nos créations, qui étaient moins présente sur nos collaborations précédentes. Matthis Pascaud tire des sons incroyables de sa vieille guitare des années 40, il a ce souci, par une économie minimaliste, de vouloir en sortir des notes puissantes, il a cette volonté de faire entendre les notes les unes après les autres. Tous ensemble, avec Thibault Gomez au piano, Simon Tailleu à la contrebasse et Raphaël Chassin à la batterie, on tisse comme des liens d’amour, en quête d’une harmonie parfaite. Tout se passe de façon très artisanale finalement ; on triture, on tâtonne, notre technicité se niche là.
Que retiens-tu de la philosophie qui traverse l’oeuvre d’Abbey Lincoln ?
Abbey Lincoln débute comme comédienne, elle est très attachée aux mots, elle est une grande amie de l’écrivaine Maya Angelou et lui écrit la chanson « Caged Bird » qui fait référence à son premier livre autobiographique Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage ; elle écrit aussi « Bird alone » à Miles Davis. Le thème de l’oiseau, évident symbole de liberté, est très présent dans sa musique car elle considérait que la musique est un espace où tout est possible : elle nous permet de fuir notre condition humaine, mais aussi les entraves sociales, les injonctions de genre. Après tout, elle pose une question essentielle dans le milieu du jazz à l’époque où elle performe entourée d’hommes exclusivement : qu’est-ce que cela implique d’être une femme et de chanter au milieu d’hommes ? Il faut voir combien le monde du jazz et du mouvement pour les droits civiques dans les années 60/70 reste très patriarcal, les femmes sont souvent reléguées à l’arrière plan domestique, elles soutiennent la lutte depuis leur foyer, quand les activistes eux sont dans la rue, sur scène ; Archie Shepp, éperdu de respect pour Abbey Lincoln plusieurs années son aînée, était particulièrement touché par cette inégalité de représentation. Pour elle, l’idée de liberté est indissociable de la recherche de l’harmonie entre les idées, les gens, les notes ; la musique propose d’organiser un monde où tous les sons doivent aller ensemble. Finalement, un lieu commun comme l’amour est très peu présent dans les chansons d’Abbey Lincoln ; elle parle davantage de relation, comme dans sa chanson la plus célèbre And i’ts supposed to be love. Quand Ayo, il y a quelques années, reprend la chanson d’Abbey Lincoln pour la remettre au goût du jour sur les conseils de Jean-Philippe Allard, le public ne saisit pas forcément que la chanson parle de violences domestiques et d’un corps qui frappe le sol dès les premières notes. Abbey Lincoln ne romantise pas la vie et elle ne craint pas de s’adresser à Dieu en disant « tu » quand elle ne chante pas la douceur du soleil. En résumé, pour elle, la vie, c’est comme une chanson à chanter, avec des montées et des descentes, et il ne faut rien en taire.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.