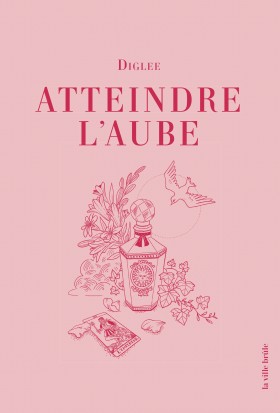Superbe couverture, maison d’édition aux publications alléchantes et sans nul doute Oscar du meilleur titre de l’année : Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok est un texte atomique à ne pas mettre entre toutes les mains. L’autrice, Michelle Lapierre-Dallaire, l’annonce dès l’introduction : « Je m’en viens montrer mon carnage. ». Elle propose une autofiction où rien ne nous est épargné de son enfance fracassée par la pédocriminalité. [TW ce texte aborde le viol, le suicide, les addictions et la maladie mentale]

Quand on s’adonne majoritairement à des lectures féministes, il arrive que l’ont soit gagnée par la mélancolie, voire même qu’on sombre dans le désespoir, tant les récits qui nous parviennent sont au mieux le reflet d’inégalités crasses et d’humiliations, au pire l’évocation d’un éventail de violences difficilement concevables.
La lectrice militante est parfois fatiguée et se prend à rêver de récits édulcorés ou mieux encore, de se départir un temps de ses fameuses lunettes féministes, celles qui ne lui font pas vraiment voir la vie en rose.
Et puis il y a Michelle Lapierre-Dallaire.
Qui n’est pas du genre à édulcorer. Les lunettes, elle ne les laisse pas traîner négligemment sur la table de chevet pour vous inciter à vous en servir. Elle vous les plante dans la face en vous gueulant dessus comme un putois et peut-être même avec une claque dans la gueule. C’est qu’elle n’a pas vraiment été élevée dans le coton. Et puis elle en a gros… urgence à dire, urgence à être entendue, urgence à libérer la parole, vider son sac, cracher les horreurs qu’on lui a faites, mettre à distance peut-être, sublimer par l’écriture, transformer la boue en or grâce aux mots qui réparent. Le bon vieux job de la littérature !
Ce premier roman retrace par bribes l’itinéraire d’une enfant horriblement maltraitée par des adultes défaillants, toxiques ou carrément criminels, et qui devient une femme écorchée. Celle qui déborde sans cesse des cases, qui parle trop fort, rit trop fort, pleure trop souvent, exhibe ses peines, aime trop vite, ne connaît ni l’apaisement ni la douceur, n’a pas appris « le bien-être calme de feu de camp » et recherche constamment « des feux d’artifice dévastateurs ». Michelle Lapierre-Dallaire dissèque à la tenaille les mécanismes de défense dont il est si difficile de s’extirper quand il a fallu survivre à son enfance, la difficulté d’aimer et de se faire aimer en reproduisant des schémas toxiques :
« Dans les soirées, les invités apportent des salades de quinoa, des fromages coupés en dés parfaits, de la baguette bien tranchée. Moi, j’apporte l’ensemble de mes traumatismes d’enfant oubliée et je les étale sur la table, pas d’ustensiles, pas d’assiettes, et j’exige qu’on me regarde les manger directement sur le plancher avec mes mains. »
Le panthéon des autrices convoquées annonce la couleur : Ernaux, Duras, Despentes et Solanas, les bonnes fées de la littérature féministe qui ont en commun l’intransigeance, la précision et la volonté d’exhiber ce qui d’ordinaire reste tu, ce que la société toute entière nous crie de garder pour nous, au prix d’un silence qui empoisonne.
Les mots sont crus, les vérités qui dérangent assenées sans ménagement, l’écriture puissante, assortie d’images qui font froid dans le dos. Comme lorsque l’autrice analyse son parcours personnel au prisme des méfaits du patriarcat, qui sexualise le corps des filles dès l’enfance :
« La première fois, c’est avec les yeux. C’est la première fois que quelqu’un me regarde comme si j’étais mangeable. C’est la première fois que je sais qu’une partie de mon corps aurait dû rester cachée. Je m’étais changée directement sur la plage pour mettre mon beau maillot avec des tournesols dessus. Je n’aurais pas dû montrer mes fesses et la place secrète. J’ai pensé longtemps que de m’être changée à quatre ans, toute nue sur la plage, ça a fait partie des erreurs capitales. Je ne sais pas combien d’hommes se sont dit que j’étais mangeable ce jour-là, avec mon maillot tournesol. J’ai le sentiment d’avoir provoqué un cataclysme. »
L’univers d’où vient la narratrice est celui des ferrailleurs et des casses de voiture, des hommes rudes en bleu de travail. C’est l’univers des mères précaires, de l’abus d’alcool bon marché et des fins de mois difficiles. Pourtant, à aucun moment il ne s’agit d’originer l’horreur dans la classe sociale, d’apposer sur la misère comme un calque crasseux les violences intrafamiliales, la pédocriminalité et les carences éducatives. Les mécanismes de domination, l’oppression patriarcale contaminent toutes les strates de la société :
« La vulgarité et le brutalité ne se retrouvent pas seulement derrière des garages au fond de la campagne, elles se retrouvent tout aussi bien dans les salles de cours de l’université, dans les rangées d’une épicerie bio ou autour d’une table d’hôte et d’un verre de vin. La vulgarité, la violence, la brutalité ne naissent pas de l’huile à moteur ni des crachats jaunes sur la neige blanche. »
« Ostie que le monde est plate » !
L’accent québécois s’entend, se lit à travers des tournures syntaxiques, un lexique légèrement étrange pour la lectrice qui en est peu familière… Autant avouer tout de suite qu’en terme de parler québécois, j’ai deux références : Céline Dion et Michèle Lalonde. Je ne vous présente pas la première mais j’invite celleux qui ne connaissent pas la seconde à laisser traîner leurs oreilles par ici pour découvrir son poème Speak White, prononcé en 1968. Quand Michèle Lalonde scandait son texte toute en colère contenue, Michelle Lapierre-Dallaire écrit à la dynamite, explose de rage et d’envie d’en découdre avec le monde. Le parallèle est peut-être alambiqué, pourtant les deux Michèle/Michelle restituent l’usage de la parole à celleux qui en ont été spolié.e.s : minorités de classes, de genre, de race, d’âge. Prendre ou reprendre la parole confisquée est un acte politique qui dépasse les frontières de l’autofiction et fait sauter le verrou des chambres d’enfants maltraité.e.s.
Pour autant, tout n’est pas que carnage, violence et destruction dans ce premier roman qui renferme des pages lumineuses. Les mots adressés à la mère, bouleversants, les souvenirs d’enfance heureux qui resurgissent au creux des herbes hautes et des rivières de vacances, le cheminement difficile, long et plein d’embûches mais qui tend vers plus d’estime de soi retrouvée, vers l’espoir reconquis :
« Je te jure, on met nos plus belles robes, nos robes de salopes intellectuelles, pis on va mettre le feu à la Librairie du Soleil. En allumant nos bombes, en regardant les livres s’enflammer, les vitres péter dans des fracas dignes d’une walkyrie, en contemplant notre chef d’œuvre de destruction, on verra bien qui l’a, le Soleil. Je te jure qu’il est de notre bord. »
En introduction de L’Enfant, Jules Vallès écrivait cette dédicace devenue célèbre : « À tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège ou qu’on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre ». C’est à la toute fin de Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok qu’il faut aller lire la dédicace de Michelle Lapierre-Dallaire, dans des remerciements magnifiques de tendresse (et de rage aussi mais pour ça il faut que vous alliez lire vous-mêmes…) :
« Aux enfants seuls, aux mères monoparentales, aux femmes fortes et increvables, à toutes celleux qui ne correspondent pas, aux soulèvements de passion qui enjolivent l’existence et que personne ne comprend, aux amitiés qui ne réconfortent pas, à la volonté de vivre qui se trouve quelque part, promis. À la sororité. »
À notre tour de remercier Michelle Lapierre-Dallaire de partager avec nous ses plus grandes failles, de nous transmettre par ses mots la puissance qu’il lui a fallu pour survivre à son enfance.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.