
Découverte éditoriale de l’année, la maison Tendance Négative édite depuis 2012 des livres qui sont plus que des pages collées entre elles, supports matériels sans identité. Véritables objets de collection, au tirage limité, les classiques de la littérature que ces passionnés relisent au sens fort, s’étoffent d’une nouvelle puissance sous leurs doigts. L’espace du livre devient tri-dimensionnel. Couleur, mise en page, texture, découpe, reliure, rien n’est anodin, et tout sert la lettre et l’esprit des fictions qu’on nous déroule. Tenez, prenez Le Papier peint jaune entre vos mains et faites-le défiler : des morceaux vous résistent, une épaisseur se cache entre les pages, le motif orange lourd d’ornements du papier peint vous rappelle un test de Rorschach. C’est étrange… Pour vivre l’expérience sensorielle d’un best-seller de la littérature fantastique Outre-Atlantique, curieusement méconnu en France, il va falloir faire passer plusieurs fois les pages devant vos yeux enfiévrés.
Publiée aux États-Unis en 1892, la nouvelle plonge ses racines dans la matrice autobiographique de son autrice. À la naissance de sa fille en 1885, enferrée dans les affres d’une dépression post-partum qui s’éternise, Charlotte Perkins Gilman pense trouver un secours bienvenu auprès du très renommé docteur Silas Weir Mitchell : comme c’était souvent le cas à l’époque, le médecin l’a diagnostiquée « hystérique » et s’est empressé de lui prescrire une cure de repos forcé avec interdiction formelle de s’adonner à une trop intense vie intellectuelle et lui a fait promettre de ne plus toucher ni stylo, ni pinceau de sa vie. Après plusieurs mois de ce régime qui a failli lui être fatal, tant l’effondrement de son être tout entier la guettait, elle rompt violemment avec les prescriptions carcérales du monde médical et reprend l’écriture à sa table de travail. Cherchant à écrire non pas « pour rendre les gens fous, mais pour les empêcher de le devenir », elle publie le Papier peint jaune en réaction aux situation maltraitantes que les femmes de sa génération, et malheureusement bien d’autres après elle, ont eu à subir ; la psychiatrie préférant longtemps l’enfermement et la contention des corps à la libération de la parole et au mouvement.
La nouvelle réunit toutes les caractéristiques d’un classique du fantastique : un vieux manoir, des personnages secondaires évanescents, des pensées recueillies sur le vif qui tournent vite à des obsessions, une situation exacerbée de huis clos. Le lecteur tient dans ses mains le journal intime d’une jeune accouchée à qui on impose une réclusion au dernier étage d’un manoir dans une chambre qu’on lui assigne contre sa volonté. Le mari, médecin, entend ainsi lui garantir une guérison prochaine en lui évitant les stimulations de la vie sociale et les fatigues des premières semaines de l’enfantement.
« Je n’aime pas du tout notre chambre. J’en voulais une en bas qui donne sur la véranda avec sa fenêtre envahie de roses et de rideaux en chintz, vieillots mais si jolis ! Mais John n’a pas voulu en entendre parler.«
Femme sous influence, la narratrice nous confie son désarroi et ses obsessions dans ce face à face avec les quatre murs de sa chambre à coucher conjugale. Barreaux aux fenêtres, vieux papier peint jauni aux motifs complexes et fuyants, traces étranges sur le parquet, l’espace de la cellule cerne un corps en quête d’une échappée. Le texte, un peu décousu, est écrit dans des temps volés à la surveillance de l’entourage : sans doute cette femme a-t-elle une chambre à soi mais cette chambre n’est pas véritablement à elle, des fenêtres la trouent de toutes parts et les murs ne jouent bientôt plus leur rôle opaque, protecteurs de l’intimité, puisque des formes viennent s’y mouvoir dans les délires hallucinatoires qui guettent l’esprit malade ; les projections d’un esprit trompant l’ennui et la folie accouchent alors d’une prose librement associative à la façon des surréalistes :
« Sous un certain angle chaque bande semble tenir toute seule, les courbes boursouflées et les volutes « une sorte de roman déviant » frappé de delirium tremens – se dandinent le long de colonnes à la solitude imbécile.
Mais, d’un autre côté, elles communiquent par les diagonales, et les contours tentaculaires prennent la fuite en grandes vagues discordantes d’horreur optique, comme un fatras d’algues affalées en pleine course.«
Les silhouettes du mari et de la sœur rôdent aussi derrière la porte et interrompent régulièrement l’écriture qui reprend plus tard, rattrapant mal le fil d’une pensée déjà chahutée par la mélancolie. Les sauts de page, les alinéas, les lignes brisées, les écritures continuées sur la page de droite, ou en travers de la feuille trouent le texte par places et malmènent la parole qui bute, cherche, bégaie puis crache, crie pour finalement se hisser, ramper hors du cadre, hors de la page.

Traduit déjà à trois reprises en français, notamment par la maison d’édition Des Femmes d’Antoinette Fouque en 1976, le texte fait l’objet d’une retraduction passionnante, étoffant et ajoutant aux traductions passées une nouvelle couche de papier peint, un nouveau motif à une œuvre ardue et réputée polysémique, difficile à figer dans une autre langue que l’anglais. Comment rendre en français le cri (yell) de l’adjectif du titre (yellow) ou le mur (wall) du papier peint (wall-paper) ? Le duo de traducteurices Marine Boutroue et Florian Targa s’est nourri des défricheur.euses avant ielles, des travaux de Corinne Oster, et d’un soutien graphique de grande qualité (Hélène Lecomte et Clément Buée) qui enrichit le texte d’un visuel inédit. Imprimé en bi-chromie en reliure japonaise, on lit le couteau à la main, on lamine les pages, on réduit en lambeaux la belle structure imaginée par toutes ces mains et on espère participer à la libération de celle qui voit passer des formes derrière les entrelacs, des silhouettes rampant le long des plinthes, aspirantes à l’évasion. Prenons garde à ce que l’espace de la page ne nous dévore pas à l’instar du papier peint grignotant l’espace du texte. Oppressante, asphyxiante, l’atmosphère graphique nous invite à respirer au rythme de la voix qui nous parle et cherche à sortir malgré John, malgré Jane, malgré les médecins, malgré la pensée dominante de cette chambre contre soi.
Traduction : Marine Boutroue et Florian Targa
Photos : Camille Cier
Illustrations : Hélène Lecomte
Graphisme : Clément Buée

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.


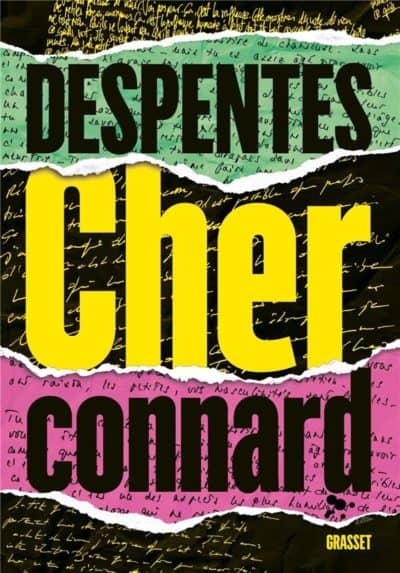

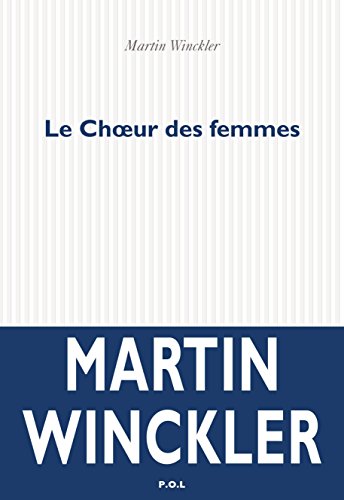

1 Comment
[…] traductrice Marine Boutroue qui avait déjà oeuvré auprès de Florian Targa pour la traduction du Papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman en 2020 ne s’arrête pas à ce balayage temporel. Elle enrichit […]