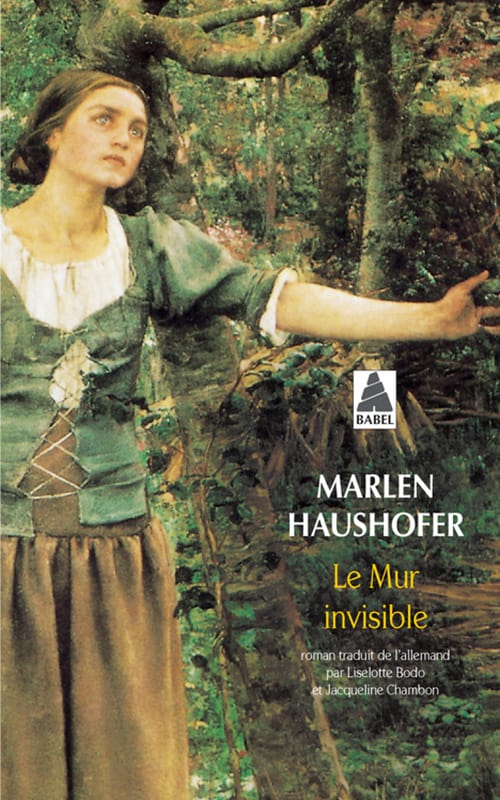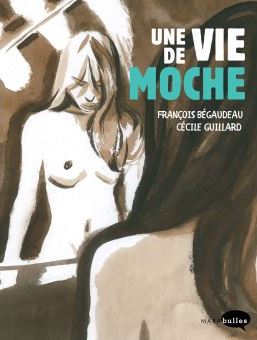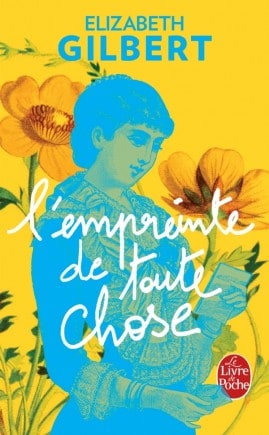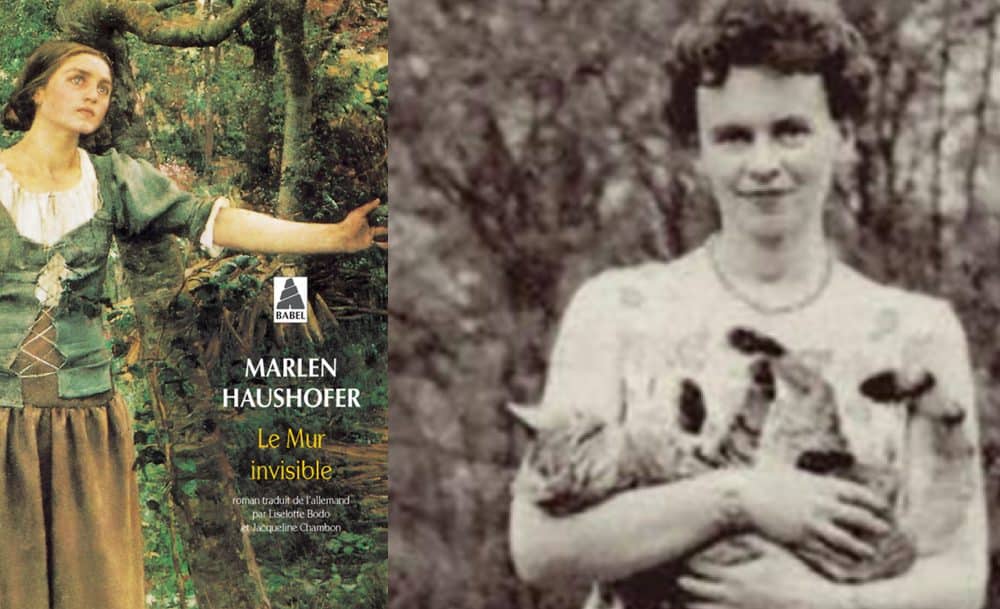
À chaque époque, ses fléaux et les fantasmes qu’ils charrient : menace de guerre nucléaire, réchauffement climatique, pandémie, terrorisme, dérive fasciste. Dépeignant la fin du monde tel que nous le connaissons et simulant la destruction grandeur nature de l’humanité, les romans survivalistes excitent notre envie d’entrevoir un autre monde. Interdisant à l’humanité de vaquer à ses occupations dans l’insouciance, la littérature de la catastrophe exploite habilement les virtualités d’un temps où tout est mis en suspens, où tout est soumis à une reprogrammation. Le monde se fige, comme les vivants se retrouvent pétrifiés de l’autre côté du Mur invisible de Marlen Haushofer.
L’autrice autrichienne fait paraître en 1963 un livre aussi étonnant qu’austère qui ne cessera de rebondir de succès en oublis puis en redécouvertes : Le Mur Invisible (Die Wand) dont l’intrigue tient en quelques lignes. Alors qu’elle passe quelques jours dans le chalet de chasse de sa cousine Louise et de son mari Hugo, un couple de bourgeois citadins s’adonnant aux plaisirs de la villégiature dans les Alpes autrichiennes, la narratrice se retrouve coupée de tout, suite à un mystérieux cataclysme surnaturel. Le couple parti quelques heures en ville ne reviendra jamais de son escapade ; la nuit passe ; une autre journée commence et la femme, dont nous ne saurons jamais le nom, se lance à leur recherche, en vain. En voulant descendre dans la vallée, elle se cogne à une paroi invisible dont elle devine qu’elle isole sa ferme du reste du monde. De cet isolement subi naît le récit d’une survie confiée aux feuilles de papier glanées çà et là dans le chalet et destinée au mieux à un humain qui découvrirait le manuscrit après sa mort, au pire aux souris dont les dents infligent à toute chose l’anéantissement le plus total. Après cette entrée fracassante dans l’histoire, peu d’actions, peu de développements dramatiques, mais le déroulement de journées monotones dédiées au labeur et aux réflexions couchées sur le papier, rempart à l’oubli et à la folie.
Comme si la course du temps s’était inversée, l’héroïne incarne une femme des premiers temps de l’humanité, sans transcendance, une Eve laïque dont le jardin d’Eden n’a rien de particulièrement enviable. La nature ne se montre pas particulièrement bienfaisante et tout s’obtient à la force du corps comme à l’économie des gestes : les orties reviennent si on ne les arrache pas, les plantes recouvrent les fermes ou les corps pétrifiés qu’elle observe de l’autre côté du Mur ; les nuages, les tempêtes continuent de passer et de laisser la place aux journées ensoleillées. L’âme de la femme, extirpée des règles du jeu social, ne connaît plus que le temps hors du temps humain et accepte progressivement de se dépouiller des artifices mondains, même si elle continue coquettement de porter une montre-bracelet en or qui n’indique plus l’heure. Sans avenir, elle se tourne vers les jours laissés derrière elle et juge sévèrement la vanité de son passé, les identités de femme et de mère qu’on lui a ordonnées d’endosser successivement. Elle dresse ce constat amer que sa vie lui a été en quelque sorte dérobée :
« Quand je me remémore la femme que j’ai été, la femme au léger double menton qui se donnait beaucoup de mal pour paraître plus jeune que son âge, j’éprouve pour elle peu de sympathie. Mais je ne voudrais pas la juger trop sévèrement. Il ne lui a jamais été donné de prendre sa vie en main. Encore jeune fille, elle se chargea en toute inconscience d’un lourd fardeau et fonda une famille, après quoi elle ne cessa plus d’être accablée par un nombre écrasant de devoirs et de soucis. Seule une géante aurait pu se libérer et elle était loin d’être une géante, juste une femme surmenée, à l’intelligence moyenne, condamnée à vivre dans un monde hostile aux femmes. »
Au contraire, après la catastrophe, son moi se dissout dans une multitude d’êtres qu’elle ne pensait pas pouvoir incarner en une vie. De l’instabilité identitaire naît en réalité une forme de jubilation :
« J’avais acquis le droit d’oublier ma condition. Parfois j’étais une enfant qui cherchait des fraises, puis un jeune homme qui sciait du bois, enfin, assise sur le banc, Perle sur mes genoux en train de contempler le soleil, je devenais quelqu’un de très âgé, sans sexe défini. »
Loin d’une vision fantasmée de l’expérience totale de la vie dans l’immensité, le récit n’édulcore pas les moments de mélancolie, d’abattement, de désespoir quasi quotidiens qui s’emparent de l’héroïne. La femme qui vit au cœur de la nature est une dénaturée qui doit retrouver sa juste place, à la force de ses mains. Son éducation ne lui est d’aucune utilité, elle regrette même d’avoir passé si peu de temps à développer son corps, à l’avoir si peu entraîné à cette vie rude. Elle s’ouvre à la compréhension d’un monde nouveau qui fait fi des vieilles hiérarchies entre hommes et animaux. Compagnons dans l’adversité, les animaux tissent avec la narratrice des liens d’alter ego : leur souffrance animale est la sienne, elle s’inquiète de leurs disparitions, de leurs blessures, de leur mort, tandis qu’ils semblent répondre à ses accès de mélancolie par des attentions redoublées. Un langage délicat s’instaure, un nouveau regard se pose sur les bêtes comme on repense aux belles pages de Colette sur ses animaux.
« Quand mes pensées s’embrouillent, c’est comme si la forêt avait commencé à allonger en moi ses racines pour penser avec mon cerveau ses vieilles et éternelles pensées. Et la forêt ne veut pas que les hommes reviennent. »
L’héroïne contemple les bois, les alpages autour de son chalet, consciente qu’elle se dissoudra aussi, non pas dans le fracas, mais dans l’indifférence qui a déjà englouti les êtres de l’autre côté du mur. Les silhouettes lointaines de ce qui fut l’humanité, figées comme sur une carte postale bucolique avant que leur corps ne bascule pour disparaître dans la végétation, fonctionnent comme des memento mori. La séquestration subie par la narratrice dans une nature intacte lui impose une vie de recluse, loin de la frénésie de sa vie bourgeoise citadine. À cette condition, elle peut enfin s’ouvrir aux bruits de la forêt, où « tout vit et travaille » et prendre enfin sa place au monde.
Ni généreuse, ni hostile, la nature n’a pas de sexe, ne traite pas les êtres sur un pied d’inégalité, ne repose sur aucune morale. Elle est. C’est tout. Dans la nature, la narratrice accepte son sort, elle est une ignorante qui prend conscience de sa solitude et regrette de n’avoir pas su profiter de la chance de vivre entourée des autres. Si c’était à refaire, sans doute tout serait-il différent. Plutôt que d’aller quelque part, de suivre une destinée, elle laisse les événements et les animaux venir à elle, car, qu’attendre d’une situation inéluctable ? La mort comme seule certitude et en attendant la survie. Comme un testament qui viendrait trop tard pour susciter un sursaut de conscience, inviter à l’harmonie entre hommes et femmes mais aussi entre humains et animaux, le récit semble authentique. La parole d’une disparue qui a écrit jusqu’au bout, que nous avons la chance de tenir entre nos mains résonne encore après la fin de la lecture, comme si nous étions hantés par ces révélations sur les secrets ultimes de la vie humaine.
Les écoféministes ne s’y sont pas trompées en exhumant cet ouvrage vieux de soixante ans : la triade culture guerrière, patriarcat et exploitation de l’environnement sont les prémisses qui amènent à la destruction de l’humanité. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, après avoir endossé les postes de travail habituellement réservés aux hommes, les femmes sont repoussées du côté de la nature par le patriarcat, et priées de reprendre leur place « naturelle » aux côtés de leur mari et des enfants. De la même manière que les fleuves, les terres, les animaux et les plantes sont exploités pour le désir et les besoins de l’Homme, l’héroïne revient sur une vie de bonne mère de famille, reléguée hors du monde de « culture » érigé par les hommes, et instrumentalisée pour faciliter la vie du foyer. Or, Marlen Haushofer évite brillamment le piège de l’essentialisation : elle ne prétend pas faire de son héroïne une femme proche de la nature par essence, et donc vouée à une régression réactionnaire ; au contraire, elle réclame que les hommes entrent eux aussi de plain-pied dans la célébration de leur corps, dans le soin qu’on doit accorder à l’environnement, dans l’idée que les êtres sont des alter ego. Soutenir le contraire revient à faire vœu de mort, et c’est ce vœu que l’Hommanité de Haushofer a malheureusement choisi de faire.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.