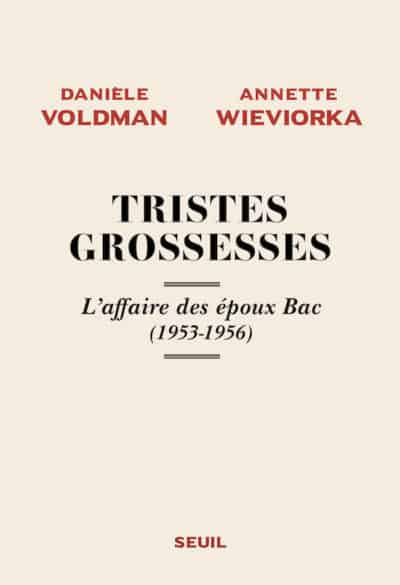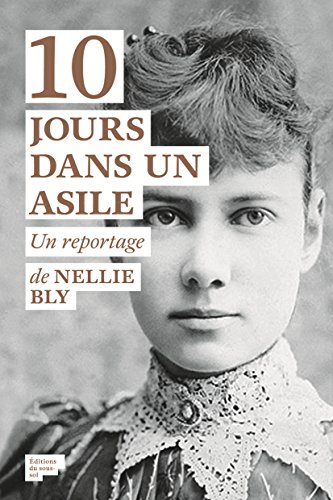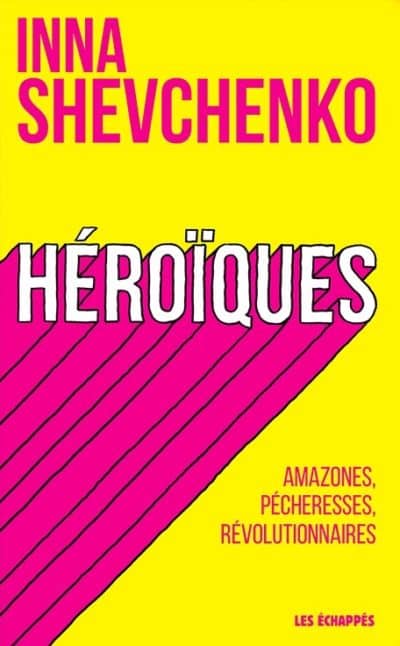On a connu Kiyémis poétesse avec la publication du recueil À nos humanités révoltées en 2018, on découvre Kiyémis essayiste ! L’autrice retrace ici son propre parcours de femme noire au corps gros, condamnée à intégrer depuis l’enfance un regard social profondément désapprobateur. Comment construire l’estime et l’amour de soi quand le regard des autres façonne un corps-ennemi que la fillette puis la jeune fille n’aura de cesse de contraindre à force de régimes ? Comment s’évader des cases ultra-normées de la féminité blanche et mince matraquée par le capitalisme, quand on subit les oppressions croisées du racisme, du sexisme et de la grossophobie ?

Construit en six chapitres, l’essai commence par un état des lieux qui coïncide avec les prises de conscience de l’enfance. Les expériences ordinaires, mais qui rappelleront des souvenirs à de nombreuses lectrices, sont analysées et déconstruites. La virée shopping chez Jennyfer, rite de passage de la féminité adolescente, les sorties à la piscine municipale privées de l’insouciance et de la joie enfantine lorsqu’il s’agit d’exposer son corps aux regards qui scrutent les bourrelets, les vergetures et autres « anomalies ». Le corps hors-normes se met alors à incarner et à modeler la « fille-cauchemar », celle qui sert de repoussoir aux autres, à qui il faut éviter à tout prix de ressembler (bye bye sororité). Cette intériorisation des normes, si puissante qu’il nous faut parfois toute une vie pour parvenir à la déconstruire, Kiyémis l’analyse comme la conséquence des « contes du patriarcat », les narrations effroyables qui nous somment d’adorer des corps présentés comme parfaits qui ne seront jamais les nôtres. En revenant sur ces grandes lignes prescriptrices données dès l’enfance, la figure maternelle apparaît et Kiyémis sait, comme toujours, faire dans la nuance. Certes les mères participent aussi à cette intériorisation des normes et la haine de soi commence parfois au sein du foyer, mais Kiyémis préfère la réconciliation aux règlements de compte, la compréhension aux condamnations à l’emporte-pièce :
« Grâce à ma mère, je n’ai jamais douté de la beauté et de la valeur des femmes noires. Mais à travers son regard, j’ai également appris à voir les femmes grosses comme moches. Elle aussi, comme la majorité des femmes qui m’entouraient, traquait le gras avec ardeur et sévérité. Une sévérité qu’elle infligeait à son propre corps, et par ricochet, au mien. À la lecture de ces mots, on pourrait céder à l’envie de critiquer ma mère. C’est d’ailleurs souvent ce qui arrive. On préfère accabler les femmes de tous les maux et épargner les pères. On blâme la mère qui a failli, la défaillante, ou celle qui est trop investie, la maman poule. La mère qu’on a vue faire des régimes à répétition et qui, apprenant à contrôler son propre corps, est devenue geôlière de ta prison naissante. (…) Les sanctuaires contre la grossophobie n’existent pas, car l’apprentissage de la grossophobie fait partie intégrante de l’apprentissage de la féminité. Le patriarcat dresse les femmes les unes contre les autres. Et dans le cas des mères, celles-ci nous lèguent leurs silences, leurs douleurs, les violences qu’elles ont subies. »
La figure maternelle est d’ailleurs un fil que l’on suit au cours du récit, comme quand Kiyémis fait référence au livre de Fatima Ouassak, La Puissance des mères, qui a permis d’envisager la maternité comme une puissance politique, un héritage de résistance : « c’est bien dans les cuisines de ma mère qu’ont été semées en moi les graines de ce qu’on appellerait plus tard l’afroféminisme. »
Corps gros, corps noir : pire cauchemar ?
S’ajoute à la grossophobie dont l’autrice a été victime assez tôt dans son parcours, la discrimination raciale. L’éclairage historique est passionnant : l’autrice montre que la grossophobie a été construite pour justifier la légitimité des empires coloniaux naissants. D’ailleurs avant le 17e siècle, les peintres n’hésitent pas à représenter bourrelets et cuisses épaisses. Et soudain Kate Moss… Entre les deux ? La colonisation (oh le vilain raccourci. Mais en fait, si). Déshumaniser le corps de celles et ceux qu’on veut réduire en esclavage pour justifier « scientifiquement » et « intellectuellement » les traitements qu’on leur inflige. Les corps jugés volumineux de femmes africaines sont alors associés à la langueur, la paresse, la suractivité sexuelle, animalisés en permanence dans les discours et les représentations. L’exemple de Saartjie Baartman, surnommée la Vénus Hottentote, exhibée à travers toute l’Europe pour créer une figure de l’Autre qu’on moque à loisir est emblématique. Dégrader le corps des femmes noires et par la même occasion discipliner celui des femmes blanches : toutes perdantes ! (certaines un peu plus que d’autres, ne soyons pas naïves).
Rapporté à l’expérience personnelle, cela entraîne une fétichisation du corps noir dans les relations intimes : Kiyémis évoque les hommes qui fantasment avec elle un voyage exotique ou une case à cocher dans la liste des expérimentations sexuelles. Déshumanisation, encore. Dans le tout récent spectacle de la metteuse en scène, autrice, performeuse et comédienne Rebecca Chaillon, Carte noire nommée Désir1, une scène très forte (parmi tant d’autres… il faut TOUT voir de Rebecca Chaillon) met en scène les comédiennes lisant des petites annonces piochées dans les pages du magazine Amina. Les « homme blanc, 55 ans à la recherche de sa tigresse ou de sa perle noire » s’accumulent jusqu’à la nausée, les stéréotypes racistes n’en finissent plus de s’égrener, corps objectivés inlassablement dans le regard de l’autre. On en rit jusqu’au malaise, on finit par en pleurer.
Ils nous ont divisées, les femmes : « J’ai fini par croire, sans validation masculine, que je ne valais rien, et que je n’avais droit à rien. »
Kiyémis analyse les rouages de la concurrence entre femmes : en construisant un idéal de perfection stéréotypé, les femmes se désolidarisent les unes des autres en cherchant la validation permanente, l’approbation du regard masculin qu’on leur apprend à considérer comme mètre-étalon de leurs existences. Films, séries, publicités et dès la plus jeune enfance, contes de fées, élaborent à travers le male gaze ce vers quoi on doit tendre pour être aimée. Forcément blanche, mince et valide, la princesse des contes attend d’être choisie-aimée-réveillée pour pouvoir vivre sa meilleure vie entourée de marmots dans son château. Éliminer les rivales devient le meilleur moyen de sauver sa peau et de jouer le jeu du patriarcat qui ne propose aucune narration alternative. D’où les relations exécrables qui hantent l’univers des contes : belles-mères et demi-sœurs jalouses à crever ne laissent aucune place à l’amitié, à la bienveillance et à la sororité. Tout le pouvoir subversif du collectif s’évanouit pour favoriser la vulnérabilité et l’insécurité. Pour tirer son épingle du jeu, gagner sa place dans « le marché de la bonne meuf », il ne reste qu’à se distancier des autres femmes. Car il s’agit bien d’un marché, et le capitalisme a tout à gagner à nous voir désespérément nous agiter pour ressembler aux mirages qu’il nous met sans arrêt sous le nez : régimes, abonnements en salles de sport, vêtements, cosmétiques allègent nos portefeuilles mais ce n’est pas tout. Ce temps passé à tenter de devenir ce qui nous est vendu comme une meilleure version de nous-mêmes, ne l’est pas à s’organiser collectivement pour lutter ou à inventer ensemble des narrations contradictoires. Je m’épuise et je m’appauvris pour ressembler à une femme que je ne serai jamais parce qu’on m’a appris à ne pas aimer celle que je suis, en attendant je ne lutte pas avec les copines pour dézinguer le système et d’ailleurs c’est pas vraiment mes copines puisque j’ai toujours peur qu’elles soient plus belles que moi : cercle bien vicelard et tout bénef pour LVMH.
« Je ne crois pas aux étoiles solitaires. Je crois aux galaxies qui brillent de concert. »
Une fois établis ces constats pour le moins désespérants, comment ne pas s’enfermer dans le pessimisme et la colère ? Kiyémis est profondément réfractaire à « la narration horrifique que nous promet le capitalisme », comme elle l’annonce dans son tout récent rendez-vous sur Mediapart justement intitulé Rends la joie. Un des ferments de l’optimisme consiste à s’appuyer sur le collectif comme une ressource inépuisable. Il y a les autrices référence, celles qui ont par leurs mots autorisé l’avènement de pensées autres : bell hooks figure en belle place dans ce panthéon des autrices aux côtés d’Audre Lorde, de Maya Angelou et de Toni Morrison, mais aussi à proximité de leurs héritières, Roxane Gay, Laura Nsafou ou Fania Noël. Il y a les collectifs nés sur les réseaux comme le forum Vive les rondes dans lequel l’autrice dit avoir puisé de la force à travers les partages d’expériences. Il y a la galaxie féministe qui permet des prises de conscience successives au contact des militantes, à travers les podcasts, les ateliers d’écriture : en inscrivant son chemin personnel dans une perspective plus large, Kiyémis rend compte d’une nécessaire politisation des luttes. À ce titre, le souvenir de la cérémonie des César de 2021, au cours de laquelle Corinne Masiero s’est déshabillée aspergée de faux sang pour dénoncer la précarité des artistes, donne lieu à de très belles pages (où l’on retrouve le rythme poétique de Kiyémis) :
« On m’a fait avaler la honte à la petite cuillère. On l’a imprimée sur chaque étiquette de mes culottes trop grandes. On l’a dissoute dans chaque défrisant qui touchait les pointes crépues de mes cheveux.
La première fois que j’ai vu l’image de Corinne Masiero, partagée en masse sur mes réseaux féministes, j’ai senti la gêne monter dans mon corps. Comme une mauvaise habitude.
Je l’ai reconnue cette gêne. La même que j’ai pu ressentir en me regardant moi dans le miroir. Cette gêne qui me poussait à m’excuser pour un rien.
Corine Masiero a dit qu’elle ne s’excuserait pas.
Virginie Despentes a dit qu’elle ne s’excuserait pas.
Audre Lorde a dit qu’elle ne s’excuserait pas.
Rachel Keke et les femmes de l’hôtel Ibis ont dit qu’elles ne s’excuseraient pas. »
Utopier plutôt que dystopier
Enfin, pour contrer cauchemars et narrations horrifiques, promesse d’apocalypse et de grand effondrement, Kiyémis ose la carte de l’utopie. Elle avoue avoir abandonné la série The Handmaid’sTale2, dystopie trop éprouvante qui met en scène un monde totalitaire où la stérilité est si répandue que les femmes pouvant procréer sont privées de tous leurs droits les plus élémentaires et deviennent des esclaves sexuelles. À partir de cette impossibilité d’aller jusqu’au bout d’une série qui se fait pourtant l’écho des combats féministes (rappelons que de nombreuses américaines ont manifesté contre le recul du droit à l’avortement en arborant le costume rouge et blanc de la série), l’autrice s’interroge : pourquoi n’arrive-t-on plus à rêver, à imaginer les mondes dans lesquels nous aimerions vivre plutôt que ceux qui planent sur nos têtes comme d’effroyables menaces ? Parce que la colère, si elle est un bon moteur, « ne permet pas de courir un marathon », l’autrice entend redonner sa place au rêve, puissant antidote à la dépression pour envisager un avenir désirable. Kiyémis réveille le fantôme de Martin Luther King dont le discours trônait en bonne place au domicile familial lorsqu’elle était enfant et nous partage son rêve dans un monde d’utopies réalisées. Elle rappelle ainsi, à juste titre, que les choses qui paraissent les plus folles au moment du combat peuvent devenir réalité : malgré la violence extrême et le système totalitaire mis en place pendant des siècles, les esclaves n’ont cessé de résister, de tenter l’évasion, de s’échapper, et finalement … d’utopier.
Nous recevrons Kiyémis à la Maison des Femmes de Montreuil samedi 1er avril pour parler de son livre, accessible et inspirant : venez nombreux.ses ! Le court-métrage de Marina Zioltowski, Extra Large sera diffusé en exclusivité pour l’occasion, on reparlera dystopie et utopie. La rencontre sera traduite en Langue des Signes grâce aux étudiantes du Master LSF de l’ESIT. Et comptez sur nous, il y aura de la joie : la soirée se prolongera par un buffet et un dancefloor pour frotter nos corps multiples sous la boule à facettes !

1Carte noire nommée Désir, pièce écrite et mise en scène par Rebecca Chaillon, La compagnie Dans le Ventre, 2021.
2The Handmaid’s Tale, (La Servante écarlate), 2017, 5 saisons, adaptation du roman de Margaret Atwood publié en 1985.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.