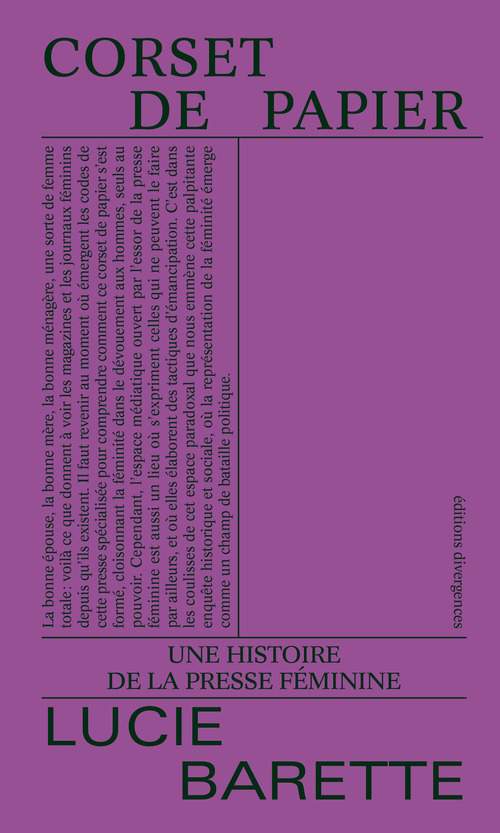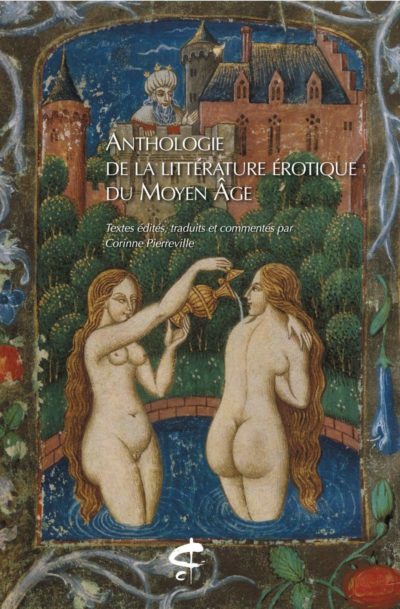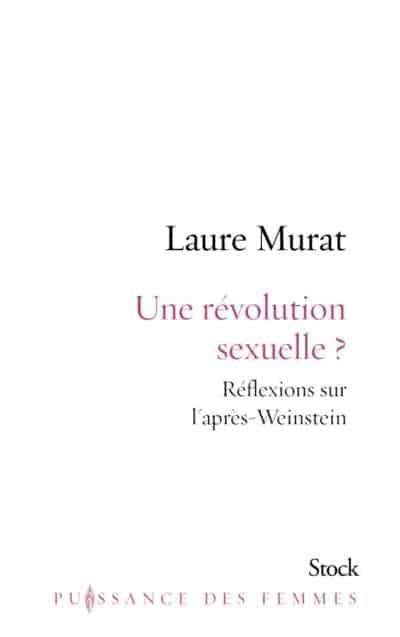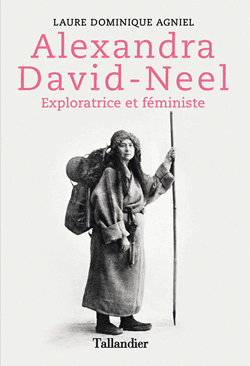Des corps invraisemblablement cintrés, des injonctions à n’en plus finir et une bonne dose de publicité… Les premières revues féminines n’étaient pas si différentes des nôtres. Les archives du XIXème siècle exhumées par la chercheuse Lucie Barette dans Corset de papier permettent de s’en rendre compte rapidement. On y trouve, pêle-mêle : des astuces pour lutter contre le blanchiment des cheveux, des récits de promenades dans des grands magasins ou encore des gravures représentant des femmes à la taille « pas plus large qu’un cou. »
N’ayant jamais pu me reconnaître dans les magazines féminins, j’étais curieuse de comprendre comment on en était arrivé à une représentation de la femme idéale aussi étrangère à celle que je me fais de moi, dans les médias qui sont censés m’être destinés. L’enquête de Lucie Barette m’a offert une réponse passionnante : car si ces journaux font clairement « le jeu du cis patriarcat blanc », selon la spécialiste des médias, ils résultent aussi d’une bataille politique, dont j’ignorais tout.

Des pionnières militantes
Au fil des pages, on découvre les rédactrices pionnières et leurs « tactiques de composition » avec l’ordre établi. Car ces grandes oubliées de l’histoire se sont vues mettre de sérieux « bâtons dans les roues, des troncs même », dès lors qu’elles se sont essayées à parler de politique, selon la chercheuse rattachée à l’Université de Caen, qui signe son premier ouvrage à destination du grand public aux éditions Divergences.
La militante féministe Eugénie Niboyet en a fait les frais. Cette journaliste et écrivaine prend rapidement conscience du rôle des médias dans la fabrique de l’opinion publique et voit dans la presse, « véritable science du bien et du mal, (…) le plus sûr moyen d’action qu’on puisse employer »… Ce qu’elle paiera à plusieurs reprises. En 1844, elle est ainsi condamnée à un mois de prison au motif qu’elle n’aurait pas le droit de diriger un journal considéré comme « politique » : La Paix des Deux mondes. Et lorsqu’elle récidive avec La Voix des Femmes, qui revendique le droit de vote et de meilleures conditions de travail après la révolution de 1848, elle devient la cible du principal journal satirique de l’époque, Le Charivari.
La morale, une ligne éditoriale
Il n’existe pourtant pas de texte de loi interdisant explicitement de parler de politique dans les revues féminines. La censure passe par des biais indirects, mais efficaces, selon la chercheuse.
Les revues spécialisées ne sont pas censées en traiter explicitement, et depuis l’invention du Code civil sous Napoléon en 1804, les femmes, éternelles mineures, n’ont pas le droit de diriger une entreprise. Elles avaient déjà reçu une mise en garde glaçante après la révolution de 1789. Alors qu’Olympe de Gouges, Marie-Antoinette et une représentante du parti girondin, Manon Roland, viennent de se faire décapiter au cours d’une seule et même semaine, le Moniteur Universel, qui retranscrit les débats parlementaires, adresse ce réjouissant message aux « Républicaines » en 1793 :
« Aimez, suivez et enseignez les lois qui rappellent vos époux et vos enfants l’exercice de leurs droits (…) ne suivez jamais les assemblées populaires avec le défi d’y parler (…) alors la patrie vous bénira parce que vous aurez réellement fait pour elle ce qu’elle a le droit d’attendre de vous ».
Dès lors, le ton moralisateur de nombreuses revues s’explique facilement : « Les périodiques relaient alors cette exclusion des femmes du politique mais les invitent à exercer leur influence au sein du foyer comme des gardiennes de la morale religieuse : une sorte de “le privé est politique” avant l’heure, et par défaut ».
D’ailleurs, si les femmes ont le droit de prendre la parole publiquement, c’est justement parce qu’elles défendent ces valeurs. « Soyons auteurs mais restons femmes », prêche ainsi un article paru en 1834 dans le Journal des femmes.
Des premiers publireportages
Prochain constat : l’omniprésence de la publicité. Les réclames pour les produits de beauté et d’entretien vampirisent déjà les colonnes des premières revues. Lucie Barette épingle au passage plusieurs articles qu’on décrirait aujourd’hui comme des publireportages déguisés. Ainsi, le récit d’une promenade dans un grand magasin parisien offre à ses lectrices l’occasion de s’enquérir de son adresse et du prix des articles en vente.
Les relations incestueuses avec les annonceurs sont donc bien antérieures à la crise liée à l’avènement d’internet au cours des dernières décennies – les médias ont d’ailleurs déjà connu de multiples crises auparavant. « Les magazines ne sont pas devenus des magasins : ils l’ont toujours été », conclut à ce sujet la chercheuse, contredisant la formule choc de l’ex-directrice des revues Isa et Grazia, Isabelle Chazot, dans une interview donnée aux Inrockuptibles en 2014.
Le male-gaze omniprésent
Véritable usine à complexes, la représentation de corps « jeunes, maigres, blancs, objectivés et fantasmés » comme unique horizon n’a rien de nouveau non plus. Tout comme l’essayiste Anne-Marie Lugan Dardigna, qui dénonçait la « fonction idéologique » des photos de mode au service des intérêts bourgeois et du capitalisme dans les années 1970, Lucie Barette montre la portée politique des illustrations des premières revues féminines, qui invitent leurs lectrices à fantasmer un mode de vie a priori éloigné du leur, dès le XIXème siècle.
Autre plaie des magazines féminins, le male-gaze se lit déjà dans de nombreuses illustrations : une pianiste qui observe le lecteur derrière son épaule dénudée, une actrice, ou encore une petite fille dévisagée par un garçon pas plus grand qu’elle dans le Journal des Demoiselles…
Pour couronner le tout, les lectrices sont déjà bombardées d’injonctions contradictoires. L’Art d’être jolie, qui paraît au début du XXème siècle sous la direction de la « demi-mondaine » Liane de Pougy, n’est pas en reste. Pour être belle, il faut être blanche, et ce n’est pas tout. Le teint « doit aller jusqu’à la pâleur amoureuse » sans non plus atteindre le « triste spectacle » des visages trop pâlis, il faut être « mince, non pas maigre, mince » et bien sûr il faut aussi être jeune et ne pas avoir de rides à la poitrine « grâce à quelques vieux moyens pour embellir les seins. »
Les femmes racisées sont quant à elles « évoquées comme des subalternes au sein des récentes colonies françaises ou érotisées en s’appuyant sur un idéal exotique raciste ».
Deux exemples parmi d’autres : la description de femmes voilées « tellement emmaillotées qu’on ne sait que penser de ces paquets mouvants » par Sophie Conrad dans le Journal des femmes, et la dénonciation de la condition de la « femme arabe, dans un état d’abaissement qui ne fait pas honneur à l’humanité » par un médecin de l’armée dans le Journal pour toutes, « alors même que des articles du code civil établis en 1804 autorisent les violences conjugales et que certains extraits de la Bible exigent l’entière soumission des femmes à leurs maris », comme le rappelle la chercheuse, qui en conclut :
« depuis 150 ans, on se sert de la stigmatisation de la culture musulmane dans les médias pour ne pas remettre en question le sexisme structurel en France et justifier l’exploitation coloniale. »
Dans ce contexte, la santé et le bien-être des lectrices sont secondaires. Prenant acte des méfaits causés par le port du corset, un article reconnaît en 1834 que « le meilleur moyen serait de laisser croître le corps en liberté », avant d’affirmer qu’« un tel conseil paraîtrait trop absolu et serait rejeté sans examen. » La spécialiste des médias file alors la métaphore qui lui inspire son titre :
« le journal est un corset de papier, censément inoffensif, supposé ne diriger que la droiture du corps social des femmes mais empêchant tout épanouissement et contraignant les inspirations des lectrices. »
La ménagère, la bonne épouse et la bonne mère
Dans la lignée de Virginia Woolf, qui sentait devoir « tuer l’ange de maison », Lucie Barette propose d’évacuer la « femme totale de papier glacé de son imaginaire pour disposer d’un peu d’espace mental à soi ».
La chercheuse expose de nombreux exemples de ménagères, d’épouses et de mères parfaites dans les journaux du XIXème siècle, synonymes de dévouement total et d’effacement de soi. Après avoir accouché dans la douleur, les femmes doivent se réjouir de ce qui est présenté dans de nombreux articles comme leur « destinée naturelle », la maternité. D’autant plus qu’une lourde responsabilité pèse sur leurs épaules : « c’est la mère qui sème les graines de la future société, et si elle échoue, c’est tout le contrat social qui s’effondre. » Rien que ça !
Aujourd’hui, les injonctions ont changé : « il n’est plus tant question d’un dévouement et d’un effacement total que de faire démonstration d’une réussite intégrale », constate la chercheuse, mais « l’idéal féminin n’en reste pas moins une femme totale, qui n’existera jamais. »
À ce stade, j’avais envie de brûler tous les magazines féminins. Mais le dernier chapitre m’a ramenée vers plus d’optimisme. Malgré leurs défauts, ces revues représentent aussi une ouverture pour leurs lectrices et leurs rédactrices. Ils se sont fait les porte-voix de certaines revendications politiques, notamment l’éducation des filles et des femmes. Ils parlent des droits sociaux : les journaux d’Eugénie Niboyet vont même jusqu’à demander des augmentations de salaire pour les ouvrières. Ils permettent à leurs lectrices et à leurs rédactrices de découvrir des lieux qui leurs seraient restés inconnus sinon.
Ils offrent une « vitrine de l’art et de la littérature féminine qui s’écrit au présent », un point de rencontre pour leurs rédactrices : « Les écrivaines-journalistes qui sont publiées dans leurs colonnes, Alida de Savignac, Mélanie Waldor, Emilie Marcel, Anais Segalas, Sophie Ulliac-Trémadeure, Victorine Collin, s’organisent en réseaux. » Au final, ils ouvrent un « nouveau champ des possibles », « une fenêtre dans l’espace mental de leurs lectrices ».
Corset de Papier m’a permis de mieux comprendre pourquoi des médias qui me sont destinés ont pour conséquence de me donner envie de pleurer en me regardant dans le miroir ou de me lancer dans des séances de shopping compulsif sur Vinted, et surtout : comment on en est arrivé là.
Maintenant, il n’est pas trop tard pour changer ce qui nous dérange. Citant La Déferlante, Censored, Gaze ou Deuxième Page, qui « tentent de repenser le journal féminin pour en faire une plateforme de réflexion et d’émancipation féministes », Lucie Barette appelle à « utiliser la presse féminine pour mettre en lumière ce qui nous rassemble, ce qui fait commun – être femme, être toutes les femmes, être toutes les minorités de genre, avec les expériences et les vécus que cela induit. »
Avant de conclure :
« Nous pourrions y voir nos corps, nos vrais corps, ceux qui existent dans notre vraie vie de chair. Nous pourrions y apprendre à y laisser tomber les corsets qui continuent de nous contraindre physiquement, émotionnellement, politiquement. (…) Nous pourrions en faire un espace en non-mixité, comme un pied de nez à la face des dominants, comme un bras armé de l’adelphité. »
Prêtes ?

Gabrielle aime la randonnée et Virginie Despentes. Les livres l’aident toujours à trouver des solutions, surtout quand ils parlent de féminisme, elle est donc très heureuse de faire connaître ceux qui lui plaisent grâce à Missives.