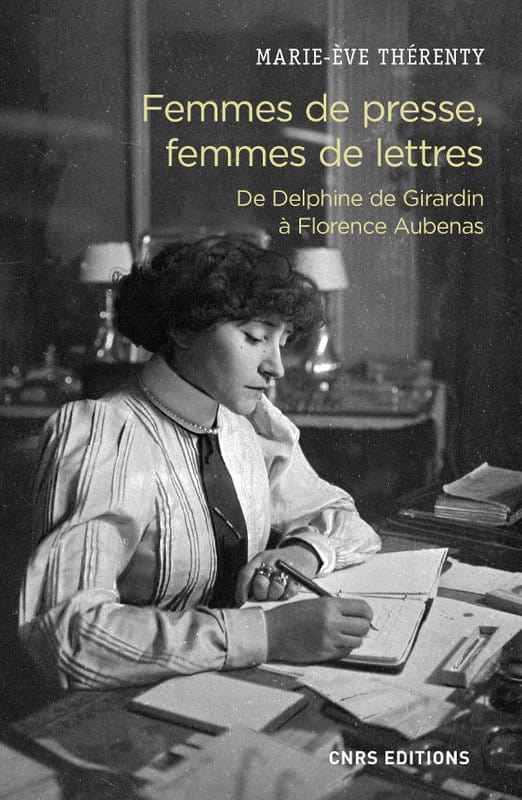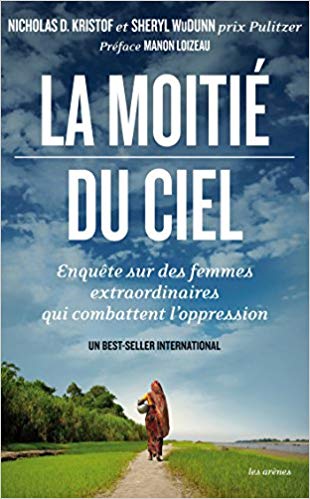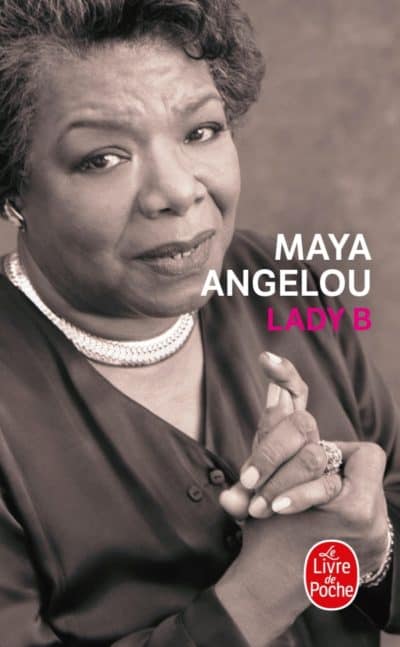Les Culottées mises en épisodes vidéo, les Monumentales sur les places parisiennes, Women do the Stuff sur Instagram, les jeux de société Bad Bitches ou Sept Familles inspirantes… autant d’initiatives qui mettent en lumière la présence historique des femmes dans la culture, la science et/ou la politique. Les gender studies universitaires contribuent également depuis plusieurs décennies à questionner la place des femmes dans l’histoire culturelle.
Marie-Ève Thérenty, spécialiste de l’histoire littéraire de la presse, présente dans cet essai les modèles de femmes journalistes qui ont contribué à faire de l’écriture médiatique ce qu’elle est aujourd’hui, à partir de son étude d’articles issus de la presse française de 1836 à 1944. « Par cette enquête archéologique dans les entrailles des journaux, il s’agit dans ce livre qui fait émerger toute une population oubliée d’artisanes de la grande presse et qui réexamine donc la conception d’une presse généraliste quasiment uniquement masculine, de hiérarchiser les positions et les carrières[1] » écrit-elle dans son introduction. Elle cherche en effet à montrer comment le vécu social des femmes, évidemment très différent de celui des hommes, puisque mineures perpétuelles sans droit de vote et seulement destinées à valoriser leur mari par leur gestion du foyer, a construit une manière d’intégrer les rédactions de presse et d’investir l’écriture journalistique. Selon Thérenty, les apprenties journalistes du XIXe siècle ont établi une stratégie d’écriture médiatique proche de l’écriture littéraire, et ce mouvement de littérarisation s’est ancré dans l’ensemble des codes d’écriture journalistique. La chercheuse affirme ainsi que la parade aux injonctions et contraintes pesant sur les femmes a fondé une partie de l’histoire de la presse.
Elle étudie six modèles de journalistes en les nommant à partir de figures mythologiques pour montrer comment les jalons de l’histoire de la presse sont également composés par des femmes, avec leur manière spécifique d’écrire l’actualité.
Pénélope est la première à regrouper les chroniqueuses du milieu du XIXe siècle. Par référence à sa qualité de gardienne du foyer, elle est l’allégorie de la théorie des deux sphères assignant les femmes à l’espace domestique, les excluant de l’espace public, théorie également appliquée dans le journal. Au milieu du XIXe siècle, il est encore très mal perçu qu’une femme fasse carrière de sa plume : son indépendance intellectuelle et économique effraie l’organisation sociale faisant encore de l’homme le maître de sa femme et de ses enfants. On invite donc fermement les femmes à rester à la place qu’on leur accorde, dans le foyer :
« Vivez comme une bonne petite bourgeoise, ou comme une simple mondaine, selon votre fortune ; qu’on vous trouve raccommodant votre bas, ou en le faisant faire, occupée de tapisserie, mais qu’on ne vous trouve pas, Seigneur, pondant de la copie et entourée de journalisticules qui vous parlent de vos œuvres[2]. »
Lorsqu’elles arrivent à accéder au journal, les femmes de la monarchie de Juillet sont très majoritairement cantonnées à ce qui est nommé le feuilleton, c’est-à-dire à la partie inférieure du journal réservée au divertissement. On leur confie les chroniques de mode et des mondanités, des rubriques très descriptives, ne relevant pas d’une réflexion sociale ou politique, ni de la moindre critique culturelle.
Les journalistes vont alors composer avec cette contrainte d’espace et d’intention et ré-inventer ce genre en y mêlant l’écriture de lettres, la conversation mondaine et la fiction, croisant l’analyse socio-politique aux « chiffons » mondains. Delphine de Girardin, poétesse, romancière, dramaturge et chroniqueuse sera la fondatrice de ce qui s’apparente aujourd’hui aux « billets d’humeur ». Elle tient ses « Courriers de Paris » toutes les semaines entre 1836 et 1848 sous le pseudonyme du vicomte de Launay avec autant de sarcasme que de finesse d’analyse sociale. Elle déjoue également l’interdiction morale d’évoquer la politique, transgressant les règles du genre avec des jeux ironiques :
« Il n’est rien arrivé de bien extraordinaire cette semaine : une révolution en Portugal [sic], une apparition de République en Espagne, une nomination de ministres à Paris, une baisse considérable à la Bourse, un ballet nouveau à l’Opéra, et deux capotes de satin blanc aux Tuileries.
La révolution de Portugal [sic] était prévue, la quasi-république était depuis longtemps prédite, le ministère d’avance était jugé, la baisse était exploitée, le ballet nouveau était affiché depuis trois semaines ; il n’y a donc de vraiment remarquable que les capotes de satin blanc, parce qu’elles sont prématurées : le temps ne méritait pas cette injure[3]. »
Cette répartition des fonctions journalistiques éloigne les femmes de l’analyse politique. Celles-ci subissent un très fort préjugé d’illégitimité : peu éduquées, interdites d’assemblées politiques, ne votant pas… elles n’auraient donc pas leur mot à dire sur les décisions politiques. Pourtant, certaines ont revendiqué fermement cette volonté et cette capacité. Thérenty les nomme les « Cassandre » à partir de deux figures majeures, George Sand et Daniel Stern, les pseudonymes masculins d’Aurore Dudevant et de Marie d’Agoult. Toutes deux se sont battues avec vigueur pour faire valoir leurs écritures de l’histoire, de l’actualité et de la politique dans le journal, essuyant des critiques acerbes, des moqueries effroyables, les renvoyant sans cesse à leur monstruosité supposée : plus vraiment des femmes comme il faut puisqu’indépendantes, pas vraiment des hommes puisque nées femmes, les caricaturistes ne les épargnent pas. Et c’est ce statut d’outsider qui étayera la posture des Cassandre : elles sont les spectatrices impartiales témoignant d’un événement auquel elles ne prennent pas part, gage de leur intégrité. Autre biais pour faire face aux contraintes qui pèsent sur les productions des femmes : le recours à l’écriture littéraire. Quand dans une série d’articles, George Sand écrit le fait divers terrible d’une jeune femme violée, Fanchette, dans la Revue Indépendante, les 25 octobre et 25 novembre 1843, elle mobilise les outils de la narration littéraire pour faire saisir l’ampleur de la grave absence de justice rendue à cette victime – l’affaire impliquant des religieux avait été tue et avait été classée sans suite par les autorités judiciaires.
La fin du siècle est marquée par le journal La Fronde composé exclusivement de femmes, des rédactrices jusqu’aux imprimeuses. Les « Frondeuses ou Bradamante » se spécialisent dans le reportage de terrain et l’enquête en immersion. Elles se professionnalisent, certaines réussissent à recevoir la même formation que leurs confrères mais continuent de jouer avec les écritures pour faire valoir leurs analyses. Séverine, pseudonyme principal de Caroline Rémy, est un modèle fort du journalisme de La Fronde. Formée par Jules Vallès, elle fréquente les mêmes réseaux que ses confrères. Elle écrit dans différents journaux et avec différentes signatures : dans le Gil Blas, sous le pseudonyme de Jacqueline, elle réclame le droit à l’avortement ; sous son pseudonyme Séverine, elle publie un reportage en immersion avec les « Casseuses de sucres[4] » en grève dans le Journal en 1892. Son écriture hérite de l’oblicité des chroniqueuses : c’est par le biais de l’ironie, entre fiction et conversation, entre chronique et reportage qu’elle évoque l’actualité sociale et qu’elle ancre une manière d’écrire le reportage.
Proches des reporteresses, « les aventurières ou les amazones » écrivent leurs explorations pour la presse du XXe siècle. Au reportage des Frondeuses, elles ajoutent la transgression des « frontières nationale, sociales, culturelles et même genrées[5] » en signalant l’obstacle voire le danger que représente le fait d’être une femme dans certaines zones, mettant en scène ce danger. Le corps, subissant l’aventure mais maîtrisé, est également au centre des écrits à l’image des reportages d’Alexandra David-Néel, première femme à atteindre le Tibet occupé interdit aux Européen.ne.s. Les « amazones » jouent également sur l’ambigüité du genre par leur costume – Isabelle Eberhardt et son habit masculin dans les pays arabes – et par leur maîtrise de la technique (photo, automobile), domaine imaginé comme masculin. Journalistes par accident et par nécessité, on les retrouve à la frontière de l’ethnologie et de la littérature.

Marie-Ève Thérenty remet encore en lumière les « Sappho », ces écrivaines de l’entre-deux-guerres – Marcelle Tinayre, Lucie Delarue-Mardrus, Germaine Beaumont, Myriam Harry, Blanche Vogt, Huguette Garnier – qui participent à la réinvention de la chronique et à la promotion des aventurières en immersion. Colette, que l’on retrouve dans ce chapitre, détourne elle aussi un genre phare, le reportage, en y intégrant les caractéristiques traditionnelles de la chronique afin de laisser jaillir ce que l’ordinaire et le quotidien contiennent du spectacle de la vie des femmes.
Enfin, Françoise Giroud et sa mention ironique des « Dalila du journalisme[6] » intitulent un dernier chapitre consacré aux journalistes du grand reportage au milieu du XXe siècle. Marie-Ève Thérenty y montre comment les préjugés et les règles qui contraignent les femmes sont finalement en adéquation avec l’écriture du reportage tel qu’il est pensé dans l’entre-deux-guerres : la sensibilité, la littérarisation et la dramatisation sont des caractéristiques d’écriture associées aux femmes et qu’on attend dans le grand reportage.
La chercheuse conclut cet essai en évoquant l’héritage des pratiques explorées et analysées ici dans le journalisme contemporain : Françoise Giroud, une Sappho ? Marguerite Duras qui fait une force médiatique de l’intime et du privé ; Florence Aubenas dans le sillage de Maryse Choisy et du « reportage-roman ».
Réinscrivant les femmes dans une histoire des médias, Marie-Ève Thérenty dégage un collège de modèles féminins qui ont réussi (ou échoué parfois) à s’émanciper des stéréotypes associés à leur genre pour fonder des écritures médiatiques dont nous sommes les héritièr.e.s. Si le regroupement par figure, genre journalistique et période rend la distinction entre les journalistes parfois confuse, elle permet de mesurer la porosité des écritures, des stratégies et des directions de carrières. Même s’il s’agit d’un essai universitaire qui s’appuie sur des notions littéraires ou issues des sciences de l’information et de la communication, il nous fait réaliser toute l’implication des femmes dans l’écriture de l’information dont on nous abreuve. Il se dégage aussi une réflexion pertinente sur le rapport à l’écriture et à l’actualité des femmes considérées non pas comme un sexe mais comme une classe dont le traitement social influence la construction à soi et au monde et donc à son récit. S’il existe alors une écriture féminine dans la littérature et les médias, celle-ci se ferait le reflet d’une expérience collective du monde et de l’intime. Cette écriture située constituerait alors une forme de female gaze sur l’actualité, offrant une autre perspective et invitant à la relecture des évènements majeurs de notre histoire, chroniquées par celles qui s’en réclament les témoins.
[1] Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres, de Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 20.
[2]Émile Tanneguy de Wogan, in Manuel des gens de lettres : le journal, le livre, le théâtre (1899) cité par Marie-Ève Thérenty, op.cit., p. 22.
[3] Delphine de Girardin, Lettres parisiennes du vicomte de Launay, éd. Anne Martin-Fugier, Paris, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 1986, vol.1/2, p. 9
[4] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7614852v
[5] Marie-Ève Thérenty, op. cit. , p. 204.
[6] Françoise Giroud, France-Observateur, n°556, 29 décembre 1960.

Lucie Barette, docteure en littérature et langue françaises, se fascine pour les manières qu’ont les femmes de composer avec les injonctions et les contraintes qui pèsent sur elles pour faire œuvre littéraire et médiatique. Entre deux livres poussiéreux, elle glisse une table de mixage pour mettre en lumière le hip-hop swaggé des minorités de genre et faire bouger les capillarités pailletées de ses adelphes de luttes.