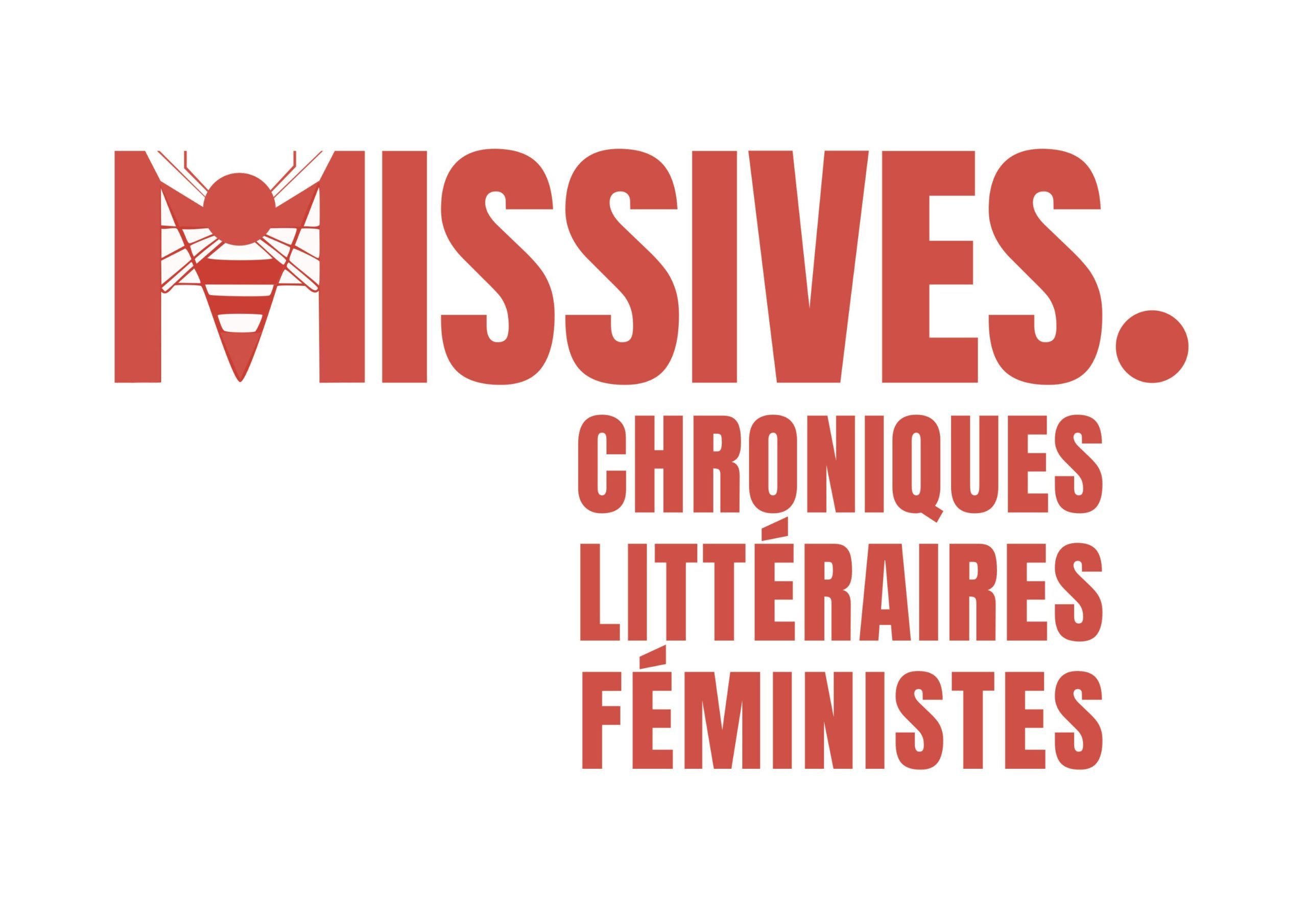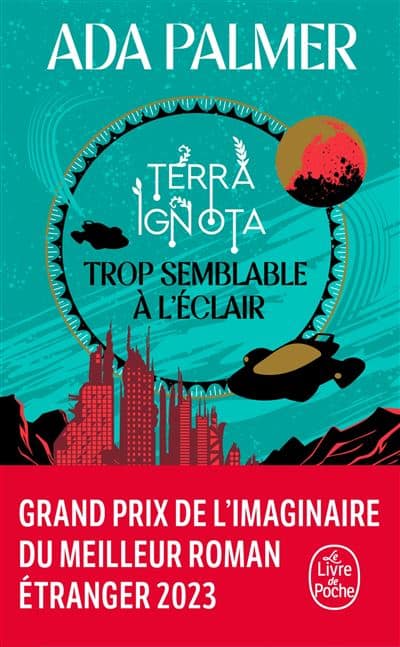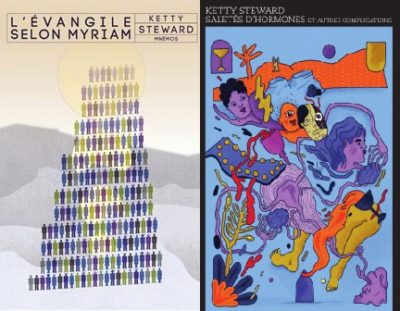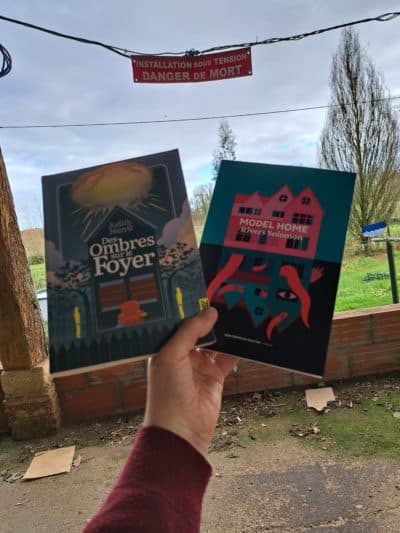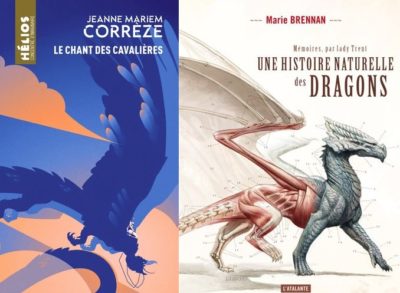Si vous n’avez pas le temps de lire une chronique un peu longue, je commence par une synthèse efficace et percutante :
- Je trouve que Terra Ignota est un chef-d’œuvre à côté duquel Dune et Game of Thrones sont des brouillons de collégien.
- Si vous n’avez pas le temps de lire une chronique un peu longue, en fait, passez votre chemin : rien que les 2 premiers tomes, c’est 1500 pages. 1500 pages intellos, érudites, virtuoses, 1500 pages bien serrées… et qui couvrent 7 jours.
Le troisième tome (sur 5), La volonté de se battre, venant de sortir en poche, c’est le moment idéal pour clamer à la planète mon admiration pour Ada Palmer. Et plus spécifiquement, parce qu’il fallait bien une porte d’entrée dans un monde aussi complexe, m’intéresser dans son œuvre à la question du genre.
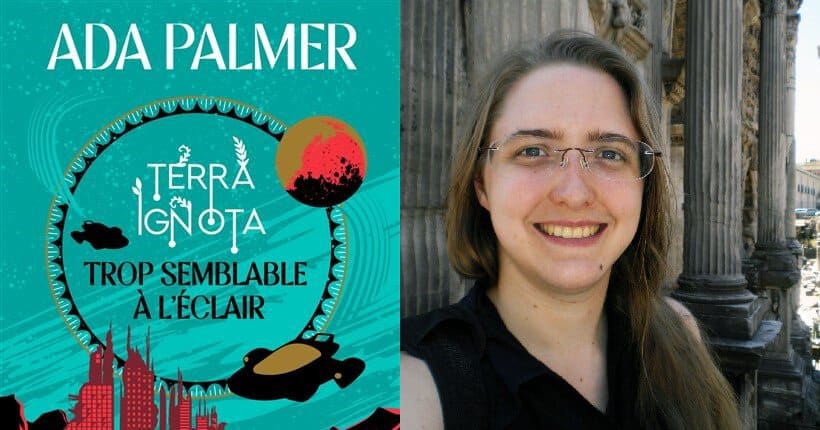
Ce qu’il y a de bien, avec le genre en SF, c’est qu’on peut s’octroyer la liberté d’en court-circuiter les problèmes. On peut rendre la question quasi caduque en bâtissant des matriarcats expurgés de toute violence masculine, comme Elisabeth Vonarburg ou Pamela Sargent. On peut rêver des utopies où les frontières s’abolissent, inventant des langages, des adelphités, des amours nouvelles, où les mauvais souvenirs se dissolvent, comme Margaret Killjoy ou Li-Cam. On peut même, comme Ursula K. Le Guin (La main gauche de la nuit), visiter des planètes peuplées d’êtres hermaphrodites ne marquant aucun dimorphisme sexuel, hormis pendant le rut lors duquel iels ignorent quel rôle iels joueront dans l’accouplement et la fécondation. On peut bâtir des mondes plus simples, plus justes, plus libres.
Et puis parfois le genre revient nous coller aux semelles comme un chewing-gum, ne s’exhibant comme pur construit social que pour se réaffirmer obstinément compliqué.
Terra Ignota brasse beaucoup, beaucoup plus large que la seule question du genre. Elle déborde d’intrigues de couloir, de violences indicibles, de saloperies politiques, de professions de foi enflammées, de retournements d’alliances et de twists philosophico-théologiques. Mais au lieu de cristalliser toutes ces sympathiques ressorts autour d’un enjeu de pouvoir monarchique ou personnel, comme les séries précédemment citées, elle se débarrasse des mécanismes franchement emmerdants de l’autocratie, puisqu’elle se déroule dans un futur utopique mondialisé. Patriotismes et Églises y ont été subsumés au profit des Ruches, rassemblements volontaires autour d’idéologies communes. Exit aussi la famille nucléaire, remplacée par le bash, une structure librement choisie, construite sur la base d’affinités intellectuelles et d’aspirations partagées. Lorsque s’ouvre le premier tome, un événement apparemment mineur survient – le vol d’un classement des personnalités les plus influentes de la planète – qui déverrouille peu à peu secrets et complots. La semaine qui va tout voir basculer est relatée par Mycroft Canner, scrupuleux narrateur et mystérieux personnage condamné à une servitude éternelle par quelque crime passé. C’est sa plume qui nous accompagne à travers les méandres de ce monde Lumières-punk[1], dans un étourdissant dialogue avec Sade, Voltaire ou Diderot, où controverses théologiques et scènes de stupre se relaient comme on ne l’avait pas osé depuis deux siècles et demi. Et Mycroft en est un témoin de choix : il orbite autour de tous les grands de ce monde ainsi que du mystérieux bash Saneer-Weeksbooth, où ladite liste volée a été retrouvée.
Tout ce ballet de personnages est agenre, ce que la traduction française des propos de Mycroft exprime par le recours aux pronoms « on » et « soi » (moins fluides que le they anglais). Dans un monde sans Églises, sans inégalités et sans structures familiales hétéropatriarcales, comment en effet justifier la survivance d’un machin aussi obsolète que le genre ? Tous sont agenres, sauf que pas vraiment, que Mycroft se hasarde parfois à les genrer – pour souligner telle qualité, tel caractère, en se basant sur l’observation des espèces animales ou humaines.
Mes excuses, lecteur. Je sais que l’obligation où je me trouve d’appliquer le masculin à Carlyle est également déconcertante. En ce qui concerne Chagatai, toutefois, vous vous trompez. Ce n’est pas son travail [de gouvernante] qui me pousse à lui donner du pronom féminin, malgré ses testicules et ses chromosomes. Je l’ai vue un jour où quelqu’un menaçait son jeune neveu, et la sauvagerie primitive avec laquelle ses mains épaisses ont réduit le délinquant en lambeaux était indéniablement la force légendaire qui advient aux lionnes, aux chattes, aux oiselles, à toutes les autres femelles frappées de folie par la maternité. C’est cette force qui lui vaut son « elle ».
Il n’hésite d’ailleurs pas à partager avec la lectrice ses repentirs, à se justifier de changer de pronoms, expliquant qu’un acte, une parole, le contraint à naviguer du masculin au féminin, ou inversement. Il s’imagine même les reproches que nous – lecteurices du futur mais parlant comme on écrit au xviiie – ne manquerons pas de lui adresser, consternées qu’il se complaise dans pareils archaïsmes, voire qu’il renoue avec des préjugés sexistes.
Alors arrête, Mycroft. Renonce à ces pronoms in∫idieux, qui me contraignent à prejuger comme jamais je ne le ferois dans le monde u∫uel. Je me dis parfois que tu me changes en hypocrite pour le ∫eul plai∫ir de m’assu∫er d’hypocri∫ie. Si tu n’attachois pas les « il » & « elle » à Carlyle & Thi∫be, je n’aurois pas ∫ouvenir de leur ∫exe, et mes pen∫ees n’en ∫eroient que plus claires.
Agenres, donc, sauf que… pas vraiment. Car – ici la chroniqueuse se doit de rester plus évasive encore – le genre revient, opiniâtre comme un chat auquel on avait fermé la porte et qui se réinvite par la fenêtre ouverte. Dans le monde de Mycroft, le genre n’est pas seulement une survivance narrative, c’est aussi un kink. Un kink XVIIIe, un roleplay érotique, un frisson transgressif. Ainsi qu’un moyen de pression redoutable, dont toustes n’ont pas oublié l’invraisemblable pouvoir sur les humains, et qui, quand il ressurgit, fait souffler sur la politique et sur la pensée un vent destructeur.
Terra Ignota brille par les nombreuses questions qu’elle met en résonance : la consanguinité politique, la fragilité de l’argument du bien commun, la nécessité discutable de la violence et la possibilité de son éradication, la guerre, la croyance, la liberté. Pas plus que ne l’auraient fait les penseurs des Lumières, elle ne se contente de réponses commodes et simplistes. De même, dans son traitement des questions de genre et de sexualité, le roman déconcerte, semblant les éclipser pour mieux les ré-infiltrer au centre même des débats, faisant mine de combattre les clichés pour les réinvestir avec malice. C’est une œuvre brillante, à la fois sincère et retorse – à l’image de son narrateur.
[1] Le suffixe –punk a été accolé à tout un tas de termes en SF depuis la création du néologisme cyberpunk. Le steampunk, en particulier, explore un XIXe alternatif.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.