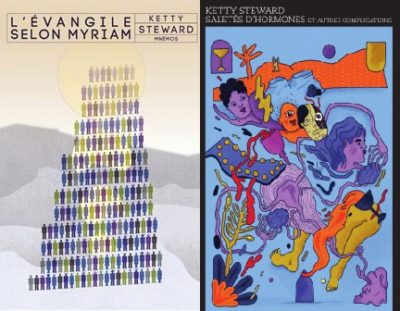Une utopie est-elle nécessairement féministe, même si à aucun moment elle ne s’affiche explicitement comme féministe ?
Vous avez 4 heures.
(Oui, 5h20 si vous bénéficiez d’un tiers temps. Non, on peut pas sortir avant la fin de la première heure. Envoyez de l’aide, je crois que l’Educ’Nat’ a eu raison de ma santé mentale).
Concentrons-nous un peu. J’avais envie de proposer une série, ou une réflexion par épisodes, sur les utopies féministes – depuis Chronique du pays des mères, dont j’ai déjà parlé, jusqu’à Herland et Pollen, qui sont dans la fille d’attente – mais plein d’autres œuvres me mettent en difficulté : écrites par des femmes, OK, mais féministes ? Pas si sûr. Pas qu’elles défendent des positions anti-féministes (faut pas déconner), mais simplement, elles ont l’air de ne pas aborder la question. Je ne suis même pas sûre qu’elles prononcent le mot une seule fois.
Et puis, en relisant et en réfléchissant, je me suis rendu compte que la réponse se trouvait dans cet espace négatif, dans ce silence. Effectivement, ce sont des novellas ou romans qui ne mettent pas ou très peu en scène les luttes féministes, les rapports entre les genres, voire la question même du genre. Mais c’est précisément l’un des nœuds de l’imagination utopique : la question est réglée. Dépassée. On n’a pas besoin d’en parler puisque c’est déjà acquis. Dans ces mondes sans patriarcat, on cligne un peu des yeux avant de nommer ce qu’on ne voyait nulle part dans le paysage, et dont l’absence nous a déconcertée au début, tant sa présence est lourde habituellement. Et puis on soupire avec félicité et on regarde l’espace se peupler d’autre chose.
Trois lectures donc, pour s’offrir trois week-ends dans les mondes où nos luttes pourraient être devenues, comme le vaccin contre la variole, merveilleusement obsolètes. Trois maisons d’éditions que j’adore, en plus, bisous et merci à elles.
Ces trois utopies sont trois enclaves autour desquelles subsiste, insistons tout de suite là-dessus, un monde tout à faut familier, fait de domination, d’exploitation, de violence. Les visages du colonialisme, de la brutalité militaire et de l’écrasement de toute alternative changent sans doute un peu d’une fiction à l’autre, mais la chanson est la même, et on n’en connaît les paroles que trop bien. Ce qui m’intéressera davantage, de ce fait, c’est la manière dont on peut y échapper. Solution qui est toujours, toujours, montrée dans sa fragilité et sa vulnérabilité. Des genres de petits villages gaulois mais avec autre chose que des guerriers testostéronés à la potion magique en guise de défense, tu vois ? Plutôt de l’art et de la pensée et de l’empathie et de la solidarité et de la soif de justice. Quelque chose comme ça. Et l’espoir obstiné que, face au rouleau-compresseur d’en face, ça puisse tenir le coup.
Résolution de Li-Cam est une novella de la collection Eutopia, chez La Volte (2019), collection d’utopies dont il y aurait plein d’autres titres à explorer quand j’aurai le temps. Elle nous invite à passer quelque temps dans l’Adelphie, une communauté structurée autour de Sun, une IA qui a rendu obsolètes les rapports de hiérarchie et de pouvoir et mis l’écoute patiente et douce au cœur des relations entre individus. Sun elle-même a été inspirée et modélisée autour des réflexions de Wen, autiste hypersensible aux injustices et aux racines des conflits, rédigées sur son blog en plein cœur du cataclysme qui a ravagé un monde en guerre – manière pour Li-Cam, elle-même autiste, de donner voix à des angoisses et convictions partagées. Que ce soit dans les tracas techniques ou humains du quotidien, ou dans la pérennité à plus grande échelle de l’Adelphie face à des pressions extérieures qui grondent, on voit la communauté s’efforcer de tenir bon, de repenser son passé, d’appréhender son futur. Le livre se clôt sur une déclaration inspirante – le lycée étant en plein cycle Olympe de Gouges pour encore deux ans, on sait la portée de ces textes-là, et il y a matière à réécrire la déclaration universelle de 1945 pour lui redonner de la vigueur, sans doute. « Tous les êtres humains sont égaux en droits, en dignité et en devoir, par conséquent l’accumulation de richesses et de ressources des uns aux dépens des autres est déclarée CRIME CONTRE L’HUMANITÉ (…) et toute hiérarchie résultant de la création d’une caste dirigeante parasite est ILLÉGITIME. Le sexe, l’âge, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, les croyances et l’origine sociale ne définissent pas un individu et ne doivent pas restreindre son potentiel. » Des fois, ça fait du bien de revenir aux sources et d’en réorienter le cours.
Continuons avec un tour chez nos amis les hippies, dans un San Francisco post-apo devenu communauté artistique, pacifiste et perchée. C’est le projet de La ville peu de temps après, de Pat Murphy (1989, édité chez Les Moutons électriques en 2021). Le récit se cristallise autour d’un retour aux sources qui n’en est pas tout à fait un. A la mort de la mère qui n’a jamais été capable de lui donner un nom et qui l’a élevée loin de toute autre présence humaine, Jax, l’héroïne, part en quête du San Francisco devenu légende dont sa mère lui contait les histoires. Elle y découvre et rejoint une communauté d’artistes attachants et obstinés, créateurs de machines merveilleuses, de jardins lumineux, de tatouages inépuisables, et leur donne des moyens de résister, sans donner la mort, à l’assaut que le sinistre Général veut porter contre cette enclave qui s’obstine à ne pas plier l’échine devant ses offres d’alliance douteuses. Pour cela, il faut imaginer une autre manière de lutter, qui fasse place à la beauté et à une part de folie mais aussi à des ressources tactiques psychologiques – démoraliser l’adversaire par une guérilla poétique. S’inspirer de Gandhi mais aussi de Sun-Tzu et tuer sans tuer. Et voir, à la fin, ce qu’on aura pu sauver de son humanité en refusant de donner la mort.
On doit, enfin, Un pays de fantômes (2014, édité chez Argyll en 2022) à Margaret Killjoy, une autrice trans dont j’ai l’impression que je vous aurai fait comprendre tout ce qu’il faut savoir de sa biographie en vous rappelant qu’elle est à l’origine d’un groupe de metal appelé Feminazgûl. Le roman adopte le jeu du regard extérieur, en l’occurrence celui de Dimos Horacki, petit reporter dispensable balancé sans scrupule par sa hiérarchie pour couvrir le front de manière aussi complaisante que possible, et qui se retrouve malgré lui embarqué par les anarchistes de Hron qui viennent d’attaquer son convoi. Le regard extérieur du fish out of the water peut parfois servir à restituer l’étrangeté de mœurs ou d’idées qui nous sont devenues invisibles à force d’habitude, ou à nous présenter de nouveaux possibles aussi inouïs qu’inimaginables ; ici, au contraire, il rehausse toute l’évidence brute et nette de la pensée anarchiste. C’est une utopie anar qui s’arme, qui s’engueule, qui tue. Personne pour raconter des conneries sur le monde des bisounours ici. C’est aussi une utopie anar qui aime, qui tient bon, qui pense, où tout se resserre autour de ce qui compte. Un « pays de fantômes », étymologiquement, parce que son seul projet d’identité est de se distinguer de tout ce qui l’entoure, d’être « un pays invisible qui affecterait quand même les nations alentour », et dont le combat est immortel et survit même quand les humains tombent, comme les fantômes. Ses mots d’ordres sont aussi frugaux et sobres que son mode de vie : la liberté, qui « tire son origine du respect mutuel, de la reconnaissance de l’autonomie d’autrui, ainsi que de la capacité à nous tenir pour responsables de nos actions ». Pas une utopie des happy ends sirupeux et des lendemains qui chantent, certainement, mais une boussole pour les temps rudes.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.