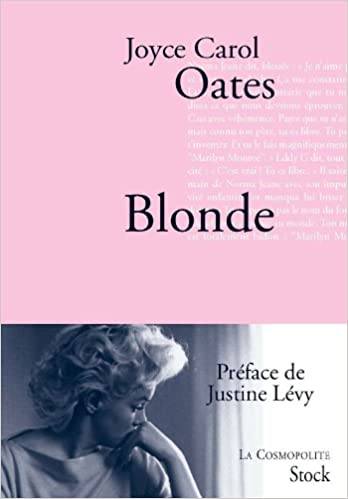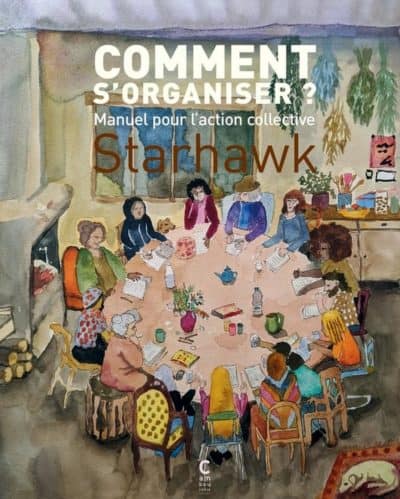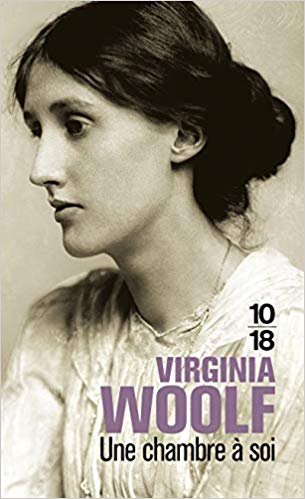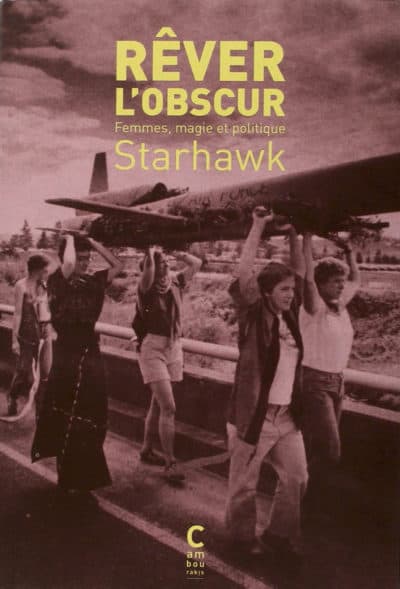Il ne fallait rien moins qu’un monument littéraire pour honorer le mythe Marilyn Monroe. Mille pages, des centaines de personnages, des procédés narratifs multiples : Joyce Carol Oates offre un chant d’amour à celle qui fut haïe autant qu’adulée par une Amérique des années cinquante voyant s’opérer une mutation radicale des perceptions du corps et de la sexualité. Marilyn, sex symbol, poupée peroxydée, pur produit de consommation wharolisé, incarnation du rêve américain et de ses naufrages, fera office de paratonnerre aux fantasmes et aux espoirs, à l’anxiété et à la violence engendrées par cette mue profonde.
L’avertissement liminaire lève les doutes : Blonde doit être lu comme une oeuvre de fiction et non comme une biographie. Tout le talent de l’autrice réside dans sa capacité à livrer une vérité littéraire qui supplante les biographies minutieuses et les documents d’archive, pourtant innombrables.
Le récit, monstrueux et polymorphe, tient à la fois du conte de fées malheureux, de la fiction biographique et de la fresque historique. En effet, la Blonde est dotée d’un double merveilleux, « L’Amie magique » à qui elle s’adresse dans son miroir, et charrie dans son sillage son lot de trolls, de gnomes et de figures archétypales (« Le Prince ténébreux », « L’Ex-Athlète », « Le Dramaturge »…), mais contrairement aux contes de fées où les manques et les blessures d’enfance finissent cautérisées, Marilyn subit et surmonte bon nombre d’épreuves sans pour autant obtenir réparation. JCO invite les lecteurs·ices à suivre la trajectoire personnelle de la fillette sans père, maltraitée par une mère défaillante à l’excès et trimballée de familles d’accueil en orphelinat, qui devient Miss Golden Dreams 1949, pin-up de calendriers puis star hollywoodienne au corps rectifié pour mieux séduire et aux yeux continuellement injectés de sang par les prises massives de barbituriques, au point que Huston, le réalisateur de The Misfits déclare dans le roman qu’il n’aurait pas pu tourner le film en couleur même s’il l’avait voulu. Les conséquences politiques et sociologiques de la Deuxième guerre mondiale, le triomphe de l’industrie hollywoodienne, la mobilisation des soldats américains dans de nouveaux conflits, la traque des communistes dans les milieux artistiques menacés par la fameuse liste noire ne constituent pas seulement un arrière-plan instructif du récit mais sont autant d’épisodes d’une trajectoire collective qui fait corps avec la destinée individuelle au point de se confondre douloureusement dans la mort de l’icône, si étroitement liée aux plus hautes sphères du pouvoir. JCO balaie d’un revers de plume tous les mystères qui entourent la mort de Marilyn, elle tranche !
Blonde est aussi à bien des égards l’épopée de la condition féminine. Viols, avortements, fausses couches, endométriose, violences conjugales, mariage précoce, humiliations : peu des souffrances qui échoient trop souvent aux femmes auront été épargnées à Norma Jeane Baker, baptisée Marylin Monroe par ses agent et producteur comme une friandise à engloutir. Ainsi dépossédée d’elle-même, Marilyn Monroe n’a pas vraiment les attributs d’une icône féministe… Jamais sûre d’elle et toujours en quête d’amour, abîmée par le regard des hommes, victime, proie, incarnation absolue d’un fantasme toute en seins, fesses, hanches, bouche, tout un corps offert à l’adoration et au carnage qui semble hurler « regardez-moi ! Aimez-moi ! » et à défaut, « baisez-moi », ce sera déjà ça… entre « Diamond’s are a girl’s best friend » et « My heart belongs to Daddy » susurrées d’une voix de baby-doll, il y a de quoi faire s’étouffer Beauvoir. Et pourtant ! JCO ne saurait se satisfaire de la figure de la femme-objet, elle explore les multiples facettes du mythe, par définition inépuisable. Marilyn stratège, si peu dupe de son statut, de l’image qu’elle renvoie, capable de déclarer : « Les hommes étaient l’adversaire, mais il fallait faire en sorte que l’adversaire vous désire. » Marilyn acharnée de travail, qui demande inlassablement aux réalisateurs de refaire les scènes, prend des cours d’art dramatique et lit Stanislavski, s’étoffant de prise en prise à mesure que les autres acteurs·ices pâlissent, s’éclipsent et disparaissent à son contact incandescent. Marilyn à l’humour « caustique et dissonant », « comme de mordre dans un chou à la crème et d’y découvrir du verre pilé ». Marilyn lectrice attentive de L’Origine des espèces de Darwin et des Pensées de Pascal, offertes par Marlon Brando, le frère en détresse, le seul qui « ne donnerait aucune interview » sur elle après sa mort, « Lui seul de tous les chacals de Hollywood », rare figure masculine bienveillante aux côtés de Whitey le maquilleur qui se mettait au travail sur elle « comme on ressuscite un cadavre » et d’Arthur Miller, le « Mari délaissé » mais toujours tendre et aimant. On découvre enfin une Marilyn qui écrit et noircit ses carnets de fragments poétiques, reflets de son intimité brute et parfois décousue, à l’image des nombreux passages en forme de monologue intérieur qui jalonnent le roman, identifiés par une typographie particulière – espaces blancs, ponctuation hiératique et abondance d’esperluettes (&) – qui matérialise peut-être le bégaiement de Marylin, son phrasé rendu hésitant par la timidité, le Nembutal, ou les deux.
La métaphore du colibri s’avère féconde pour évoquer Marilyn Monroe. Dans l’un des épisodes les plus mémorables du roman, la jeune Norma Jeane, sur le point de passer l’audition qui lancera sa carrière, est convoquée dans le bureau de M. Z. S’y joue alors une scène menaçante, archétypale, dont l’issue semble inexorable et d’une effroyable violence. La jeune femme est invitée à visiter l’hallucinante et sinistre volière du puissant producteur, elle passe en revue les oiseaux qui lui font penser à des actrices célèbres et évoque le colibri, son oiseau préféré. Minuscule, d’apparence fragile, condamné à se poser sur les branches et non sur le sol en raison de la forme de ses pattes, se nourrissant à 90 % de nectar et qui possède le plus gros cœur de tous les oiseaux, capable de voler en arrière et sur place à une vitesse extraordinaire… Puissante Norma Jeane, insaisissable colibri, soulagée de n’en découvrir aucun spécimen dans la volière, et qui se verra baptisée Marilyn Monroe à la fin de ce même chapitre.
J’ignore si The Misfits est parvenu à combler les attentes de Marilyn, qui se réjouissait de pouvoir y déployer ses talents d’actrice en incarnant Roslyn Tabor, personnage plus sérieux, plus profond que tous ses précédents rôles l’enfermant trop souvent dans des parodies de féminité.
Mais indubitablement, le roman magistral de Joyce Carol Oates y parvient.
« Pas une chose blonde ! Une femme, enfin. »

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.