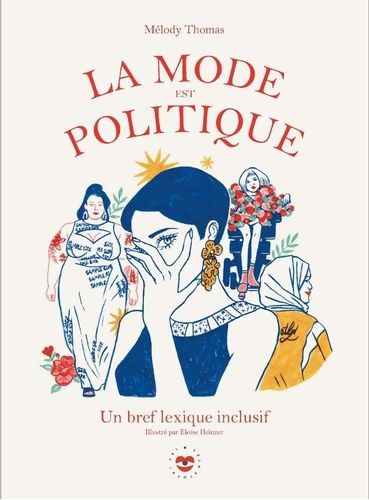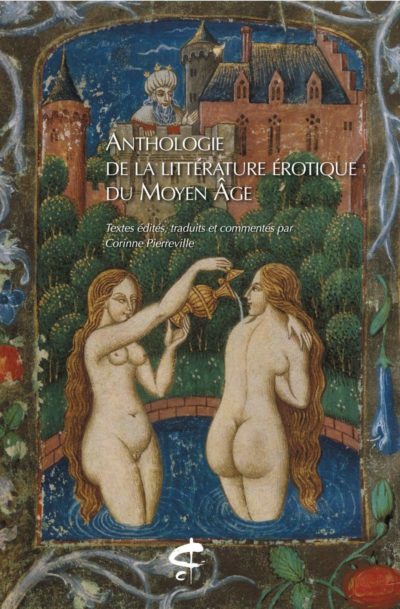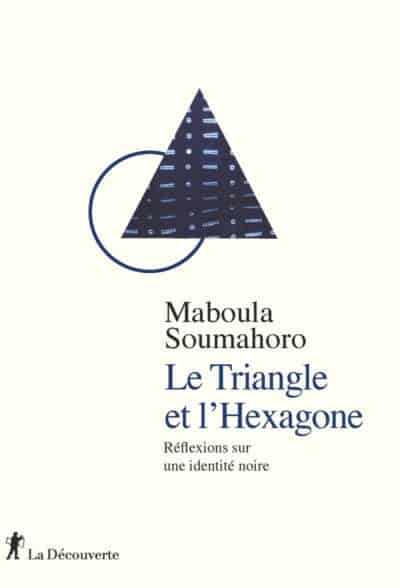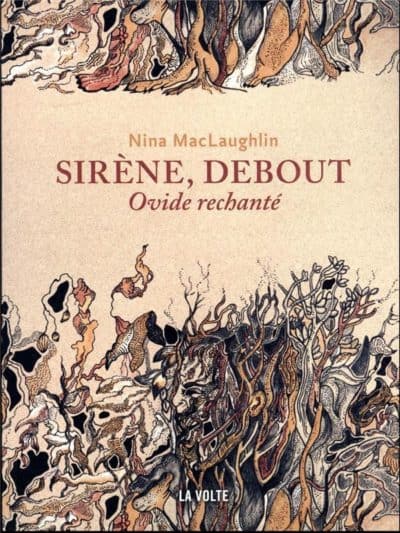Françoise Vergès est une chercheuse et militante féministe décoloniale. Elle a grandi à La Réunion aux côtés de parents engagés au sein du PCF. Après avoir passé ses années lycée en Algérie, elle a validé un doctorat à l’université de Berkeley (Californie) aux États-Unis. Ses recherches et écrits concernent entre autres la mémoire de l’esclavage, la psychiatrie coloniale ou l’économie de prédation.
Dans l’ouvrage dont il est question ici [1], Françoise Vergès introduit sa réflexion en parlant des ouvrières de la gare du Nord qui ont fait grève pendant 45 jours consécutifs en 2017. Leur victoire, nous rappelle l’autrice, a été occultée par la parution de la tristement fameuse tribune sur le « droit d’importuner ». La concomitance de ces deux informations est révélatrice d’un point de vue militant : pendant que certaines femmes, invisibilisées et reléguées à la marge, se battent pour leur survie et la dignité de leurs conditions de travail, celles qui n’ont pas besoin d’y penser prennent le temps de défendre la « galanterie à la française » dans les médias.
C’est en partant de cet exemple que l’autrice définit ce qu’est le « féminisme civilisationnel » : un féminisme qui perpétue les dominations, notamment les dominations de classe et de race, et qui ne se bat finalement que pour l’égalité des genres, sans réfléchir aux inégalités dans leurs multiples dimensions. Il se rend de fait complice de l’absolutisme capitaliste et de l’organisation postcoloniale du monde, et notamment du monde du travail.
Ce sont les féministes civilisationnelles qui, au milieu du XXe siècle, comparaient la condition des femmes à l’esclavage, sans pour autant remettre en cause le colonialisme ni inclure la défense des femmes esclaves dans leurs revendications. Françoise Vergès rappelle que si les femmes blanches et bourgeoises n’avaient par le passé que peu de droits civiques, elles avaient toutefois le droit de posséder d’autres êtres humains comme des « meubles ». Les femmes esclaves, elles, étaient alors considérées comme des objets et n’avaient, de fait, pas de genre pour lequel défendre des droits.
Ce féminisme blanc bourgeois autoproclamé universel cherchera par la suite à « aider » les femmes racisées ou issues de milieux populaires qui n’auraient pas les clés pour comprendre leur situation. Cette position néocoloniale du féminisme a par exemple été utilisée par les Françaises en Algérie pour obtenir l’adhésion des femmes lors du conflit. Elle est également utilisée régulièrement depuis le début du XXIe siècle et s’incarne dans l’obsession pour la question du voile. Dans les années 1980, le pouvoir politique, et notamment le Parti socialiste, a compris qu’il devait inclure les questions féministes dans ses statuts car le patriarcat était à l’époque trop associé à la droite. C’est ainsi qu’un féminisme blanc, bourgeois et complètement déradicalisé a fait son entrée en politique. Il en a profité pour changer d’ennemi. Dans un monde où l’égalité des sexes en Occident était considérée comme acquise (LOL), il fallait s’attaquer au vrai problème : l’Islam, une religion « par nature » avilissante pour les femmes, dont le symbole n’était autre que le voile. Il fallait dévoiler les femmes musulmanes, ce que Françoise Vergès caractérise d’« intégrisme laïque teinté d’orientalisme ». Tout cela a conduit à un effacement complet des luttes féministes du tiers-monde et des femmes noires, et à l’installation d’une sororité néocoloniale et complètement manichéenne.
Pour ces « fémonationaliste », ces « fémo-impérialistes », ou ces « fémo-fascistes », les musulmans menaçaient les acquis féministes. Ce que nous rappelle l’autrice, c’est que « pourtant, ni les menaces sur les lois sur l’avortement et la contraception, ni l’exploitation des femmes racisées et des femmes migrantes, ni la systématisation du travail partiel sous-payé et sous-qualifié pour les femmes en Europe n’ont été le fait des musulmans ». De plus, cette focalisation sur la nécessité d’éduquer les mentalités évite de s’attaquer au véritable problème, à savoir les mécanismes structurellement oppressifs de nos sociétés. Cela vide les luttes féministes de leur radicalité et de leur portée historique. Cette dévitalisation des luttes révolutionnaires passe également par la réécriture des récits militants des femmes racisées. L’autrice prend l’exemple de Rosa Parks dont le combat a été totalement dépolitisé et extrait de la lutte collective dans laquelle il s’inscrivait, celle du Women’s Political Council. Cet effacement des luttes collectives a une autre conséquence : il présente le racisme comme un crime passager qui aurait été réglé par le courage d’une personne isolée, et non comme le système oppressif et systémique qu’il est réellement et contre lequel des militant·es se battent depuis des siècles.
« C’est une fois débarrassées de leur féminisme radical et de leur militantisme que des femmes peuvent devenir des figures de l’histoire nationale. »
Le féminisme décolonial incarné ici par la pensée de Françoise Vergès a donc comme première force de démasquer ce féminisme civilisationnel, mais il tend surtout à la reconnaissance des luttes collectives passées et présentes des femmes du Sud. Ces luttes s’inscrivent dans une temporalité longue, avec des victoires et des défaites, mais toujours dans l’objectif de renverser à la fois le racisme, le capitalisme et l’impérialisme qui sont indissociables.
« Le féminisme décolonial, c’est dépatriarcaliser les luttes révolutionnaires. »
Françoise Vergès préfère ainsi parler d’une analyse « multidimensionnelle », plutôt que d’une analyse intersectionelle. « Sectionner » les luttes, c’est ouvrir la porte à un féminisme blanc et/ou bourgeois. En analysant la domination dans toutes ses dimensions, on s’attaque simultanément à toutes les racines du système. Sans cette décentralisation de la pensée, on ne peut pas se rendre compte que les droits des femmes ne sont pas appliqués de la même façon pour les femmes blanches et pour les femmes racisées. C’est pourquoi la révolution féministe ne pourra être effective qu’en s’inscrivant dans un combat décolonial contre l’axe dominant Nord-Sud.
« Toutes les femmes ne sont pas égales, tous les hommes ne sont pas égaux ; donc de quels hommes les femmes devraient-elles aspirer à être les égales ? »
C’est en occultant volontairement tous ces aspects des revendications décoloniales que la France a cherché à attirer les femmes racisées dans le marché néo-libéral. Alors que les femmes blanches s’émancipaient et accédaient de plus en plus à des postes importants, il fallait que d’autres s’occupent de leurs enfants ou du travail ménager. On a donc incité les femmes des Antilles, de La Réunion ou de la Guyane à venir occuper des postes considérés comme avilissant par les féministes bourgeoises, dans le domaine du soin (care), du ménage ou de la cuisine (via le BUMIDOM[2] puis l’ANT[3]).
« La vie confortable des femmes de la bourgeoisie dans le monde est possible parce que des milliers de femmes racisées et exploitées entretiennent ce confort. »
Ces questionnements autour de la place des femmes racisées dans le travail du care, et donc dans la reproduction sociale, sont primordiaux car ils permettent de visibiliser le fait que « les femmes noires ont été assignées au rôle de personne […] qui nettoie le monde des Blancs ». L’intégralité de notre économie tourne en s’appuyant sur l’usure et la fatigue des corps racisés. À cela s’ajoutent des abus de pouvoir structurels qui normalisent des conditions de travail indignes ainsi que le harcèlement et les violences sexuelles envers ces femmes précarisées.
« Toute une humanité est vouée à effectuer un travail invisible et surexploité pour créer un monde propre à la consommation et à la vie des institutions. »
Françoise Vergès pose donc cette question : « Qui
nettoie le monde ? » En ces temps de pandémie où ce même monde tourne
en grande partie grâce à des femmes, et notamment grâce à des femmes racisées
(caissières, aides soignantes, aides à domicile, agentes d’entretien…), ce
questionnement mériterait d’atteindre les sommets de nos gouvernances qui ne
sont visiblement pas allés au bout de leur décolonisation.
[1] Un féminisme décolonial, Françoise Vergès, La Fabrique, Paris, 2019.
[2] Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer.
[3] Agence nationale pour l’insertion et la protection des travailleurs d’outre-mer.
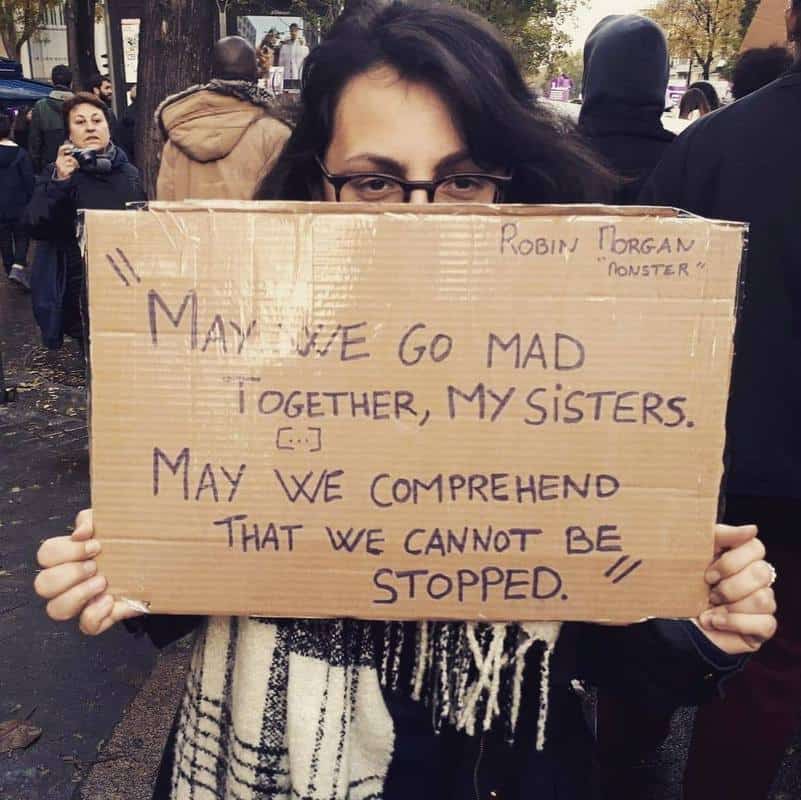
Viscéralement littéraire, éditrice de formation, libraire de profession, Manon passe une grande partie de son temps entourée de livres. Mona Chollet a changé sa vie, même si elle ne le sait pas. À ses côtés, Virginie Despentes, Simone de Beauvoir, Manon Garcia et tant d’autres forment le bouclier qui l’aide, pas à pas, à faire reculer le patriarcat.