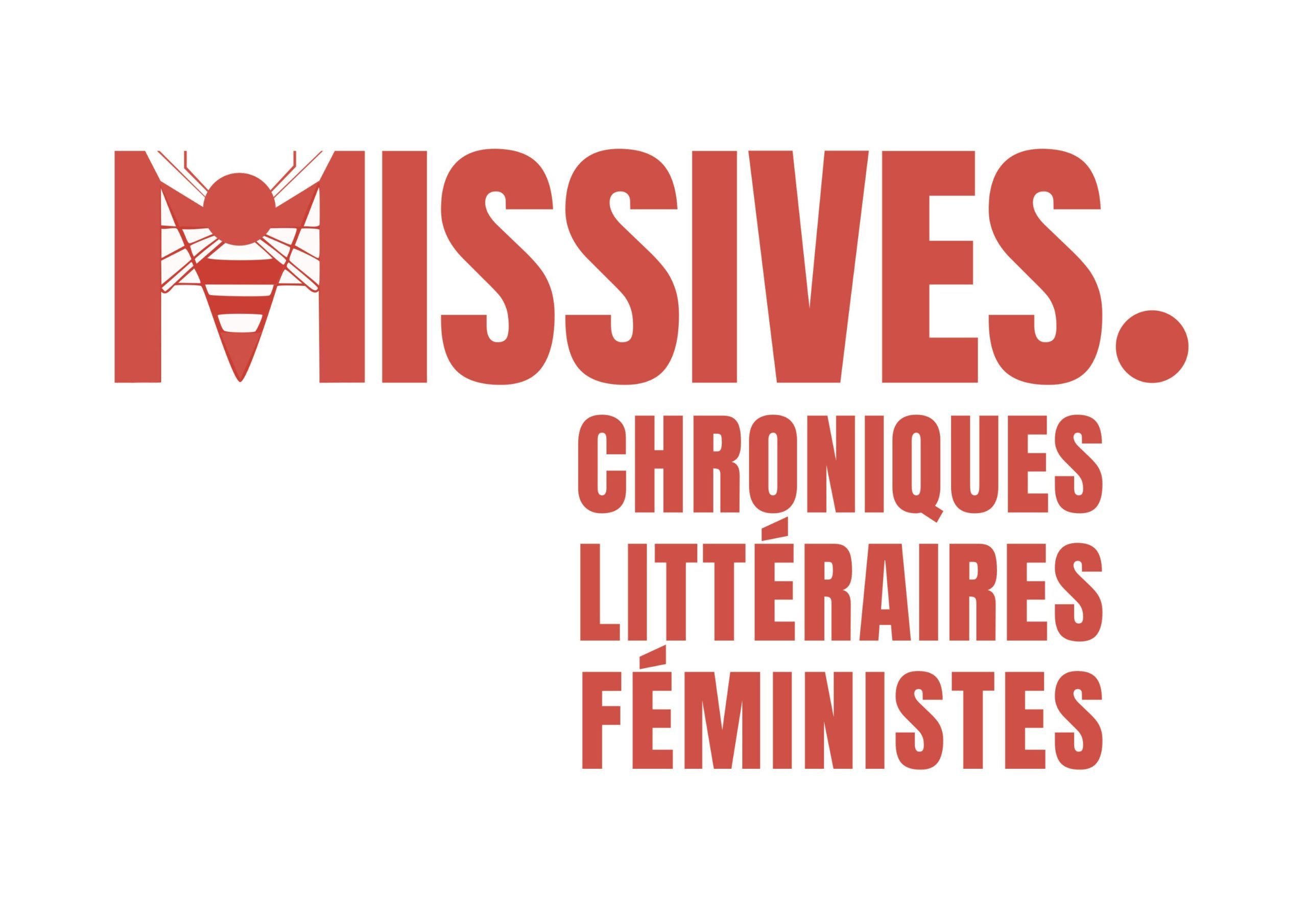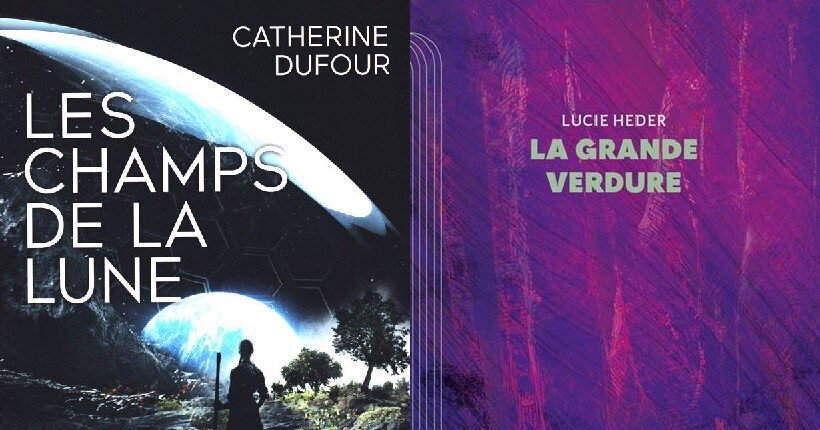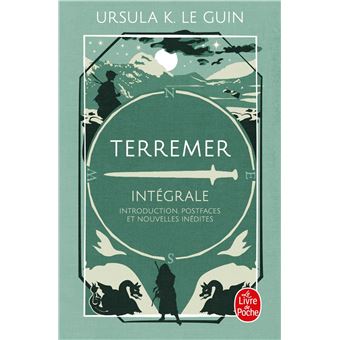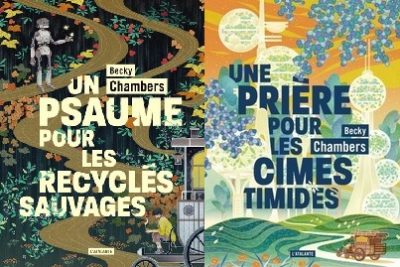Déclaration d’intérêts : l’autrice de ces lignes est une femme autiste tardivement diagnostiquée et nourrissant depuis toujours un intérêt spécifique dévorant pour la botanique. Imaginez ma joie, donc, puisque Les Champs de la Lune, dernière publication de la remarquable Catherine Dufour, et La Grande verdure, de Lucie Heder, nouvelle arrivée à la Volte (Welcome sister !), foisonnent de plantes – sous le taillis desquelles se trouvent d’autres merveilles.
Les fleurs, la narratrice des Champs de la Lune en prend soin dans sa ferme, en horticultrice virtuose et appliquée. Rare habitante de la surface lunaire après qu’un exode a vidé la Terre, El-Jarline s’emploie, pour la majorité humaine soulunaire, à faire pousser dans sa vaste ferme les végétaux nourriciers, ornementaux ou bienfaisants dont ils ont besoin pour survivre. Outre son chat augmenté Trym, ses interlocuteurs sont quelques rares collègues et, surtout, les destinataires manifestement indifférents de ses rapports d’exercice, qu’elle veille pourtant à rendre plus narratifs, plus fleuris, à leur demande. Elle a beau multiplier les alertes – les minicolas prolifèrent et une faille s’élargit – en face, ça ne fait pas grand-chose. Mais la vie solitaire convient bien à El-Jarline : pas de small talk oiseux, de conventions irritantes. Jusqu’à ce qu’elle rencontre, à la cité soulunaire de Mut, Sileqi, une gamine aux talents de jardinière dont elle voudrait faire son apprentie, parce qu’avec elle, quelque chose semble vouloir éclore.
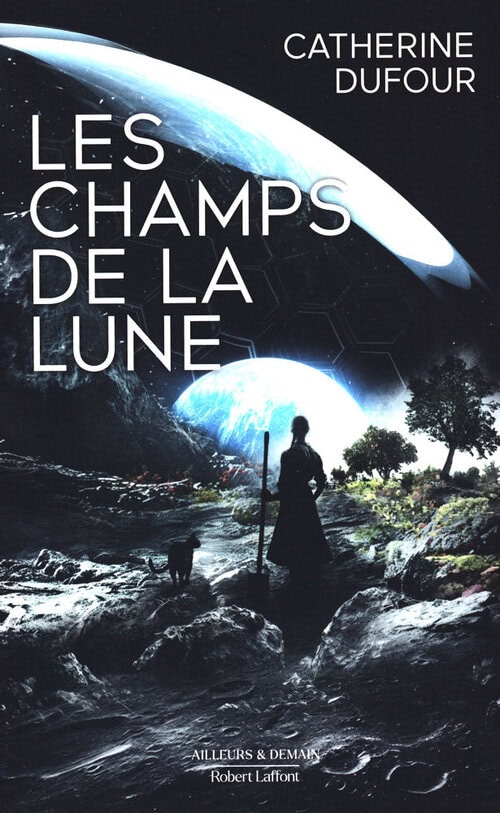
Les fleurs, la narratrice de La Grande verdure en a pris soin dans sa communauté éponyme. Mais elle s’est barrée et maintenant, elle arpente les no woman’s land hostiles de la post-apocalypse, lentexplorant pour éviter les têtards espions, cherchant un espace à l’abri du vendur où s’implanter. Lierre étouffait dans les carcans de ce collectif féminin où chaque conversation suit les embranchements d’une plante, où les végétaux servent à codifier, extérioriser, synthétiser – imposer ? – chaque émotion, chaque intention : zinnia rouge pour la colère, fenouil pour la nécessité d’un long débat. Personne, à la grande verdure, ne comprend pourquoi ce mode de vie apparemment si doux, si prévenant, si attentif à ne pas réactiver les traumatismes, a fini par l’asphyxier. Son départ cristallise interrogations et injonctions. Jusqu’à ce que Lierre rencontre Sable, autre habitante des friches, à la communication déconcertante, directe et tactile ; malgré des débuts difficiles, elle en vient à se demander si avec elle, quelque chose pourrait éclore.
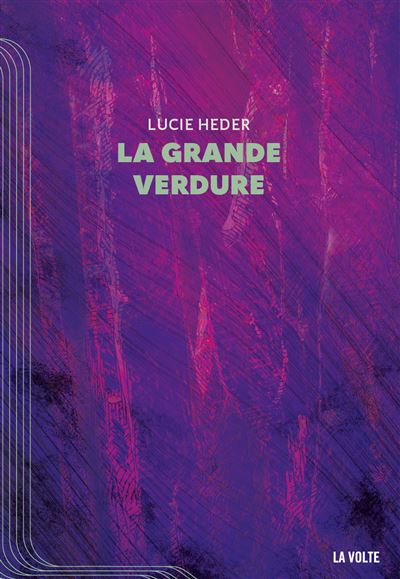
La narration d’El-Jarline est détachée, avare d’images, volontairement factuelle et rechignant à s’attarder dans le récit. La narration de Lierre est touffue, proliférante, une grimpante qui squatte la page en petites phrases serrées, pensées-actions-réactions. L’une comme l’autre parlent fleuri : le monde pour elle prend sens dans le lexique végétal, les métaphores de l’enracinement ou de la pousse, de l’arborescence ou du compost. Mais du langage, elles demeurent à la marge, comme de la société, de la « normalité ».
Si j’ai voulu rapprocher les deux romans, ça n’est pas seulement pour des histoires de fleurs, même si je ronronne de plaisir quand on me parle de muehlenbeckia ou de dionées. C’est surtout que les deux œuvres interrogent, chacune à sa manière, le choix de vivre en marge, en marge d’un monde même pas si moche, même pas si hostile. Un monde qui les accueillerait, si elles le voulaient. On croit toujours qu’en SF les mondes qu’on fuit sont invivables. Mais pas forcément. Ça n’enlève rien à la portée du cri, à la puissance de la phrase, de celles qui décident que pour elles, la société, là, ça va pas être possible.
Je crois que c’est un thème profondément féministe : le choix de refuser un modèle social alors même qu’on pourrait y vivre pas si mal. Pour combien d’entre nous il a cette tête-là, le patriarcat ? Je crois que c’est une thème profondément queer, aussi : le refus des injonctions pseudo-bienveillantes à rationaliser, à justifier, à se justifier. Et puis, si j’ai voulu faire discuter Les Champs de la Lune et La Grande verdure, c’est parce que Lierre, Sable, El-Jarline, appartiennent à la grande famille de celles-qu’on-trouve-bizarres.
El-Jarline, pour moi, elle est autiste, c’est jamais dit mais ça bourgeonne dans toutes ses phrases. Elle ne se répand jamais en pathos mais elle vibre des injustices qu’elle observe ; elle est prête à traverser la surface lunaire et ses robots fous pour trouver les réponses à ses interrogations sur la fièvre aspic. Cette intensité à fleur de regard alliée à ce détachement apparent, cet effort pour déchiffrer les humains depuis la solitude choisie, ça sonne si juste après des décennies de clichés. On commence à leur donner voix, à ces neuroatypies féminines si longtemps tues, niées, invisibilisées parce qu’on a bricolé nos symptomatologies sur des modèles masculins. En faire des narratrices est salutaire – révolutionnaire.
Et Sable, elle est, elle est quoi : strange. On peut lui coller des mots, dire qu’elle est trans, qu’elle est traumatisée, qu’elle a un schéma corporel dysfonctionnant, une difficulté manifeste à assimiler les codes sociaux, une communication qui s’emmêle dans les limites des autres. On pourrait résumer ça comme le fait la grande verdure, en mettant des petites plantes nettement étiquetées dans des petits pots. Ou on peut laisser fleurir son droit à exister, comme celui de Lierre à se barrer. Parce que dans ce récit, la résolution ne s’exprimera pas dans la victoire d’un point de vue, mais dans l’exploration curieuse des interstices.
Dans les deux cas, ce qui germe, c’est moins la critique facile (t’as vu, la société, comme elle est pas sympa) que le décentrement du point de vue et de la perspective. Comme des impressionnistes qui font virer la lumière sur un jardin : décaler le regard et voir comment ça change le tableau.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.