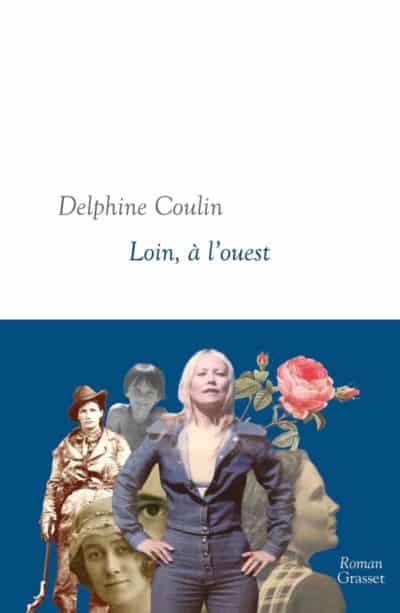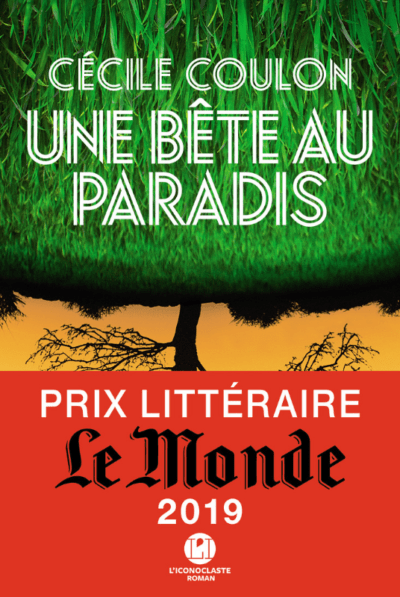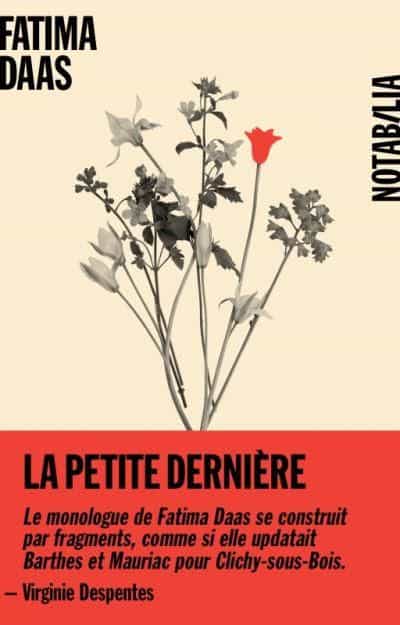Avec Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter signe un essai saisissant, hybride, sur la fiction. Sorte de déambulation primesautière dans la littérature plus ou moins sérieuse, le texte interroge notre idée du bon récit bien ficelé, efficace, celui du mythe fondateur, destiné à rester dans les anthologies et les mémoires collectives. Tiré d’une pièce de théâtre jouée en 2020 à la Fabrique, Comédie de Valence, le texte est repris sur scène cette année au théâtre du Rond-Point où nous retournerons sur les bancs de la fac assister au meilleur cours de linguistique, de sémiotique, et de narratologie, jamais préparé pour des étudiant.es enfin libéré.es des ronchonneux en cravate de l’Université. Conférence gesticulée de haut vol, forme creuset où s’empile la somme des histoires qui nous font depuis des siècles, on vous promet une heure de profonde hilarité érudite.
C’est le plus grand hold-up que l’humanité n’ait jamais connu ! Un crime de haute trahison enfin révélé par une association de fouineuses qui, génération après génération, se mêle de partir en quête d’un récit des origines. Elizabeth Fischer, Ursula Le Guin et à présent Alice Zeniter, qui a relu les grandes sœurs, se sont toutes posé la question suivante : et si les histoires qu’on nous raconte et qu’on imite inlassablement – la puissance des héros mâles, les lances dures et pointues qui s’enfoncent dans la chair de la bête monstrueuse et la terrassent, l’asservissement des forces naturelles – si tout cela, au fond, ce n’était que du flan ? Une pyramide gélifiante qui oscille à droite et à gauche, qui fascine plus parce qu’elle est répétée des centaines de milliers de fois, que par sa valeur inhérente de bonne histoire. L’éternel récit du dominant, un mec à qui il arrive des trucs, qu’on nous enseigne dès l’école primaire avec son schéma narratif actanciel, qui nous baigne les oreilles et les yeux à chaque nouvelle lecture, ne serait qu’une trahison primordiale à ce que fut vraisemblablement le cœur du récit fondateur de l’humanité. À l’origine, il n’y eut ni lance, ni tibia utilisé comme masse, ni flèche providentielle, pour nous maintenir en vie, comme on le découvre avec effarement, mais un panier, très probablement, un filet, une écharpe, une calebasse, qu’importe, un récipient capable de conserver plus d’une poignée de baies, de racines ou de feuilles quand nous partions collecter de quoi subvenir à la communauté. Or, sur le marché hautement concurrentiel de la bonne histoire à raconter, la fiction panier comme la nomme Ursula Le Guin ne fait pas le poids face à la fable spectaculaire des chasseurs de mammouth !
Nous avons été floué.es, dupé.es, abusé.es et Alice Zeniter comme un pied de nez inaugural nous accueille avec un titre en forme de gros mensonge puéril « Je suis une fille sans histoire ». Elle, la lauréate du Prix Goncourt lycéen 2017 pour L’art de Perdre, multiprimée pour ses autres œuvres, essaie encore de nous faire croire qu’aucune fiction ne s’attache à ses pas. Ce titre ressemble surtout à un avertissement : méfie-toi lecteurice qui entre ici, nous allons renverser le monde tel que tu le connaissais, tout jusqu’à présent n’a été tissé que de mensonges. Comme le héros Truman Burbank dans le film The Truman Show s’aperçoit que sa réalité n’est qu’un grand plateau de tournage, les gens autour de lui, des acteurs, et lui-même, la star d’une émission de télévision suivie par des millions de téléspectateurs, nous ouvrons les yeux sur la grande mystification dont nous avons été victimes. Une énième version du mythe de la caverne, désopilante cette fois. On vous recommande particulièrement le chapitre savoureux « Aristote-Atelier » où le maître de la poétique anime un master d’écriture littéraire entouré de fameux élèves tantôt disciplinés tantôt mutins, ou encore ce passage où Alice Zeniter se demande où ont bien pu disparaître les femmes dans les romans, phénomène connu sous le nom de « syndrôme de la Schtroumpfette » :
« Quand on y réfléchir un peu, [Katha] Politt aurait aussi pu baptiser le problème ‘syndrome de la Castafiore’ (où sont les femmes dans le monde de Tintin ? Toutes enfermées dans une cave géante du château de Moulinsart ?) ou encore ‘syndrome de Ocean’s eleven‘ (pourquoi y a-t-il douze mecs pour une meuf dans chacun de ces films ? Ce n’est pas du tout représentatif de la population américaine qui compte 0.97 homme pour une femme… Où sont les femmes manquantes de ces films ? Sont-elles enfermées, elles aussi, à Moulinsart ? […])»
Pour une fille sans histoire, elle en fait des histoires et n’a pas l’intention avec cet essai de caresser notre sécurité narrative dans le sens du poil. Elle questionne avec humour ce canevas qu’on retrouve partout dupliqué dans la pop culture des BD de Tintin et des Schtroumpfs, dans des monuments de la littérature tel Anna Karénine, des grands textes théoriques comme L’Art Poétique d’Aristote, dans les films américains dans lesquels les mêmes éléments miracle font merveille : des conflits intenses, des moments de tension dramatique terribles, des chasses, des mises à mort qui sont surtout vécus par des personnages masculins et renouvellent sans cesse l’image du chasseur préhistorique, écrasant d’un même geste discursif les femmes de sa communauté et la nature, davantage pensée comme le décor de ses exploits que comme un ensemble complexe de manières d’êtres vivants. Vu ainsi, impossible pour une femme ou tout autre individu englué sous le pouvoir d’un autre, de prendre la place du héros qui sera forcément un homme au destin hors du commun.
Mais il faut aussi rappeler le pouvoir de la fiction, les liens qu’elle entretient avec le réel. En reprenant à son compte les analyses d’Umberto Eco sur la puissance de la fable, la façon dont elle affecte notre imaginaire et la construction de la réalité, Alice Zeniter démontre magistralement qu’on ne doit pas sous-estimer l’impact de la fiction dans notre représentation du monde : verser des torrents de larmes sur la mort d’un personnage dont on sait qu’il n’est pas réellement mort, puisqu’il n’existe pas, prouve que nous n’arrivons pas totalement à attribuer le statut de mensonges à ces fictions. Nous les intégrons comme une modalité de réalité parmi d’autres. Le récit possède donc une puissance symbolique capable de supplanter la réalité.
Difficile d’échapper à la fiction dans notre vie de tous les jours ; déjà parce que notre société de loisirs consacre beaucoup de temps à regarder des films, des séries, à lire des livres, mais aussi par ce que « nos vies sont en grande partie faites de texte empilé sur du texte », impossible pour nous d’aller vérifier chaque énoncé qu’on nous confie : nous devons faire confiance à la communauté, passer un pacte qui établisse que celui qui parle ne nous ment pas a priori. Quand on hérite d’une fiction comme celle du chasseur de mammouth, a fortiori quand elle est transmise par une institution puissante comme l’école, on ne la remet pas en doute.
Isabelle Stengers, citée par Christine Aventin dans Feminispunk dit, à propos de Donna Haraway : « Dis-moi comment tu racontes, je te dirai à la construction de quoi tu participes. » Parler, écrire, ça improvise du réel en fait. La langue est une machine subversive puisqu’ elle permet de changer le prisme par lequel on voit le monde. Alice Zeniter, elle-même, a dû changer de lentille :
« Plus récemment, j’ai appris à l’école que lors de la reproduction les spermatozoïdes, courageux et véloces, fonçaient pour féconder un énorme ovule immobile. Or, on sait désormais que l’ovule n’est pas un élément passif : il choisit et enlace le spermatozoïde qui va le féconder. Ce qu’on m’a enseigné est un récit de chasseur comme celui que décrivait Ursula Le Guin, un énième récit de mec-qui-fait-des-trucs, un récit qui s’insère ans le récit plus large d’une époque patriarcale dans laquelle l’homme est pensé comme conquérant et la femme comme domestique. »
Nos récits étalons, comme nos savoirs scientifiques, sont aussi soumis à une date de péremption semble-t-il. Alice Zeniter a annoncé la fin de la candeur. Le film An 01 de Doillon avait proposé « On arrête tout », et on voit. Faire taire le vieux récit et inventer, comme Pippi Longues Chaussettes qui crée de toutes pièces un mot nouveau pour combler un besoin, les mots qui nous manquent pour faire exister d’autres histoires. En fabulant, on fait advenir des réalités nouvelles. Tout à coup, Je suis une fille sans histoire entre en résonnance un passage du livre de Christine Aventin, FéminiSpunk, (paru en avril 2021) propulsant la pensée de Zeniter sur la scène punk et la rendant moins orpheline :
« La langue -inventer les mots qui nous manquent, détourner les mots qui nous marquent – est un outil insurrectionnel. Use langage as a weapon. Il suffit de voir ce que ça crée comme puissance la métamorphose vocale d’une girl en grrrl. Tu la sens bien, la rage ? Et comment dès la première prise -c’est une prise de pouvoir – tu deviens accro ? […] Comment tu la dégrippes d’un seul coup ta mécanique identitaire, et comment tu vas pouvoir, enfin, aller jouer dehors ?
[…] Tout ce qui finit par exister dans le réel a d’abord existé dans l’imagination de quelqu’un. C’est pourquoi il nous faut nous-mêmes inventer les récits qui nous manquent car il n’y a pas la moindre chance qu’ils soient écrits par d’autres. »
Les deux autrices se rejoignent sur l’urgence à se saisir d’un nouveau récit, à ne plus attendre qu’il surgisse de lui-même. On pourrait imaginer une fiction qui saurait « garder l’Homme à sa place ». Je vous laisse découvrir sous une ramée de jeunes feuilles de chêne ce que ce nouveau récit pourrait être dans le dernier chapitre. A nous de continuer le sentier au milieu des oiseaux, en bonne compagnie comme toujours …

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.