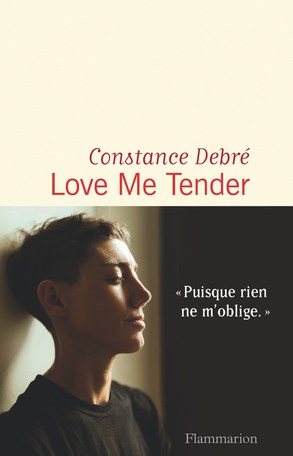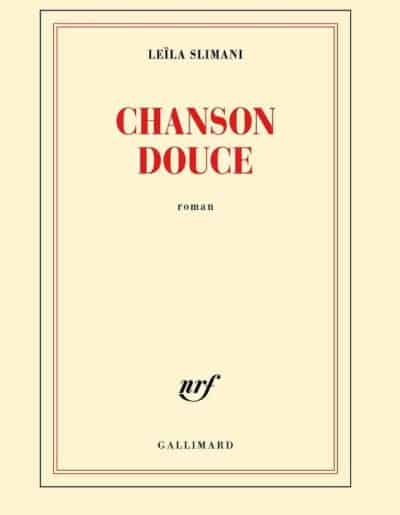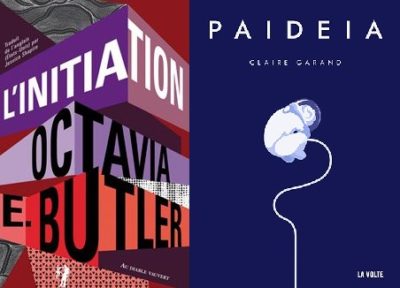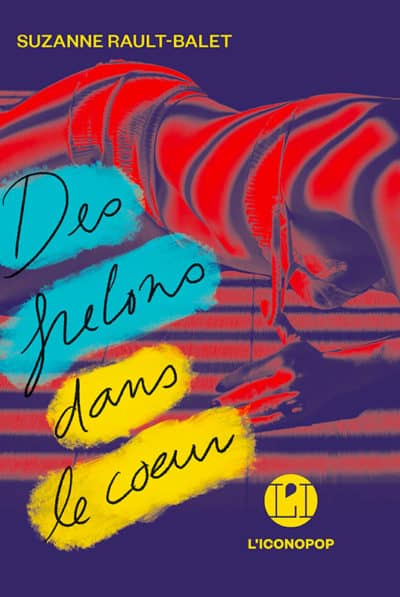Une mélodie vitale : c’est l’effet que m’a fait ce texte de Constance Debré. Une énumération des façons d’aimer, des petits riens qui distinguent l’élu·e de tout le reste, de ce qu’on peut faire quand on est ensemble : “on allait à la plage, on prenait des granités, un vendeur ambulant criait, on riait, on allait dans les églises, on regardait les poulpes sur les étals, il dansait dans la rue, il tournait sur lui-même en écartant ses bras immenses, il chantait.” Ces fulgurances, ces détails qui pourraient passer inaperçus sous le flux de la vie quotidienne, l’autrice les remarque dans une tentative de récupération de sens, de reconstitution de sa vie après avoir tout détruit.
S’inscrivant pleinement dans le courant de l’autofiction, Constance Debré évoque dans ce texte, qui vient après le très remarqué Play Boy, l’influence qu’a eue son entrée fracassante dans le monde littéraire. Et pas des moindres : après avoir plaqué son hétérosexualité et son métier d’avocate, et donc introduit une dissonance au sein de sa (célèbre) famille bourgeoise conservatrice, elle se tape un procès de son ex-mari et une accusation de pédophilie sur son fils d’une dizaine d’années. Le titre, Love Me Tender, est programmatique : elle trace dans ce texte un kaléidoscope des façons d’aimer et des tendresses qui les accompagnent. Douce avec son fils quand le père les y autorise, sexuelle avec les filles qu’elle rencontre compulsivement, et cordiale avec les potes chez qui elle squatte quelques nuits, la narratrice nous emmène dans les tribulations de sa nouvelle vie. “Moi ce que je fais de ma vie c’est écrire. Je ne vais pas écrire dans un livre que j’écris, mais c’est quand même ça, c’est tout.” dit-elle sur France Inter.
La chronique de cette BCBG devenue trash a quelque chose de fascinant et de dérangeant. Fascination pour le courage de renoncer à la tranquillité en se mettant à la marge, pour une vocation d’écriture qu’elle comble coûte que coûte, quitte à ce que le délitement du lien avec son fils en soit le prix. Fascination aussi pour une recherche d’épuration dans nos vies surchargées : un 9m2 au dernier étage, une carte de piscine et un ordinateur portable, c’est suffisant pour vivre d’écrire. Ça a aussi quelque chose de dérangeant, cette revendication qui se veut à la marge de tout mais qui perpétue les mêmes mécanismes de domination, emprunts de la confiance démesurée que donne le fait d’avoir grandi riche. Cette confiance qui autorise à claquer ses vingt dernières balles dans un petit déjeuner au Flore, et à traiter ses meufs comme le ferait un connard à l’ancienne. Pour moi, qui envisage le féminisme comme la compréhension et l’affranchissement des codes sociétaux « féminins » et “masculins” dans lesquels on est empêtrés, je ne peux m’empêcher de trouver que cette trajectoire se conforme finalement à un comportement typiquement masculin (non pas biologiquement, mais telle que la société a construit ces rôles de façon genrée).
Happée par l’écriture de Constance Debré et les quotidiennetés qu’elle décrit, j’ai littéralement consommé Love me tender comme on croquerait dans un croissant au beurre le dimanche matin. Mais une fois que l’attrait de ces énumérations – qui deviennent presque des incantations – est passé, je ne peux m’empêcher de penser que sous couvert de subversion, l’autrice ne fait que redistribuer les rôles dans un schéma qui reste identique. À défaut de révolution sociale, Constance Debré ébranle la structure familiale imposée, et fait une proposition aussi ensorcelante que dangereuse : et si l’amour maternel n’allait pas de soi ?
La plus belle incitation qui me restera de ce texte est celle d’oser, de faire, quoi qu’il en coûte, puisque rien ne nous oblige et que rien ne nous empêche : “J’apprends aussi […] qu’il suffit d’oser, puisque tout le monde s’ennuie tellement, puisque tout le monde attend tellement qu’il se passe quelque chose.”
Love Me Tender de Constance Debré, éditions Flammarion, janvier 2020.

Laetitia travaille en tant que rédactrice freelance et assistante dans des organismes culturels. Elle est passionnée par la littérature et les podcasts, et c’est par ces biais qu’elle a été sensibilisée à l’inclusion, au féminisme et aux alternatives possibles. Écrire sur ses découvertes, c’est permettre aux idées de se propager !