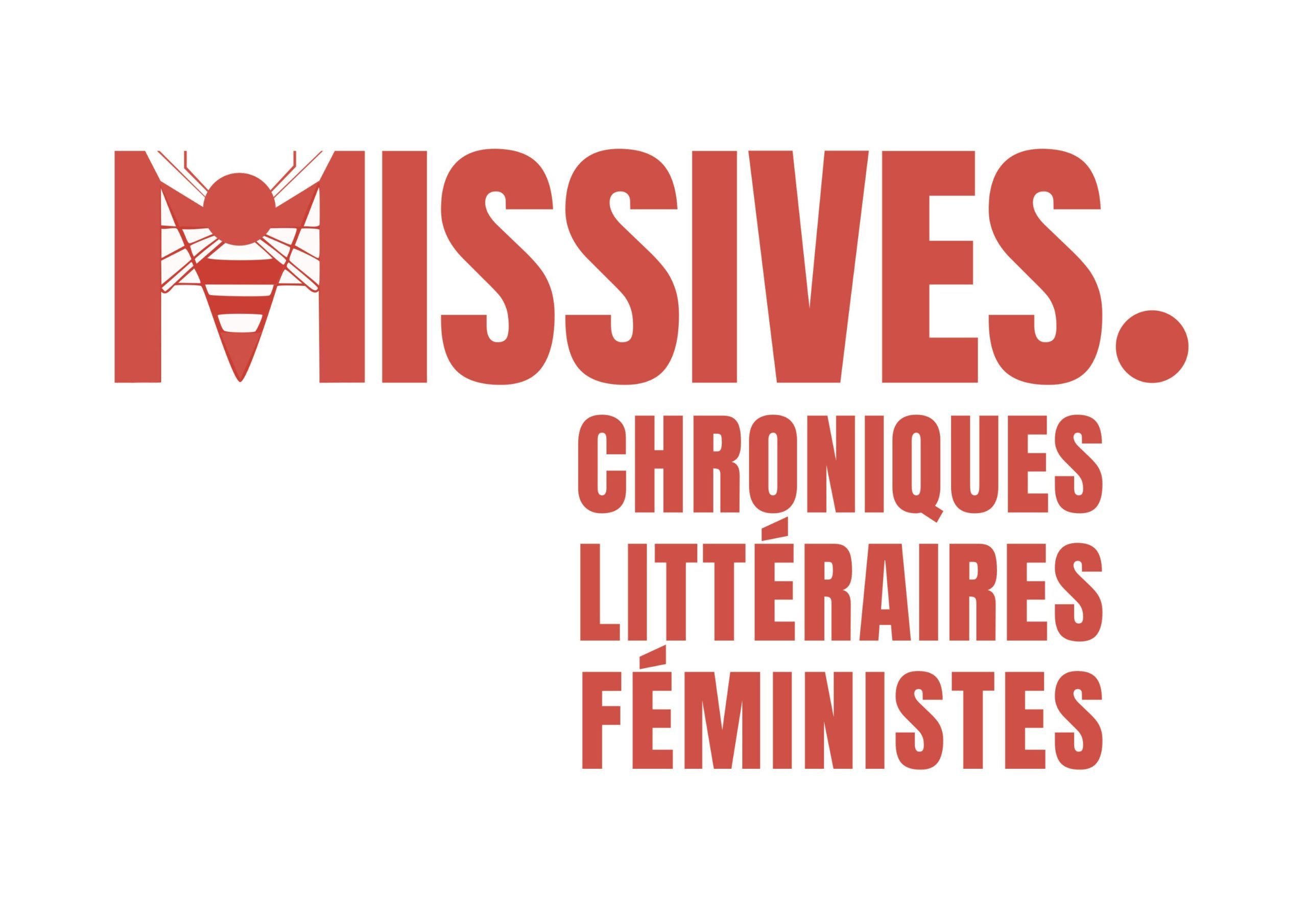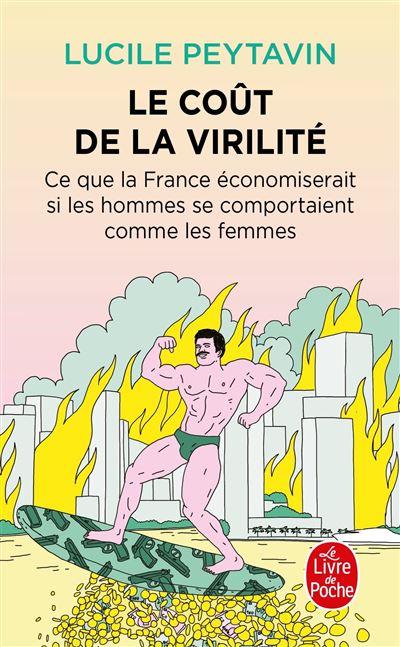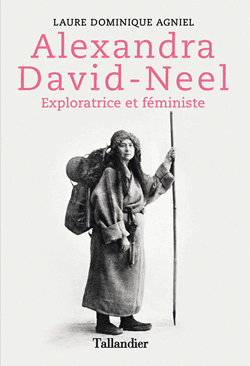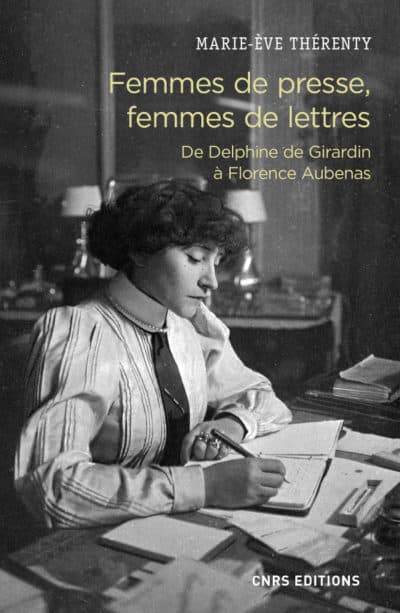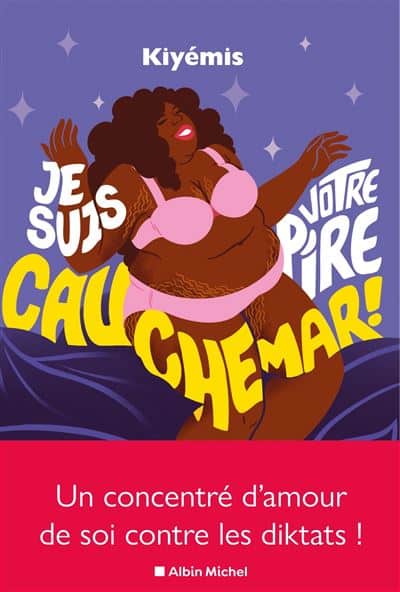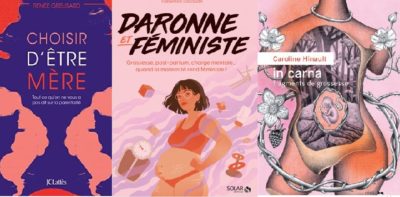Dans la tourmente du vote du nouveau budget de la France en 2026, qui va probablement précipiter la chute du gouvernement Bayrou, l’heure est à la panique générale. Il nous faut des fonds, et vite : augmenter le budget des armées, soutenir la croissance, rembourser la dette, autant d’obsessions qui justifient de faire peser davantage d’impôts sur le peuple et de lui demander toujours plus de sacrifices économiques. Trouver des recettes chaque année relève de choix idéologiques forts : taxer les riches, ou taxer les pauvres nous paraît souvent le dilemme éternel, clivant gauche et droite. Mais qui se soucie de savoir ce qui coûte réellement cher à la société, où se cachent les plus gros postes de dépenses de l’Etat et à qui profite finalement l’argent public collectivisé ?
Lucile Peytavin, spécialiste de l’histoire et des droits des femmes, s’est essayée à une addition bien originale, en se demandant combien nous coûtait la virilité toxique encouragée par nos sociétés patriarcales. A partir de données statistiques publiées par les Ministères, l’INSEE, les ONG comme Amnesty International, elle empile secteurs après secteurs les chiffres éloquents d’une délinquance et d’une criminalité masculines qui a de quoi affoler un directeur financier de Bercy.

Peut-on encore se permettre d’avoir des hommes en France vu l’état de nos finances ? Cette question sciemment provocatrice a le mérite de mettre les pieds dans le plat et de nous frapper au visage comme le fut Lucile Peytavin quand elle a découvert que la population carcérale était constituée à hauteur de 96,3 % par des hommes. De ce chiffre, elle a déduit le coût que l’emprisonnement des hommes représente pour l’État. Avec l’augmentation de la population carcérale depuis 1980 (de 36 000 on est passé à 84 000 détenus), il a fallu construire de nouveaux établissements pénitentiaires ; comptez 150 à 190 000 euros pour la construction d’une chambre sans vue ; à cela, on ajoute le prix d’une année d’emprisonnement, 34 000 euros, et le coût de la prise en charge psychologique de la réinsertion. On aboutit à 3,75 milliards d’euros dépensés pour l’administration pénitentiaire où moins de 4% de femmes sont incarcérées. On connaissait la « taxe rose » sur les produits dits « féminins » comme nos rasoirs, et nos crèmes dépilatoires mais on va peut-être commencer à parler d’une « taxe bleue » sur notre feuille d’impôts qu’on doit régler en plusieurs mensualités qu’on soit femme, homme ou non binaire.
Quand ça devient répétitif
Lucile Peytavin gratte ailleurs. A côté du pénitentiaire, de nombreuses politiques publiques dédient littéralement 80 à 90% de leur budget à la prise en charge de comportements virilistes et asociaux. Le coût du maintien de l’ordre, de la gestion des attentats terroristes, des risques et secours liés aux incendies, de la prise en charge des auteurs et victimes d’accidents mortels ou graves, des homicides ou tentatives d’homicides, des féminicides, des violences sexuelles, de la maltraitance des enfants, de l’insécurité routière, des vols, du trafic humain et du trafic de stupéfiant, tout ceci est exorbitant et se chiffre en milliards d’euros. Cette litanie sans point final donne le tournis et occupe la dernière partie du livre de l’autrice qui aura pris le temps de rappeler avant que l’éducation que nous donnons aux petits garçons ne peut qu’aboutir à la recherche de la performance, au culte de la domination des plus fragiles, à des comportements à risques. Quand on sait que 8 accidents de voiture mortels sur 10 sont le fait d’hommes, on est en droit de se demander si « à la place du A (désignant un jeune conducteur), on ne devrait pas plutôt mettre un H (désignant le sexe masculin du conducteur) tout au long de sa vie d’automobiliste! »
Les petits garçons stimulés au mouvement, encouragés à l’occupation de l’espace sonore et géographique, à des prises de parole longues et nombreuses à l’école sont entretenus dans l’idée que le monde est formé à leur désir et que les autres corps, non virils s’entend, leur doivent la priorité en toute chose. Leur agressivité « naturelle » apparait surtout comme un construit social au gré des libertés et des gratifications qu’ils reçoivent quand ils se montrent sans empathie, combatifs, dominants. Rien d’étonnant à ce que la transgression du cadre et des règles sociales communes soit un moyen de performer sa virilité, d’affirmer qu’ils sont les seuls à décider :
Lors des premières tétées du nourrisson, la mère ne s’adapte pas de la même façon à son rythme de succion selon que c’est une fille ou un garçon. Elle impose davantage sa cadence dans la prise du biberon s’il s’agit d’une fille, ou au contraire laisse son garçon s’arrêter quand il le souhaite. Les bébés filles intériorisent très tôt la notion de contrainte quand les bébés garçons sont libres d’agir comme ils l’entendent.
La force, et son pendant indissociable la violence, caractérisent l’idéal masculin. Le mythe de la testostérone rendue responsable d’une plus grande agressivité chez les corps masculins s’effondre ces dernières années (relire notre article « Quand la science sent le pipi, Game Ovaire de Lucia Sillig ») ; on sait que c’est d’abord l’acculturation, l’exposition à une culture de la violence, à des contenus et des objets culturels violents qui forgent un cadre de référence pour l’individu mâle.
In fine, en coupant leur petit garçon de ses émotions, de sa sensibilité, de son empathie, en l’incitant à prendre des risques et à être vigoureux – que cela se fasse consciemment ou inconsciemment – les parents encouragent ses futures conduites déviantes.
Pourquoi notre société, forte de ces connaissances, s’entête-t-elle et persévère-t-elle à ignorer le continuum entre cette entraînement à la brutalité et les futurs agissements dangereux de citoyens masculins ? Nous oserons, comme Olivia Gazalé, citée dans l’ouvrage, que notre société chérit sa pensée suprémaciste : pour être fort, il faut dire le faible, pas de virilité sans oppression, sans ségrégation, sans exclusion de l’Autre. « Pas de suprématie sans un inférieur à mépriser, voire à humilier ».
Le tabou économique
En refermant le livre, reste l’amère impression qu’on subventionne quotidiennement la violence masculine. Ce coût de la virilité estimé dans les pages finales du livre à 95 milliards d’euros par an – soit le tiers des recettes de l’Etat ! – demeure un tabou économique inouï. Pourquoi en tant que femme devrais-je dédier une partie du fruit de mon labeur, mes impôts, à endiguer un phénomène dévastateur comme l’est la délinquance et la criminalité masculine alors même que je suis potentiellement la cible de cette violence ? S’ils pèsent pour 90% des dépenses publiques, pourquoi ne seraient-ils pas taxer à hauteur de ces 90 % ? Je gage que cette proposition n’emportera pas le suffrage universel, mais la piste d’une éducation humaniste des petits garçons est une alternative séduisante et qu’on ne peut plus se refuser :
Sans le paradigme viriliste, il n’y aurait quasiment plus de viols, d’agressions, de harcèlement, de vols, de meurtres, d’escroqueries. L’insécurité serait considérablement réduite. Nous ne craindrions plus de marcher ( surtout étant une femme) le soir dans la rue, de laisser nos enfants jouer seuls dehors, de nous faire invectiver en raison de notre tenue, nous aurions beaucoup moins peur de voir nos enfants se faire harceler à l’école, de nous faire agresser à cause de notre sexualité, d’être victime d’une escroquerie sur internet, de nous faire voler nos voitures, d’avoir un accident de la route causé par un tiers, de nous faire dérober nos sacs ou nos téléphones portables, etc. Sortir de la virilité produirait ainsi non seulement une société plus pacifique et plus riche, mais surtout une société dans laquelle nous serions tous et toutes plus libres.
Il n’est pas tellement temps de réduire les dépenses publiques et d’augmenter les impôts, mais de financer des politiques sociales ambitieuses en prenant au sérieux la nécessaire recherche sur le coût de la virilité et les moyens de l’endiguer, de rêver un autre projet de société où les valeurs pacifistes et altruistes sauveraient des vies humaines et nos sociétés moribondes. Grâce à Lucile Peytavin, penser la sortie de la virilité en termes économiques aura permis de matérialiser en espèces trébuchantes le gain humain pour une économie solidaire au sens fort du terme.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.