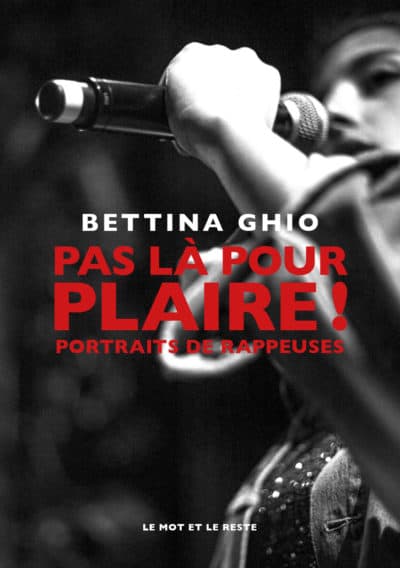Je ne vais pas y aller par quatre chemins, La vie têtue, c’est tout simplement le plus beau texte sur le deuil que j’ai lu depuis les Contemplations de Victor Hugo. Bon d’accord ex aequo avec, dans un tout autre style, L’année de la pensée magique de Joan Didion, mais Juliette Rousseau est en bonne compagnie. Et en matière de livres sur le deuil et la mort, je peux dire que je m’y connais. D’abord, parce que je lis pas mal et que la littérature ne parle quasiment que de la mort (depuis Shéhérazade et Les mille et une nuits, on sait qu’ écrire est une question de survie). Ensuite parce qu’en tant qu’orpheline précoce, on va dire que j’ai un bon tropisme vers le sujet.

Donc Juliette Rousseau, l’autrice, a perdu sa grande sœur. La vie têtue, ça commence comme ça : comme une longue lettre adressée à celle qui n’est plus, à la grande sœur disparue trop tôt, beaucoup trop tôt, emportée par un cancer survenu à l’âge de 33 ans. Le genre d’ « événement » qui laisse pour longtemps une famille entière dans un état de profonde sidération.
Juliette Rousseau raconte tout ou presque : la maladie, la mort, l’absence, le manque, la présence au-delà de la mort, la douleur de la mère et du père et bien sûr la douleur de la sœur…. On pourrait se sentir un peu voyeuse, ou comme prise à témoin, dans ce texte écrit à la deuxième personne et qui, d’une certaine façon, ne nous est pas adressé. Mais ce n’est pas du tout ce qui se passe. On a plutôt l’impression de passer quelques heures dans une maison d’enfance, invitée à partager un moment avec l’autrice et sa famille, à écouter leur(s) histoire(s), pelotonnée contre elles sous les couvertures un soir d’orage.
J’ai beaucoup pleuré en lisant ce livre. Mais c’était bien doux, car l’autrice fait un usage sublime du pathos. Oui ça existe. En effet, il n’en va pas du pathos comme de la chasse chez les inconnus : il y a vraiment le bon et le mauvais pathos. Le mauvais pathos, c’est celui du téléfilm de M6 qui vous tire la chiale à force de surenchère de glauque et de musique sirupeuse : on pleure, mais on a honte. Le bon pathos, c’est celui de l’œuvre qui vient vous chercher les larmes au fond des tripes, celles qu’on retient parce qu’on veut faire bonne figure en société, qu’on ne veut pas déranger, ces larmes qui finiront par nous pourrir le cœur et le cerveau, si elles ne sortent pas. Le pathos de La vie têtue est de cette trempe-là, un pathos nécessaire, salvateur et libérateur.
Mais l’autre très grande force du livre, c’est qu’il dépasse la seule question du deuil. Ce n’est pas un livre tombeau. Car La vie têtue, c’est la vie qui continue, la vie qui reprend, malgré nous, malgré le chagrin qui nous terrasse, nous couche et nous endolorit. La vie têtue, c’est le cycle des saisons qui nous rappelle que nous sommes toujours en vie.
La lettre, ou les lettres, alternent avec des poèmes (oui encore de la poésie !) comme autant de respirations, de pauses, pour faire retour à soi avant de replonger dans l’histoire familiale, personnelle, qui comme toute histoire personnelle est politique et nous concerne toutes.
La vie têtue, c’est donc aussi une histoire de grand-mère, de mère, de filles, de sœurs, de filles devenues mères à leur tour, c’est une histoire de femmes qui contient l’histoire des femmes.
Il y a les avortements, les accouchements, la maternité, la lâcheté des hommes. Il y a les troubles alimentaires, le contrôle social du poids des femmes, abordé avec autant de sensibilité que de franchise, ce carcan invisible dont certaines meurent. Il y a toujours le viol et les violences sexuelles. Et puis il y a la nature, la forêt protectrice, tutélaire, elle aussi mutilée, qui convulse et continue à vivre, elle aussi, comme elle peut.
A chaque page, l’écriture de Juliette Rousseau tient sa ligne entre justesse, colère, tristesse et une pudeur qui semblerait presque paradoxale pour une autrice qui sait si bien se mettre à nue.
Entre deux lettres, comme un mot glissé sous une porte, Juliette Rousseau écrit : « Je voudrais t’écrire un livre dont on entend les pages respirer lorsqu’on les tourne ». Le conditionnel n’est pas de mise. S’il est un livre qui respire, c’est bien celui-là.

Louise Katz a eu une mère féministe. Privée de Barbie et inscrite de force à l’aïkijudo, elle met 20 ans à devenir la pouf à rouge à lèvres qu’elle a toujours rêvé d’être. Doctoresse ès littérature latine, elle aurait aimé prendre le pseudo de Doktor SS et mixer du disco-punk dans des usines abandonnées. Finalement, elle devient journaliste et entrepreneuse. Elle aime les femmes qui pensent et les femmes qui font, les sages et celles qui font des doigts. Et bien sûr celles qui lisent et celles qui écrivent.