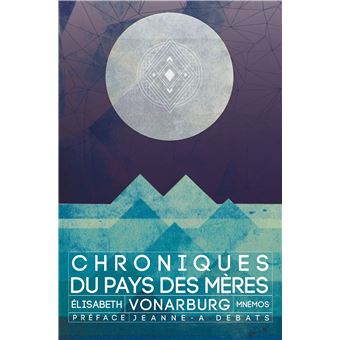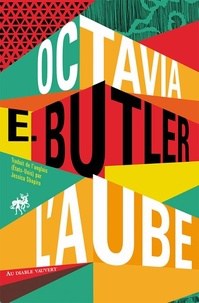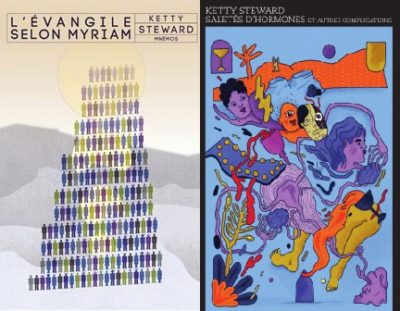L’été s’achève et il sentait fort la fumée et l’angoisse apocalyptique. Un temps à stocker des boîtes de conserve et des romans pour affronter l’après.
Mais peut-être certaines lectrices d’anticipation post-apocalyptique ressentent-elles une légère appréhension face à cette perspective ? Après tout, au rayon du post-apo féministe, une œuvre en particulier a marqué notre imaginaire : La servante écarlate d’Atwood, qui imagine une emprise odieuse sur la sexualité et la fertilité féminines, dans une société dystopique de castes sinistres. Rien de réjouissant à s’imaginer le futur ainsi… surtout quand l’actualité lui donne de furieux airs de présent.
C’est pourquoi je voudrais soumettre une proposition : en cas d’apocalypse, est-ce qu’on pourrait pas demander aux meufs de réorganiser la société ?

Je biaise légèrement le trait en présentant ainsi Chronique du pays des mères. Mais si on y retrouve des ingrédients familiers de l’anticipation post-apo – catastrophe écologique et sanitaire, organisation codifiée de la société, prise en charge collective de la fertilité puis de l’éducation des enfantes –, une lectrice chevronnée du genre ne pourra s’empêcher de trouver tout cela… très doux. Plutôt rassurant. Ce monde où, après l’effondrement, les femmes seules ont fait des lois est déroutant, mais jamais violent. À travers le personnage de Lisbeï, l’héroïne, de sa bien-aimée Tula et des correspondances croisées entre elles et entre d’autres, on voit se déployer une société parfois inquiétante, mais toujours inquiète. Une société au passé trouble, mais capable de déployer des chercheuses et de laisser se dérouler des débats religieux et politiques sur ce qu’il convient de faire des révélations qui amènent à reconsidérer le récit officiel de ce passé. Une société malade, frappée par un virus mystérieux, mais qui étudie de près les maladies qui la ronge et cherche à la comprendre avec un regard à la fois scientifique et empathique. Une société où la sexualité est en partie régulée, car il ne naît presque plus d’individus mâles, mais où elle peut aussi être libre, consentie, enthousiaste.
Bref, un monde qui ne cède jamais à la facilité de se raconter qu’aussitôt la civilisation en péril, l’humanité tomberait dans la barbarie, et qui paraît convaincu de la nature collaborative de l’humaine.
En suivant Lisbeï dès sa toute petite enfance, puis tout au long de sa vie de chercheuse rétive, de fille, de sœur et de femme, la narration prend son temps. Tout le premier acte, quand Lisbeï et Tula sont encore des « dottas », des fillettes en cours d’éducation mais tenues à l’écart des réponses aux questions qu’elles se posent sur le monde, déborde d’intelligence et d’empathie pour la naïveté, l’affection féroce et la curiosité de cette phase de la vie. L’histoire cherche le temps long plutôt que les retournements explosifs : la révélation archéologique qui vient remettre en cause le récit religieux officiel fait l’objet d’un questionnement patient et complexe. Les séparations, deuils, retrouvailles, renoncements, attachements, ont le temps d’évoluer, de déployer leurs ambivalences, leurs lents infléchissements au long des âges qui rythment la vie – les « Vertes » avant la puberté, les « Rouges » fertiles, puis les « Bleues » libérées des contraintes de la reproduction.
Et dans ce monde féminin, où ne restent que quelques rarissimes mâles – nécessaires à la reproduction, un peu marginaux mais toujours traités avec dignité – la langue a naturellement évolué vers un féminin générique systématique. Elle parle d’enfantes, de chevales et d’oiselles, entre autres trouvailles lexicales et syntaxiques. Petit plaisir supplémentaire qui s’intègre parfaitement dans le récit et permet en filigrane une réflexion sur le genre au sens social, mais aussi linguistique.
Un roman intelligent, à conseiller parce qu’il fait bon se rappeler qu’on peut affûter son féminisme sans forcément s’infliger le spectacle, déjà bien trop présent, de la souffrance féminine.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.