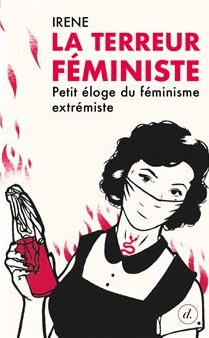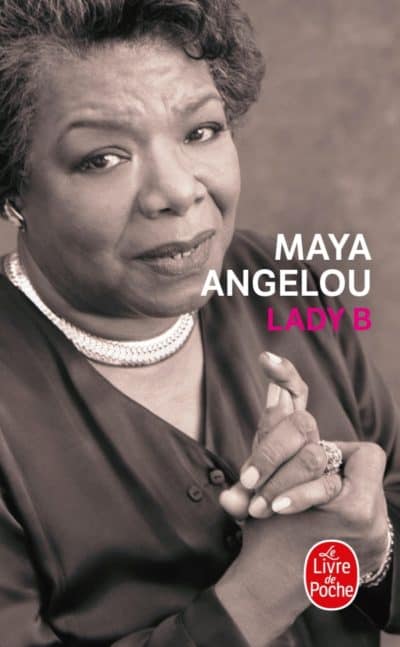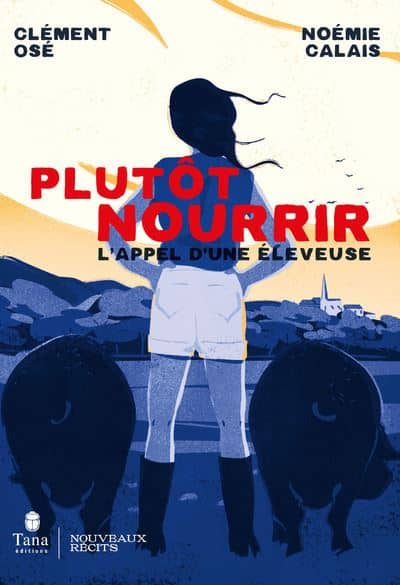Aborder le sujet de la violence des femmes revient à briser le grand tabou et il faut se préparer à une levée de boucliers en règle. Pourquoi ? parce que femmes et violence sont deux mots qui ne font pas bon ménage si on veut rester fréquentable, continuer d’être audible par la société civile. Cette association fait tant trembler qu’elle paralyse le débat et empêche de s’interroger sur la nature de cette violence : comment elle a été construite dans l’Histoire, comment elle a été représentée, et sur les raisons d’être de cette violence.

La militante féministe Irene revient sur un sujet qui fâche, histoire de sortir une bonne fois pour toute de l’interdit qui frappe ce débat au cœur même du mouvement féministe. Elle a souhaité écrire un ouvrage accessible à un large public, pour lequel elle s’est documentée pendant un an. Des femmes de tous horizons, de son histoire familiale, de la peinture du 16e siècle, de la littérature populaire, des mouvements politiques du 20e siècle, se croisent et démocratisent l’idée que la violence des femmes n’est pas exceptionnelle, et qu’on devrait arrêter de s’en excuser quand elle est si légitime.
Une violence frappée par l’injonction au silence
Afin de ménager les détracteurs du féminisme et de permettre de faire entendre leurs aspirations révolutionnaires, de nombreux.ses militant.es ont longtemps consenti à taire le pouvoir subversif de la violence des femmes. Minorer pour ne pas heurter, pour ne pas faire peur. Quand Benoîte Groult veut alerter l’opinion publique sur les ravages de la violence faite aux femmes avec sa célèbre phrase : « Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. », elle n’envisage pas qu’en pétrifiant le féminisme dans un pacifisme de nature, elle ferme une partie du combat à ses militant.es et enterre d’un coup de pelle fatal des femmes de notre Histoire qui ont fait usage de violence et l’ont questionnée. Irene, bonne élève, lève la main du fond de la classe et interroge la littérarité de cette déclaration : le féminisme n’a-t-il vraiment jamais tué ? n’a-t-il pas fait usage de la violence ? Bien sûr que si ! et les exemples sont légion, mais ils n’arrangent pas les mouvements féministes majoritaires qui ont confondu violence oppressive et violence défensive, destruction symbolique ou réelle du corps de l’autre et destruction d’un système de domination mortifère. Face au malaise de cette violence bien présente chez les femmes, on préfère dire qu’elle n’est pas, qu’elle est marginale, qu’elle est pathologique, ou le signe d’une dénaturation du féminin.
Reconnaître une histoire de la violence féminine
Irene rappelle à notre mémoire collective les œuvres qui ont forgé l’imaginaire symbolique de la violence féminine. Marquées par l’idée de riposte, de survie suite à des traumatismes infligés par des hommes violents, violeurs ou meurtriers, des artistes comme Artemisia Gentileschi ont osé représenter le meurtre au féminin ; elles figurent le sang, la transgression, coupent des têtes, incendient, pour retourner la violence, la sortir d’elles et en faire un objet de contemplation jeté à la face du monde, dans l’espoir que ce dernier s’interroge : qu’est-ce qui peut pousser une femme à assassiner ? La violence perpétrée par les hommes envers les femmes est-elle de même nature que celles des femmes envers les hommes ? La violence n’est pas étrangère aux femmes, cessons avec cette idée reçue que les femmes sont plus douces et pacifiques par nature. L’émission « un podcast à soi » de Charlotte Bienaimé a dédié quatre épisodes à ce sujet, « Des femmes violentes » ; dans le premier volet, on revient sur les chiffres des femmes détenues : en France, elles représentent 4% de la population carcérale. Ce chiffre pourrait nous faire penser que les femmes, par essence, ne font quasiment pas usage de la violence ; il n’en est rien. Il s’explique par une socialisation différentielle des femmes ; dans la petite enfance, on punit plus vite une petite fille qui se montre colérique, violente, quand un garçon peut faire usage de cette violence comme une marque de virilité ; plus tard, le système judiciaire renâcle à poser des sanctions envers les femmes coupables d’un délit ou d’un crime, préférant mettre en place des stratégies d’évitement à l’incarcération.
Dans cette première partie, Irene choisit judicieusement les figures féminines qu’elle met en avant, chacune illustrant un pan de la violence, toutes se rejoignant sur un point : le sang-froid, la planification et la conscientisation du passage à l’acte : du personnage de Judith décapitant Holopherne, à celui de Lisbeth Salander justiciant son violeur, ou encore à celui de Valérie Solanas prônant le discernement dans l’assassinat et le sabotage, toutes s’accordent à rationaliser la violence, à la politiser. Et surtout, en aucune façon, cette violence n’est la manifestation d’une domination d’un corps sur un autre corps pour asseoir son pouvoir.
La non-violence, un outil de privilégiés
Deuxième étape incontournable : détruire l’argument que le recours à la violence décrédibilise toute lutte, tout mouvement révolutionnaire, toute résistance. Partant de témoignages de femmes ordinaires, de femmes du peuple, dont le nom passe au mieux comme une fulgurance dans la rubrique des faits divers, Irene revient sur le cas de celles qui ont menacé de meurtre leur mari violent, ou qui, sans autre possibilité, ont dû tuer pour ne pas mourir sous les coups de l’assaillant. Face à une justice sourde à leurs plaintes, à leurs appels à l’aide, elles ne peuvent se permettre de sacrifier leur vie pour la cause pacifique. Cet engagement non-violent appartient d’abord à celles et ceux qui ont le choix, par la place privilégiée qu’ils occupent dans la société. Juger immoral le meurtre quand une vie est menacée, ou prononcer des peines d’emprisonnement à l’égard des victimes pointent surtout l’incapacité des institutions politiques et judiciaires à protéger les corps des femmes, et leur incompétence à reconnaitre les violences au long cours comme la cause d’une défense légitime.
« Je ne sais pas dans quel monde vivent les fervents défenseur.euses de la pureté pacifique. Je ne sais pas ce qui est le plus dérangeant dans ce schéma de pensée : la mauvaise foi de nier que la violence peut tout à fait être utile, nécessaire et efficace ou le refus d’assumer que la non-violence est un privilège. Ma grand-mère, pauvre et sachant à peine lire, n’en a rien à faire des recours légaux et des méthodes pacifistes. Les sit-in et la communication non violente, elle les emmerde. Sa condition ne lui permettait pas de réfléchir à d’autres méthodes que celles à sa portée. »
Opter pour le martyre, ne pas rendre les coups donnés, taire les viols conjugaux pendant des décennies ne feront que maintenir en place les rapports de domination entre individus et groupes sociaux, qu’affermir un Etat oppressif qui vous inculque que répondre à la violence par la violence ce n’est pas bien, dans le but de continuer à opprimer des corps qui valent moins que d’autres.
La violence, une arme politique
La dernière partie se nourrit de réflexions sur la dimension politique de la violence. Plusieurs mouvements féministes révolutionnaires ont revendiqué la violence comme une arme inévitable face à un Etat oppresseur. La voie légaliste étant une impasse pour celles qui réclament pacifiquement des droits que cet Etat est le premier à leur refuser. Le problème n’est pas que ces droits ne sont pas connus de l’Etat, mais que ce dernier ne souhaite pas y donner accès. Quelle alternative reste-t-il sinon celle d’ébranler la tranquillité de l’ordre public ? Reprocher à un.e militant.e son terrorisme (comprendre sa capacité à faire trembler le dominant) revient donc à lui reconnaître une force d’action subversive. Les suffragettes, ou les féministes de Rote Zora dans les années 70, ou encore ces Mexicaines, qui brisent, cassent, sabotent, font exploser des bombes, en ont eu marre d’attendre que les institutions écrivent les droits qu’elles souhaitent conquérir, construisent la société dont elles rêvent. L’action directe abolit la distance, la médiation, la représentation entre le corps souhaitant et l’objet souhaité, quand cette représentation est inapte à le lui donner.
Plutôt que rendre les coups dans une logique désespérée et individuelle, adopter l’action violente collective comme une stratégie politique revient comme dans les arts martiaux à utiliser la force de l’adversaire contre lui-même. Elsa Dorlin, citée par Irene, explique bien cette vision de l’autodéfense comme une philosophie de la libération : apprendre à se battre, à cacher des armes, à organiser son action transforme profondément les corps dans l’espace domestique et social et conscientise sa puissance politique. Plutôt que de sanctionner les femmes qui se révoltent face à des violences, des meurtres et des injustices, il serait temps de détruire ce qui rend possible ce déchaînement de fléaux. Nos regards pointent alors du côté d’un système capitaliste intrinsèquement violent, raciste et sexiste. Après cette lecture, on se demande avec Irene : est-il toujours possible de dire qu’on lutte pour l’égalité, si cette égalité femmes-hommes multiplie les prises de pouvoirs sur d’autres corps par ailleurs ?
« Vouloir être égales aux hommes supposerait non seulement d’acter une vision binaire du genre et de la société, mais en plus d’affirmer que l’homme serait la mesure de toute chose, le modèle vers lequel nous devrions tendre. »
Partant de là, le féminisme ne peut plus se satisfaire d’une lutte au rabais et élargit sa pensée à tous les aspects de la domination capitaliste. Bon d’accord, mais je l’allume quand la mèche ?

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.