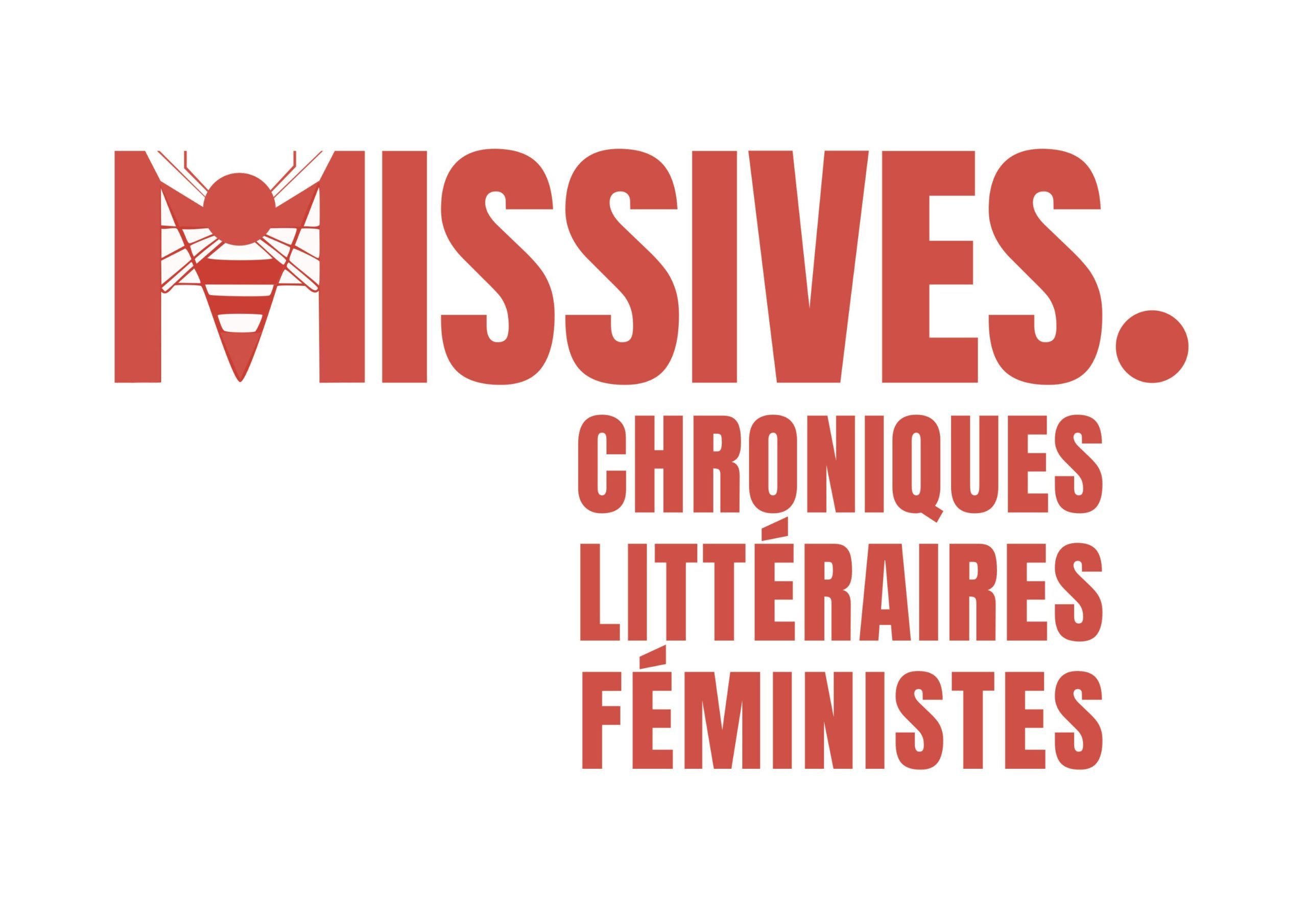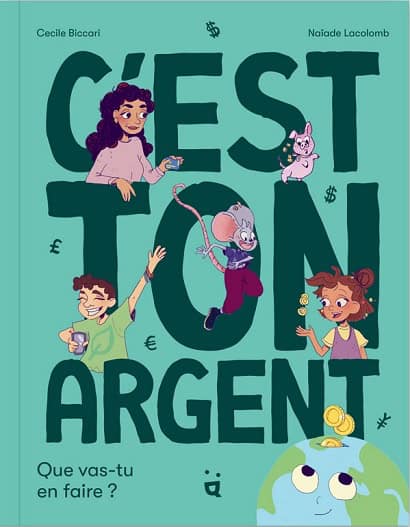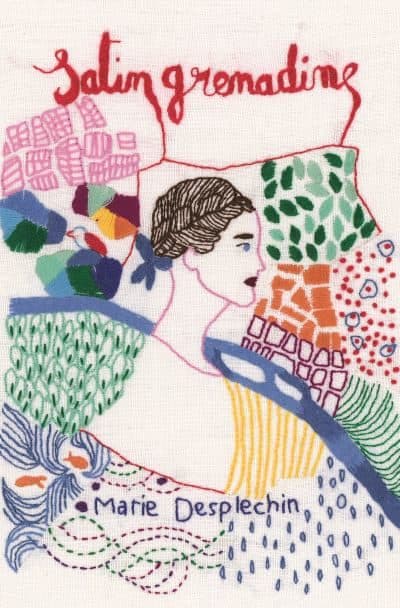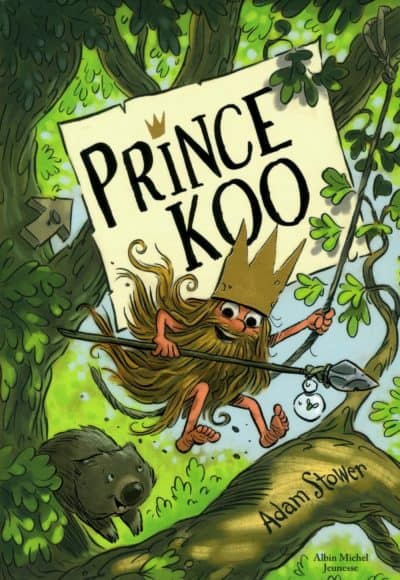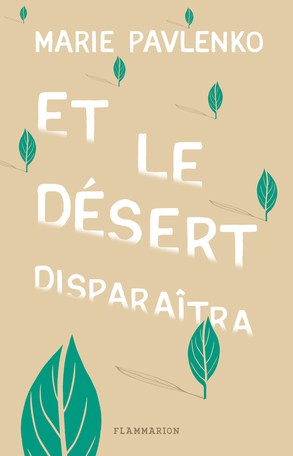Les Missives avaient encensé l’avènement de Game Ovaire de Lucia Sillig chez Helvetiq, elles s’intéressent à présent, chez le même éditeur, à un album jeunesse sur le thème de l’argent, fait assez rare dans le secteur pour être souligné. Nous écumons en effet les étagères de librairies à la recherche d’ouvrages à destination des enfants pour les aider à se construire une culture du brouzouf, puisque nous leur dédierons une salle entière dans le cadre de notre exposition 2026 sur le pouvoir économique et les femmes. Et comme on ne naît pas femme, pas douée avec l’argent, qui préfère laisser aux autres les investissements et les épineuses questions économiques, et qu’on le devient à force de ne recevoir aucune éducation à l’argent, on s’est dit qu’il fallait aller chercher le ver dans la pomme d’api pourrie du goûter de notre enfance.
C’est Titiou Lecoq qui nous avait alertées dans son chapitre inaugural de Le couple et l’argent (Iconoclaste, 2022) : les inégalités économiques n’apparaissent pas par magie à l’âge adulte, elles se créent dès le plus jeune âge avec un rapport différencié à l’argent entre filles et garçons au sein même de la structure familiale. Des nos jours, tout fonctionne comme si on tenait à distance les filles de la réalité économique et qu’on mettait en péril à long terme leur indépendance financière. Pourtant, à y regarder de plus près, les filles n’ont pas toujours été écartées de l’économie, l’école républicaine a même conçu pour elles un programme sur mesure…
Mis en place à la fin du 19e siècle, l’enseignement ménager était destiné aux jeunes filles afin de les préparer à leur future vie d’épouse : raccommodage, repassage, lessive, hygiène, courses, économie anti-gaspillage, soins des enfants, tout était fait pour leur inculquer «des habitudes qui leur deviennent une seconde nature, de bonnes habitudes qui exercent sur elles pour toute leur vie une tyrannie bienfaisante» peut-on lire dans un manuel d’éducation à l’art ménager. Abandonné dans les années 60, cet enseignement sexiste ne s’est pas transformé pour autant en un cours d’économie domestique pour filles et garçons dans l’école que nous connaissons aujourd’hui.
Pour acquérir une indépendance financière, il faut donc faire confiance à la famille et à ce qu’elle veut bien nous transmettre. Or, sur ce point filles et garçons ne sont pas également préparé.es à gérer leur argent. Quand les garçons sont encouragés à réclamer de l’argent quand ils en ont besoin, même lorsqu’ils reçoivent déjà de l’argent de poche, les filles, elles, se satisfont de la somme qu’on leur donne et ne négocient que rarement des augmentations d’argent de poche : les études ont montré que dans les familles qui accordent chaque mois de l’argent à leurs enfants, il existe un écart de 4 euros entre garçons et filles au bénéfice des garçons ! Pour le reste, les filles doivent user de leur charme, d’un sourire, pour accéder à une demande exceptionnelle.
Si on observe les choses plus en profondeur, on se rend compte que les parents n’ont pas le même comportement financier envers leurs filles qu’envers leurs garçons. En réalité, ils vont dépenser autant pour elles que pour eux, mais ils achèteront davantage de choses à leurs filles. C’est d’ailleurs ce que les parents de Gwendoline [héroïne fictive du livre] ont répondu quand elle a fait remarquer que son frère avait plus d’argent qu’elle. “Oui mais on te fait tout le temps des cadeaux. La semaine dernière, tu as eu le stylo magique que tu réclamais.” Le problème, c’est que cela crée un rapport très genré à l’argent. Les filles sont assignées à la position de demandeuses, pendant que les garçons s’exercent à gérer leur budget. (Titiou Lecoq Le couple et l’argent, page 23)
En ne s’intéressant pas à la transmission d’une culture de l’argent, on creuse dès l’enfance des inégalités entre filles et garçons qu’on retrouvera plus tard dans le milieu professionnel où les hommes sont plus enclins à négocier des primes et des augmentations de salaire que les femmes. Briser le tabou de l’argent dès l’enfance permettrait de se construire un véritable savoir économique : dépenser, donner, investir, épargner, emprunter sont des actions bien distinctes qu’il est nécessaire de comprendre avec rigueur. Personne ne naît avec la faculté de faire ses comptes, d’établir un budget, ou un échéancier de remboursement, et de connaître le fonctionnement des impôts ou de la CAF. Tout s’apprend. Aucune magie, aucun déterminisme là-dedans.

Des ouvrages à destination de la jeunesse, comme C’est ton argent. Que vas-tu en faire ?, s’adressent à un public mixte pour développer cette fibre économique chez les enfants, on regrette que de trop rares albums s’emparent du sujet de l’argent. Même si la problématique du genre est totalement absente de l’album, on apprécie la carté des pages et les questions philosophiques posées « Faut-il avoir beaucoup d’argent pour être heureux ? », le souci humaniste est évident au fil des pages. L’autrice Cécile Biccari a souhaité répondre aux questions que de jeunes enfants pourraient se poser comme d’où vient l’argent ? pourquoi met-on son argent en banque ? qu’appelle-t-on l’étalon or ? Il s’agit surtout de bien conscientiser les comportements qu’on peut adopter face à son épargne et ne rien laisser dans l’ombre. Le pari de l’éclaircissement est réussi comme les planches pleines d’humour réalisées par l’illustratrice Naïade Lacolomb. On aurait apprécié aussi une ouverture plus multiculturelle puisque, dans certaines familles, l’argent de poche est remplacé par des dons familiaux à l’occasion de fêtes et de cérémonies religieuses ou laïques. On rencontre aussi le cas de familles qui responsabilisent très tôt leurs enfants en leur confiant l’argent des aides sociales afin qu’ils et elles fassent très tôt un usage raisonné de leurs dépenses. Mais ces deux réalités, l’entrée par la classe sociale ou le culturel, n’ont malheureusement pas été retenues. Il y a bien une page où on s’approche de la question de l’injustice salariale mais elle est plutôt vite évacuée, comme si on craignait de froisser un.e riche. En somme, on apprécie le travail dans son ensemble mais on aurait aimé plus d’engagement, d’audace, et une vision plus politique du sujet.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.