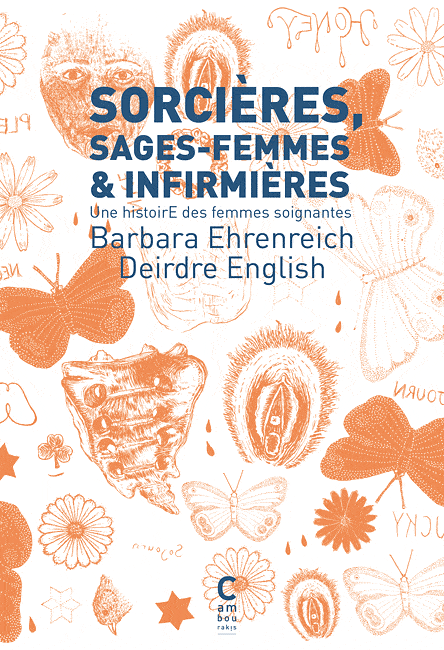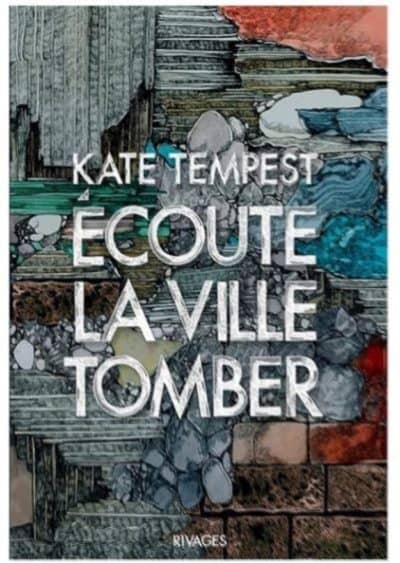« Il y a eu beaucoup de changements en quarante ans, que ce soit historiquement ou dans notre conception de la recherche, aussi devons-nous nous remémorer que Sorcières, sages-femmes et infirmières a été écrit sous le coup de la colère et de l’indignation. Si certaines des sources de notre colère semblent désormais désuètes, c’est uniquement grâce à des travaux comme Sorcières, sages-femmes et infirmières et au mouvement dont il est issu. »

Dès l’introduction de la seconde édition de cet essai féministe court et brûlant publié en 1973, tout est dit : colère, rigueur scientifique, quelques erreurs historiques dont on se fiche un peu – 100 000 femmes auraient été tuées en tant que sorcières selon les dernières estimations, et non un million, c’est certes moins, mais ça fait quand même beaucoup de sang – et surtout un texte militant fondateur, qui a grandement contribué à la revendication par les femmes de leur rôle de soignantes à une époque où le corps médical patriarcal ne leur laissait à peu près aucun droit sur leur corps en tant que patientes, ni sur leur pouvoir en tant que soignantes.
Une colère désuète ?
Ce pamphlet savoureux de pédagogie et de rage contenue est à l’image de ses autrices : commençant par s’excuser de la possible » désuétude » de leur colère, elles la réaffirment de plus belle en justifiant l’actualité de leur propos. Et malheureusement, elles ont bien raison ! Car si on peut concéder une réappropriation par les femmes de leur corps et de leurs droits depuis les années 1970, il y a, mes sœurs, encore du boulot.
En France, aujourd’hui, on trouve moins de 50 % de femmes médecins (alors qu’elles sont largement majoritaires dans les cursus), et 29 % de chirurgiennes… Par contre, chez les infirmier·e·s et aides soignant·e·s, elles sont 90 % ! Là, c’est sûr, ça ne bouge pas, quand il s’agit de laver, nourrir, assister, on les trouve bien à leur (noble) place, les femmes ! Et au sujet du droit des patientes et du paternalisme du corps médical, il suffit d’aller faire un tour sur « Paye ta blouse », « Paye ton IVG », « Paye ton psy » ou « Paye ton gynéco » pour voir qu’on est loin d’un monde merveilleux où le médecin est un praticien altruiste et féministe au service de l’humanité.
Mais revenons à nos chères Barbara et Deirdre et à leur question essentielle : en quoi l’histoire de la professionnalisation de la médecine peut nous renseigner sur l’actuel pouvoir politique et économique de l’homme de la classe dominante dans une science qui était, il y a quelques siècles encore, le domaine privilégié des guérisseuses ?
La réponse est presque trop attendue. Il s’agit bien évidemment d’une longue histoire de maintien des privilèges et du pouvoir de la classe dirigeante !
L’invention de la sorcière et de l’université
Le livre s’articule en deux parties, mais j’y vois trois temps particuliers : d’abord, on apprend qu’au Moyen Âge, l’équivalent de nos médecins généralistes étaient la plupart du temps les guérisseuses, femmes empiristes qui détenaient un savoir réel face aux médecins attardés des classes aisées qui soignaient tout et n’importe quoi à coup de prières et de saignées. Mais le problème, en ces temps de soulèvements des masses paysannes, c’est qu’un peuple qui peut se soigner tout seul est un peuple indépendant… et là… rien ne va plus. Et puis des femmes sexuellement libres, organisées en groupes et qui ont le pouvoir de guérir, quoi de plus terrifiant ? Alors les hommes ont eu une première idée brillante, les chasses aux sorcières ! Les femmes de qui la médecine moderne puise la plupart de ses sources ont alors été persécutées, torturées, décrédibilisées…
Le deuxième coup de génie des hommes de la classe dominante à cette époque, c’est de créer, sortie de nulle part, une université qui serait seule à pouvoir autoriser la « profession » de la médecine. Évidemment, cette université est interdite aux femmes, les femmes aisées instruites étant encore plus terrifiantes que les sorcières des campagnes ! Toute médecine empiriste devient donc illégale, les accouchements même deviennent l’apanage lucratif d’hommes peu compétents, et les sages-femmes sont définitivement cataloguées – chasse aux sorcières et absence de diplômes oblige – comme superstitieuses et malveillantes. (On peut penser au glissement vers un sens péjoratif de l’expression « bonne femme »).
Connais-toi toi-même
La seconde partie de l’essai met l’accent sur l’ascension de la profession médicale aux États-Unis au cours du XIXe siècle. Elle dresse l’histoire passionnante d’une médecine dite « régulière » qui, dans sa volonté de s’imposer comme modèle unique, notamment par la législation, trouva la résistance d’un peuple qui avait entière confiance dans les soignant·e·s « irrégulier·e·s », et se souleva dans une lutte tant féministe qu’ouvrière qui trouva son apogée dans le Mouvement Populaire pour la santé, mouvement dirigé par des femmes dont l’un des slogans était « Connais-toi toi-même ». Finalement catalogué comme « sectaire », le mouvement emporte avec lui la figure de la femme militante et indépendante pour laisser place, dans la dernière partie de l’ouvrage, à la figure de l’infirmière, femme docile, douce et maternante qui, selon les autrices, est « le produit de l’oppression des femmes de la classe dominante de la société victorienne ». Car c’est un des points essentiels de ce livre, cette histoire de la médecine est moins « une affaire de bonnes femmes », que l’histoire, répétée dans mille autres domaines, du maintien de la domination d’une classe sur une autre et du lien essentiel entre féminisme et lutte des classes.
Il n’est pas rare d’entendre ou d’observer par soi-même la tendance du corps médical contemporain à pratiquer la rétention d’informations et à décrédibiliser toute tentative de connaissance du corps et du soin par soi-même ou par des pratiques dites, justement, de « bonnes femmes ». Dans ce contexte, ce livre passionnant ouvre des portes que nous ne devrions jamais laisser se refermer.
« Nous avons tendance aujourd’hui à restreindre nos critiques à l’organisation du système médical, et à faire comme si le substrat scientifique de la médecine était inattaquable. Nous devrions nous aussi nous donner les moyens d’une étude critique de la ‘science’ médicale – au moins pour ce qui se rapporte aux femmes. »

Féminazi bouddhiste et anarchiste, Charlotte déteste les mots en « iste ». Elle préfère les longues promenades dans la campagne normande, les haïkus et le métal indus.