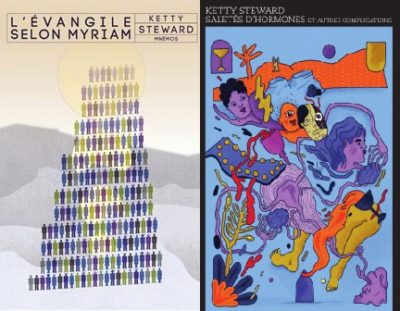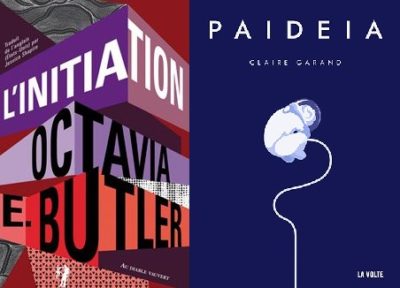Vu la gueule du monde, elle est bien réelle, la tentation de s’enfermer chez soi. Home sweet home et mort aux cons. En plus, ça tombe bien, c’est justement là qu’ils rêvent de nous renvoyer, les réacs qui braillent à longueur d’ondes : les femmes au foyer ! On gagnera du temps. Que l’on passera à se dire que, vraiment, quand on avait seize ans, on s’imaginait pas qu’à quarante on se retrouverait encore à dépenser tant d’énergie pour résister aux injonctions qui prétendent rétrécir autour des femmes les griffes de la seule sphère domestique.

Pas qu’on veuille jouer les girlboss ou qu’on surkiffe le goût du capitalisme dans le café au petit matin. Mais on sait trop bien. Elle prend l’eau, la maison. (Cette chronique vous est offerte par une sinistrée des crues de la Garonne. Je sais de quoi je parle.) Dans les coins de la buanderie et les rainures de la plaque de cuisson, il se trame des choses terrifiantes.
Côté SF, la menace vient du dehors. Le roman de Judith Merril, Des ombres sur le foyer, initialement publié en 1950 avec une fin optimiste désavouée par l’autrice, puis en 1966 dans sa version authentique, paraît en traduction française pour la première fois, chez Argyll. Le roman est encadré par un travail super efficace de préface/postface sous la plume de DoctriZ, qui permet de recontextualiser l’œuvre, et dans l’Histoire, et dans le genre. Au départ, le scénario semble frayé : les USA sont victimes d’une attaque nucléaire du fait d’une puissance qui demeurera inconnue. Des radiations dans les années 50 ! Chouette ! Moi et mes 600 heures cumulées sur Fallout, c’était l’enthousiasme assuré1. Sauf qu’on ne sortira pas explorer le vaste monde. On passera à peine le seuil de la maison. On restera porte close avec Gladys, la housewife moyenne, avec Barbie et Ginny, l’adote qui s’enflamme et la petiote qui râle, avec Veda, la femme de ménage noire qui rejoint l’unité familiale amputée par les événements du frère et surtout du père, porté disparu. On partagera l’angoisse de guetter des bribes d’info à la radio, l’impuissance, le quotidien des tâches qui pèsent mais qu’on exécute quand même parce que lancer la machine à laver, quand on ne peut rien contrôler d’autre, c’est une façon de s’ancrer. On écoutera la propagande sanitaire et sécuritaire en guettant les symptômes médicaux – so printemps 2020, vraiment. Zéro esthétisation de la guerre, de la force masculine au combat, de l’héroïsme burné face à l’ennemi. Je sais pas à quel moment on va s’en ressouvenir, de ça, vu l’actu – mais Merril, en nous racontant la lenteur des jours d’attente et l’incertitude qui se resserre, fait un récit beaucoup plus important, qui nous parle de communauté, d’endurance et de patience.
C’est drôle, parce que ça m’a rappelé une œuvre qui parle aussi de femmes dans la guerre, de maisons refuges et de racisme sournois : Autant en emporte le vent. Des ombres sur le foyer en serait le revers : une science-fiction pourtant bien plus âprement réaliste et terre-à-terre que le roman/film historique, plus petite et moins épique, dépouillée du spectacle et du sexy. Toi aussi, déconstruis tes clichés sur le genre (littéraire).
Côté fantastique, la menace vient du dedans. Lea protagoniste de Model Home, Ezri, rentre à contrecœur dans la demeure familiale, aussi cossue que malveillante : iel ne va pas tarder à y découvrir les cadavres de ses deux parents. Avec ses sœurs Eve et Emmanuelle, et leurs enfants à toustes les trois, ce qui reste de la famille Maxwell doit affronter un paquet d’ombres. Le deuil, ambivalent. Les retrouvailles, pas simples. L’incompréhension qui demeure quant au destin des parents – même si Ezri, Eve et Emmanuelle n’ont guère de doutes : c’est la maison hantée qui, après avoir pourri leur enfance en s’incarnant dans les tortures d’une entité qu’iels ont baptisé la « Mère cauchemar », vient de commettre un nouveau crime.
Model Home fait résonner deux œuvres que j’aime infiniment. La première, c’est Beloved de Toni Morrison, dont la maison était hantée par le bébé que sa mère avait tuée pour lui épargner une vie d’esclave, par l’insupportable deuil, par la culpabilité, par la mise au ban de la communauté. Mais nous sommes dans les années 2020, et le spectre du racisme a su se relooker. La propriété des Maxwell est la seule demeure occupée par une famille noire, dans un quartier de blancs rupins. Et ce monstre-là reste tapi tout au long du roman pour mieux révéler son hideux visage dans le final du récit. La seconde œuvre, c’est la nouvelle d’Ursula Le Guin « Ceux qui partent d’Omelas », conte philosophique sur le bouc émissaire imaginant une cité prospère dont la joie reposerait tout entière sur le martyre d’un unique enfant. C’est le visage qu’Ezri donne à sa souffrance, dans des pages admirables sur le traumatisme. On pense aussi volontiers au cinéma de Jordan Peele, dans l’usage qui est fait du fantastique pour donner corps à la violence insidieuse et massive du racisme : le fantastique, c’est quand la métaphore se métamorphose pour devenir encore plus abominable et monstrueuse qu’une simple reproduction mimétique du réel. On ne révèlera pas ici ce qui rôde dans les entrailles de la « maison modèle ». Entrez-y vous-mêmes. Soyez averties, cependant : l’horreur psychologique y est vraiment éprouvante.
J’aime faire se répondre deux œuvres dans une chronique. Ici, leurs titres, leurs couvertures sont aussi comparables que leurs contenus sont distincts. Les deux façades se ressemblent, comme dans un lotissement américain, mais le passant attentif saisit vite que tout ceci est trop net. Louche. Il faudra pousser la porte. Et se laisser happer par la maison.
1 Fallout est une licence de jeux vidéo, maintenant complétée par une série, qui imagine une post-apocalypse nucléaire dans une Amérique alternative au décor fifties.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.